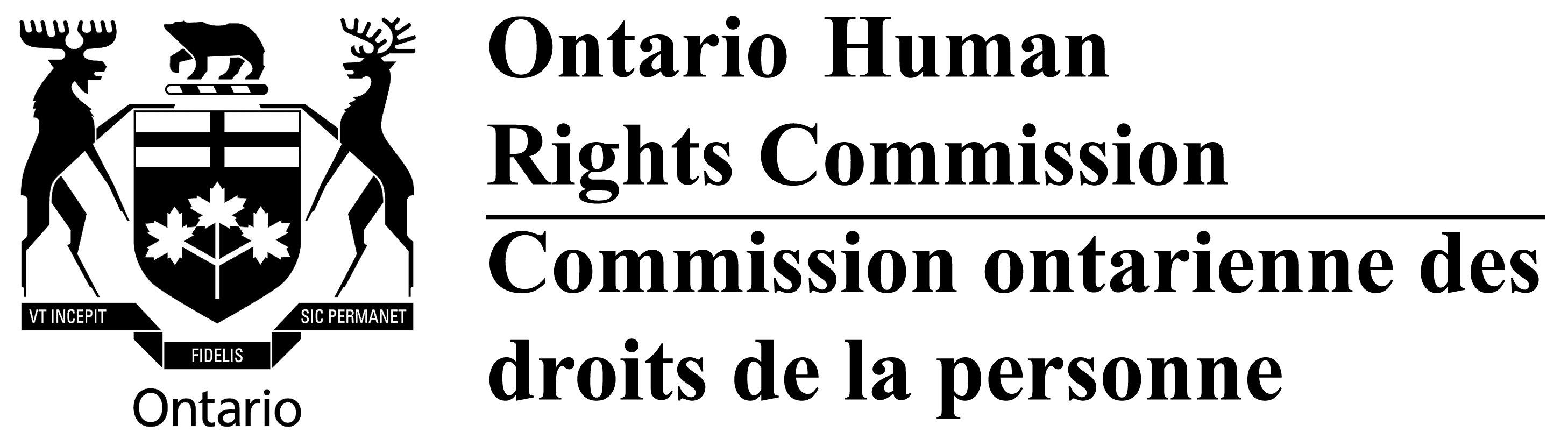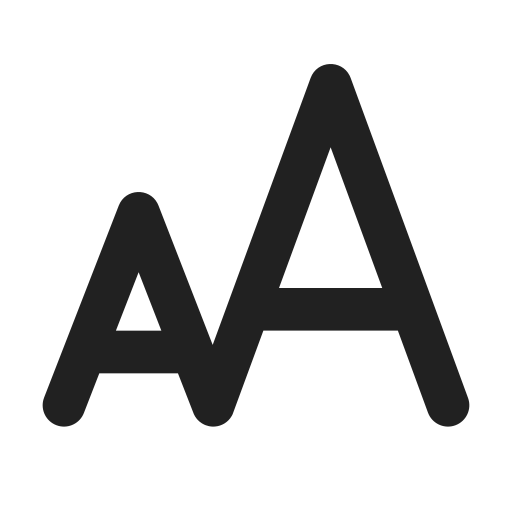La liberté religieuse est le principe de base qui sous-tend le droit à un traitement égal en vertu du Code en matière de croyance.[7] D'abord, ce principe signifie que des mesures constructives peuvent être exigées par la loi pour permettre ou faciliter l'exercice des observances religieuses.[8] Deuxièmement, il signifie aussi que personne ne peut forcer quiconque à adhérer ou à se soumettre à des convictions ou pratiques religieuses.
Ce double aspect de l'égalité est mis en lumière par la jurisprudence qui a constamment protégé la liberté religieuse et les expressions des convictions religieuses ainsi que l'absence de convictions religieuses et le droit de refuser de participer à des pratiques religieuses.[9] Selon une décision en matière de droits de la personne de1989, peu importe à quel point une personne est convaincue qu'elle possède un message religieux que son entourage devrait écouter avec attention, le Code lui interdit d'imposer ce message à autrui. «Dans un milieu de travail, un employeur possédant une grande ferveur religieuse n'a pas plus le droit d'imposer sa version des vérités religieuses à ses employés qu'un employeur possédant une grande ardeur sexuelle n'a le droit de leur imposer ses idées ou désirs sexuels.»[10] [traduction non officielle]
[7] Ce principe est exprimé dans le préambule du Code qui dit de façon expresse que
la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ... [qui vise ] à créer un climat de compréhension et de respect mutuel de la dignité et de la valeur de toute personne de façon à ce que chacun se sente partie intégrante de la collectivité et apte à contribuer pleinement à l'avancement et au bien-être de la collectivité et de la province.
[8] La notion d'«adaptation» est traitée sous la rubrique «devoir de tenir compte des besoins».
[9] Ce principe a été établi, dans le contexte de la Charte, dans l'affaire R. v. Big M Drug Mart Ltd. [1985], 1 S.C.R. 295 et, dans le contexte du Code, dans l'affaire Ontario Human Rights Commission and O'Malley v. Simpsons-Sears Ltd. (1985), 7 C.H.R.R. D/3102; par. 24775.
[10] Dufour v. J. Roger Deschamps Comptable Agréé (1989), 10 C.H.R.R. D/6153 (commission d'enquête ontarienne); p. 6170.