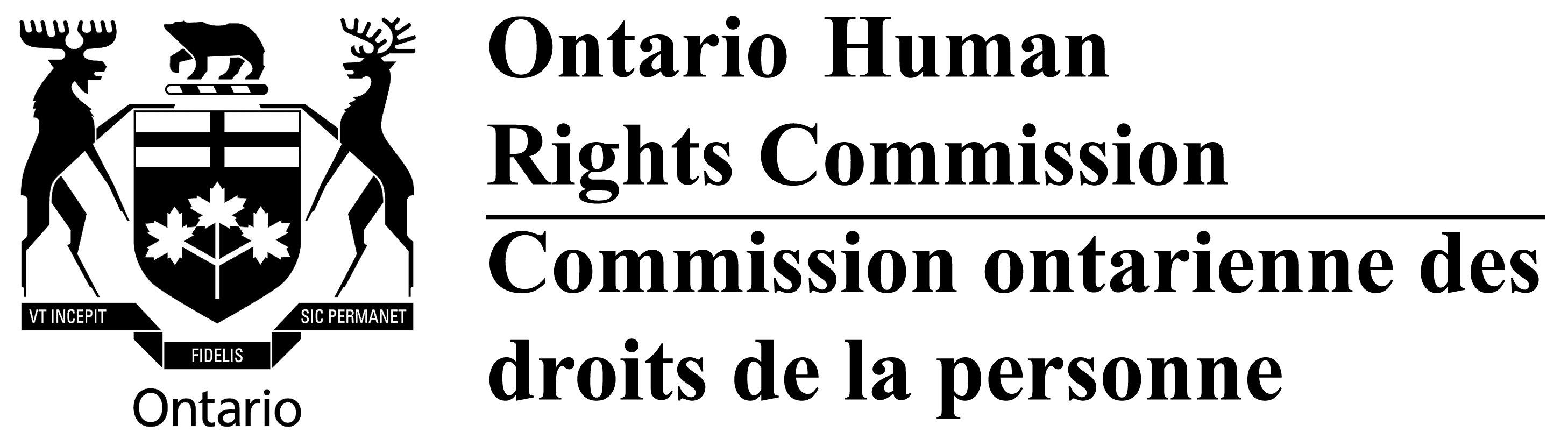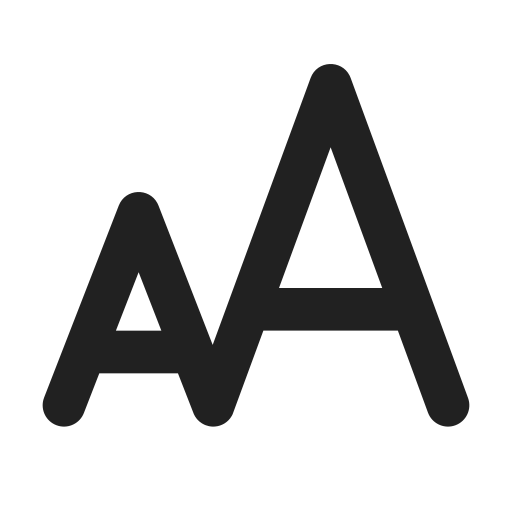1. Discrimination et harcèlement
Dans l'affaire Dufour c. J. Roger Deschamps Comptable Agréé, la commission d'enquête ontarienne chargée de l'affaire a déclaré ce qui suit :
le harcèlement ou la discrimination à l'endroit d'une personne pour des raisons religieuses est une attaque grave à la dignité de la personne, et une négation du respect égal qui est essentiel à une société démocratique libérale.[11] [traduction non officielle]
La discrimination pour motif de croyance comprend toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la religion ou des convictions et ayant pour objet ou résultat l'infirmation ou l'affaiblissement de la reconnaissance égale des droits et libertés fondamentales de la personne.[12]
Le harcèlement pour motif de croyance est une forme de discrimination. On parle de harcèlement quand une personne fait des remarques ou adopte un comportement concernant les convictions et pratiques religieuses de quelqu'un, et qu'elle sait ou devrait normalement savoir que ce comportement ou ces remarques sont importuns. Un seul incident, s'il est assez substantiel ou assez grave, peut constituer «un harcèlement» et peut créer une atmosphère empoisonnée.
Exemple : Les pratiques et convictions religieuses d'un employé font l'objet de plaisanteries ou de remarques désobligeantes de la part de la direction et des autres membres du personnel. Cette conduite est une forme de harcèlement et l'employé visé a le droit de déposer une requête devant le Tribunal desd droits de la personne.
2. Discrimination directe et indirecte
Les pratiques discriminatoires qui ne sont justifiées par aucune mesure législative[13] sont illégales et doivent être éliminées.
Exemple : Sauf dans les cas prévus pour les emplois particuliers[14], une agence de placement qui élimine toutes les personnes qui n'ont pas la même religion que l'employeur-client contrevient à la loi. Une telle pratique ne peut se justifier par le fait qu'il s'agit d'une préférence du client.[15]
Exemple : Une école publique qui donne la priorité au Notre Père dans les exercices de début et de fin de journée ne traite pas de façon égalitaire les élèves qui ne sont pas chrétiens.[16]
La discrimination est parfois indirecte.
Exemple : Un propriétaire préfère louer à des locataires de même religion que la sienne. Si un locataire refuse de sous-louer son logement selon les mêmes «règles» que le propriétaire, le propriétaire pourrait faire l'objet d'une requête à l'endroit des locataires.[17]
3. Discrimination constructive
À moins d'exception prévue dans la loi, la discrimination constructive ne peut être tolérée à moins que l'employeur prenne les mesures nécessaires pour répondre aux besoins de la personne touchée.
Il y a discrimination constructive lorsqu'une exigence, une qualification ou un facteur qui semble «neutre» a néanmoins un effet négatif sur les membres d'un groupe auquel s'applique un motif illicite de discrimination en vertu du Code. Parce que cette exigence a un effet différent sur les personnes selon l'appartenance ou non à un groupe, on peut dire qu'elle donne lieu à une «discrimination constructive». Selon le paragraphe 11 (1) du Code, constitue une discrimination contre une personne :
l'existence d'une exigence, d'une qualité requise ou d'un critère qui ne constitue pas une discrimination fondée sur un motif illicite, mais qui entraîne l'exclusion ou la préférence d'un groupe de personne identifié par un motif illicite de discrimination et dont la personne est membre...
Une prétention de discrimination constructive est établie prima facie si l'on peut montrer qu'une personne a fait l'objet d'une exclusion, restriction ou préférence qui a eu un effet négatif, sur les membres d'un groupe protégé par le Code.
Le plus souvent, quand il s'agit de croyance, les problèmes de discrimination constructive sont soulevés au sujet des éléments suivants :
- code vestimentaire
- politiques concernant les pauses
- recrutement et demandes d'emploi
- horaire souple
- modification de l'horaire
- congés pour observances religieuses
On traitera de façon plus approfondie de chacun de ces éléments dans la partie 7.
«Besoins du groupe»
Quand on parle des besoins «du groupe» on veut parler du groupe religieux auquel appartient une personne. Les besoins du groupe doivent être évalués si l'on veut satisfaire aux besoins de la personne.[18] Les tribunaux ont étudié les pratiques et observances religieuses acceptées qui font partie d'une religion ou d'une croyance donnée afin de pouvoir évaluer ces besoins.
Exemple : Des enseignants et enseignantes de religion juive demandent des congés payés pour pouvoir observer le jour du Yom Kippur. Afin de pouvoir évaluer les besoins de ce groupe, l'employeur devrait s'informer au sujet de la doctrine juive afin de pouvoir établir que les juifs pratiquants ne peuvent pas travailler le jour du Yom Kippur.[19]
[11] Ibidem.
[12] Voir la Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief (1981).
[13] L'alinéa 24 (1) (a) du Code, par exemple, permet à un établissement qui a pour but principal de servir les intérêts d'un groupe religieux identifié de préférer les candidats et candidates à un emploi qui sont également membres de ce groupe.
[14] Ibidem.
[15] Paragraphe 23 (4) du Code.
[16] Voir Opening and Closing Exercises for Public Schools in Ontario (Ministère de l'Éducation et de la Formation, 1993).
[17] L'article 9 du Code porte sur la discrimination indirecte.
[18] Article 11 (2) du Code.
[19] Commission scolaire régionale de Chambly v. Bergevin (1994) 22 C.H.R.R. D/1.