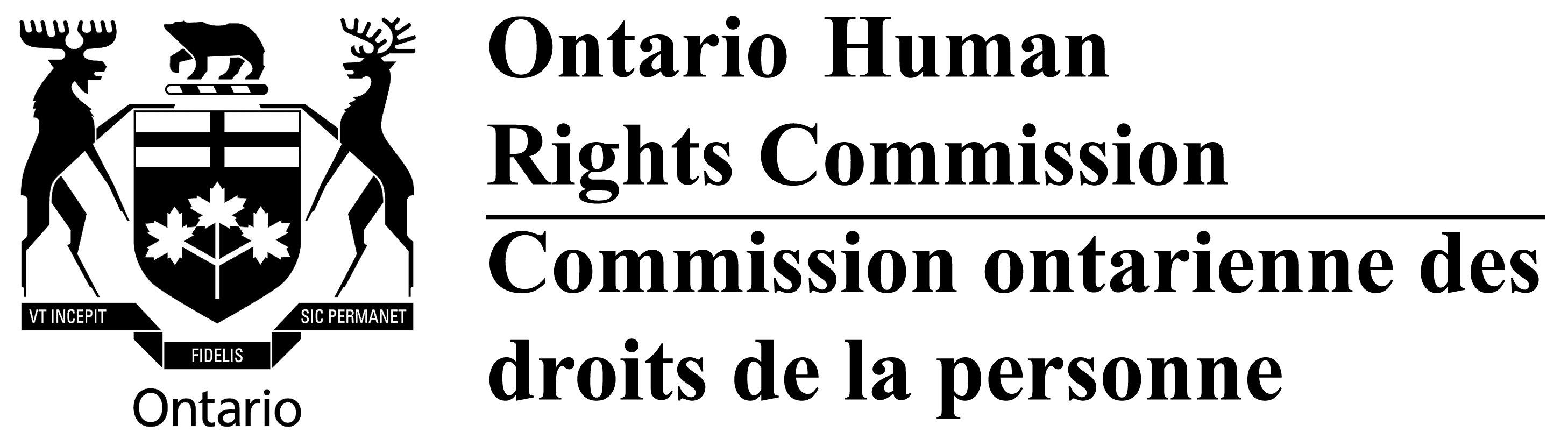Les études de cas de la partie « Feuilles de travail des élèves » peuvent être abordées de deux façons. La première consiste à organiser une discussion-forum sur chaque étude de cas; la seconde consiste à demander aux élèves de jouer les rôles des différentes personnes impliquées dans une audience du Tribunal des droits de la personne. L’utilisation des deux méthodes permettra aux élèves de mieux comprendre le Code et son application.
Première méthode : Discussion-forum
Divisez la classe en groupes de quatre ou cinq élèves. Donnez une étude de cas différente à chaque groupe en demandant aux élèves de l’analyser et d’en parler entre eux. Chaque groupe doit lire attentivement l’étude de cas qui lui est distribuée et essayer de répondre aux questions qui sont posées. Notez toutes les autres questions qui pourraient aussi venir à l’esprit des élèves, et répondez à chacune d’entre elles. Chaque groupe devra choisir un ou une élève pour le représenter pendant la discussion-forum.
Pour organiser la discussion-forum, disposez des chaises en cercle (une chaise pour chaque élève représentant un groupe), plus une chaise pour la personne chargée d’animer la discussion (que ce soit vous ou encore l’une ou l’un des élèves). Prévoyez aussi une chaise supplémentaire vide, où d’autres élèves pourront prendre place s’ils ont des questions à poser ou s’ils ne sont pas d’accord avec l’une des affirmations de l’élève en train de présenter son étude de cas. Le reste de la classe restera assis en dehors du cercle.
Chaque représentant doit présenter l’étude de cas confiée à son groupe en expliquant la situation, puis en communiquant les réponses de son groupe aux questions posées.
Les élèves qui veulent poser d’autres questions ou manifester leur désaccord avec l’élève qui parle devront s’asseoir sur la chaise vide, poser leur question ou présenter leur argument, puis quitter la chaise.
À mesure que les élèves présentent les conclusions de leur groupe, apportez-leur des compléments d’information tirés des éléments de discussion ci-dessous.
Deuxième méthode : Jeu de rôles – « Au tribunal »
Au cours de cette activité, les élèves imaginent le déroulement de l’audience pour chaque étude de cas. Un tribunal est généralement composé d’une personne qui
rend un jugement sur une plainte pour atteinte aux droits de la personne (appelée « requête »). Le tribunal peut obliger une personne ou une entreprise coupable de discrimination à dédommager la victime pour les pertes qu’elle a subies et à modifier la manière dont l’entreprise est gérée, afin de s’assurer que la discrimination ne se reproduira pas. La décision d’un tribunal est une décision judiciaire et peut donc être contestée en appel devant une instance supérieure. Pour plus de renseignements à ce sujet, reportez-vous à la partie « Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario »
en annexe.
Les élèves, répartis en groupes de sept ou huit, choisissent l’une des études de cas et préparent des arguments pour établir s’il y a eu violation ou non du Code. Au sein de chaque groupe, les élèves devront décider qui jouera les différents rôles :
- la ou les personnes ayant déposé une plainte (le plaignant/la plaignante/les plaignants)
- la ou les personnes accusées de discrimination et dont le nom est cité dans la requête (l’intimé/l’intimée/les intimés)
- l’avocat, l’avocate ou les avocats du ou des plaignants
- l’avocat, l’avocate ou les avocats de l’intimé ou des intimés
- les témoins pour l’une et l’autre partie
- le vice-président, la vice-présidente ou l’arbitre (c’est-à-dire la personne qui dirige l’audience).
Lorsque chaque groupe d’élèves a préparé ses arguments, transformez la classe en « salle d’audience ». Chaque élève devrait avoir un rôle à jouer dans chacun des cas mis en scène. Encouragez les élèves à jouer tour à tour autant de rôles que possible.
- Le vice-président, la vice-présidente ou l’arbitre se présente et présente les différentes parties/
- Ensuite, le vice-président ou la vice-présidente énonce les règles de base.
- Le plaignant ou son avocat expose les problèmes rencontrés.
- L’intimé ou son avocat expose leurs problèmes.
- Les deux parties présentent des éléments de preuve et posent leurs questions à l’autre partie.
- Le vice-président, la vice-présidente ou l’arbitre prend connaissance des faits, applique le Code ou la jurisprudence et prend une décision.
Comparez les conclusions des élèves avec les décisions effectivement rendues, qui sont présentées dans les éléments de discussion ci-dessous.
Étude de cas no 1 : Darlene
Ce cas de figure est basé sur une affaire réelle d’atteinte aux droits de la personne, Noffke c. McClaskin Hot House.
Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires à la fin de la 12e année, Darlene a trouvé un emploi chez un pépiniériste, grâce à un programme gouvernemental. Son travail consistait à aider Monsieur M., le propriétaire, à s’occuper des plantes et des arbustes, à prendre des commandes et à servir la clientèle.
La première évaluation du travail de Darlene montre que Monsieur M. pensait qu’elle exécutait extrêmement bien toutes les fonctions de son emploi. De toute évidence, Darlene aimait son travail.
Au cours des trois mois suivants, le comportement de Monsieur M. vis-à-vis de Darlene a commencé à changer. Lorsque les deux travaillaient ensemble, il posait souvent ses mains sur ses épaules ou sur ses hanches et se penchait très près d’elle. Chaque fois que cela se produisait, Darlene se détournait rapidement de lui. Monsieur M. a ensuite commencé à faire des remarques embarrassantes au sujet de son épouse, disant qu’elle ne l’intéressait plus et qu’il avait besoin d’une autre femme pour le « satisfaire ».
Darlene n’a rien fait pour provoquer les remarques ou les gestes de Monsieur M., mais elle n’a rien dit non plus pour y mettre fin. Cependant, elle devenait de plus en plus mal à l’aise vis-à-vis de son patron et elle essayait de l’éviter autant que possible. Un jour, Monsieur M. lui a demandé de l’embrasser. Lorsqu’elle a refusé, Monsieur M. lui a dit : « Je sais ce qui te dérange. Tu as peur que ça puisse te plaire. » Quelques jours plus tard, Monsieur M. lui a proposé de venir à son appartement et de coucher avec lui. Darlene a refusé catégoriquement, disant qu’elle était engagée dans une relation sérieuse avec son petit ami. Son patron lui a redemandé à plusieurs reprises de venir chez lui.
En juin, Monsieur M. a renvoyé Darlene, en disant qu’il n’avait plus de travail pour elle, alors que le mois de juin est le mois de l’année le plus chargé pour le pépiniériste.
Questions pour amorcer la discussion :
- Le pépiniériste a-t-il violé le Code des droits de la personne? Si oui, de quelle manière?
- Comme se fait-il que Darlene n’ait rien dit dès qu’elle a commencé à se sentir mal à l’aise face au comportement de son patron?
- Compte tenu de la situation, Darlene était-elle obligée de dire quelque chose à son patron pour lui faire comprendre qu’il risquait d’enfreindre le Code?
- Le licenciement de Darlene est-il un facteur à prendre en compte pour déterminer s’il y a eu atteinte à ses droits?
Éléments de discussion :
Y a-t-il eu violation du Code des droits de la personne de l’Ontario? Oui, tout à fait. L’employeur a fait preuve de harcèlement sexuel envers Darlene. Il l’a en effet touchée à plusieurs reprises. Il lui a dit que son épouse ne l’intéressait plus et qu’il avait besoin d’une autre femme. Il a demandé à Darlene de le rejoindre à son appartement et de coucher avec lui.
Comme se fait-il que Darlene n’ait rien dit dès qu’elle a commencé à se sentir mal à l’aise face au comportement de son patron? Elle était peut-être trop effrayée ou trop timide, elle ne savait pas comment faire pour empêcher son patron de continuer ou elle ne voulait peut-être pas perdre son emploi. Une personne peut ressentir ces différents sentiments lorsqu’elle est harcelée par quelqu’un qui a plus de pouvoir qu’elle, comme un patron, un propriétaire, un enseignant, etc.
Darlene était-elle obligée de dire quelque chose à son employeur pour lui faire comprendre qu’il violait le Code? Non. Le Code reconnaît que certaines formes de harcèlement sont très souvent considérées comme importunes et non souhaitées. De plus, certaines personnes coupables de harcèlement pensent qu’elles ne seront pas
punies. C’est pourquoi la définition de harcèlement dans le Code comprend les mots « devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns ». Le simple fait que Darlene se retire lorsque son employeur l’a touchée était suffisant pour lui faire comprendre que ses gestes n’étaient pas les bienvenus. Nous pouvons indiquer qu’un geste ou une action ne sont pas bienvenus par la façon dont nous réagissons, comme en nous détournant de la personne en question ou en lui disant clairement d’arrêter.
Le licenciement de Darlene est-il un facteur à prendre en compte pour déterminer s’il
y a eu atteinte à ses droits? Oui. L’employeur a violé le Code une deuxième fois parce qu’il l’a renvoyée après qu’elle a refusé ses avances sexuelles. C’est ce qu’on appelle des « représailles ». Pour quelle autre raison l’aurait-il renvoyée, alors qu’elle faisait bien son travail et que l’entreprise connaissait la période la plus active de l’année? Il y
a violation du Code lorsque quelqu’un dans une position d’autorité pénalise ou menace un employé parce que celui-ci a rejeté une demande de nature sexuelle. Il est possible de conclure à une discrimination si la décision de licencier l’employé est motivée, même partiellement, par une discrimination fondée sur un motif du Code.
Dans sa décision, le Tribunal des droits de la personne a condamné le pépiniériste à verser 2 750 dollars à Darlene pour souffrance psychologique et 240 dollars pour perte de salaire. Il a également ordonné au pépiniériste d’afficher une copie du Code dans son entreprise et d’informer la Commission ontarienne des droits de la personne (qui surveillait, à l’époque, les règlements à l’amiable et les décisions) de tout licenciement d’une employée intervenant dans les deux années suivant sa décision.
La présence dans le Code d’une disposition spécifique au harcèlement sexuel montre que de nombreuses plaintes portent sur un harcèlement de nature sexuelle, commis par une personne dans une position d’autorité.
Le harcèlement sexuel ne concerne pas toujours un homme et une femme. Il peut aussi se produire entre deux hommes ou deux femmes, tout comme il peut être exercé par une femme envers un homme.
Étude de cas no 2 : Paramvir
Il s’agit d’un cas réel, Pandori c. Peel Board of Education.
Face à une montée de la violence dans les écoles, un conseil scolaire a adopté une politique interdisant le port d’armes à l’école. Le printemps suivant, l’administration scolaire a appris que Paramvir, un sikh khalsa, portait un kirpan pour aller en classe. L’école voulait faire appliquer sa politique interdisant le port d’armes.
Plus de 10 p. 100 des quelque 250 000 sikhs vivant au Canada sont des sikhs khalsa, c’est-à-dire des sikhs qui ont célébré la cérémonie d’Amrit Sanskar, qui symbolise leur baptême spirituel. L’une des obligations des sikhs khalsa est de porter en permanence le kirpan, un objet religieux qui symbolise leur engagement spirituel envers la loi et la moralité, la justice et l’ordre. Un kirpan est un poignard en fer, rangé et solidement attaché dans une gaine, qui se porte généralement sous un vêtement.
Après de longues discussions avec la famille de Paramvir et différents organismes sikhs, le conseil scolaire a révisé sa politique sur les armes : les élèves sikhs n’auraient désormais plus le droit de porter le kirpan à l’école; ils pourraient seulement porter une imitation de kirpan, à condition qu’elle ne comporte pas de lame de métal et qu’elle ne puisse donc pas servir d’arme.
Un enseignant sikh a porté l’affaire devant le Tribunal des droits de la personne. Lors de l’audience, il a expliqué que les sikhs khalsa devaient en permanence porter un kirpan en fer ou en acier afin de respecter leurs vœux sacrés. Il a aussi indiqué que même si le kirpan avait l’air d’être une arme, il n’avait jamais servi d’arme au Canada. Enfin, il a avancé que d’autres conseils scolaires n’avaient aucune politique limitant le port du kirpan.
Le conseil scolaire, pour sa part, a présenté les arguments suivants :
- l’éducation n’est pas un service régi par le Code des droits de la personne de l’Ontario et relève plutôt de la Loi sur l’éducation
- le kirpan peut être dangereux, parce qu’il ressemble à une arme et qu’il peut servir d’arme
- d’autres personnes peuvent considérer le port du kirpan comme une incitation à la violence.
Questions pour amorcer la discussion :
-
Le Code l’emporte-t-il sur la Loi sur l’éducation?
-
La politique sur les armes était-elle discriminatoire envers les sikhs khalsa? Pourquoi?
-
Cette politique était-elle raisonnable? À votre avis, comment le conseil scolaire pourrait-il tenir compte des besoins des sikhs khalsa sans subir de préjudice injustifié, et notamment sans mettre en danger les élèves et le personnel de l’école?
Éléments de discussion :
Est-ce que le Code l’emporte sur la Loi sur l’éducation? Oui. S’appuyant sur le paragraphe 47.2 du Code qui prévoit les cas de figure dans lesquels celui-ci prévaut sur d’autres lois, y compris la Loi sur l’éducation, le Tribunal des droits de la personne
a conclu que l’éducation était un service en vertu du Code. Un conseil scolaire peut seulement faire valoir les droits garantis par la Loi sur l’éducation si ces droits ne sont pas contraires au Code ou à la Charte canadienne des droits et libertés.
La politique sur les armes est-elle discriminatoire envers les sikhs khalsa? Oui. À première vue, la politique sur les armes porte atteinte à leurs droits. Certes, ils peuvent fréquenter l’école, mais ils ne peuvent pas remplir l’une des exigences fondamentales de leur religion. Pourtant, le fait de demander à une personne de choisir entre, d’une part, l’école ou un emploi et, de l’autre, sa religion constitue une forme de discrimination. Les associations de sikhs au Canada et les hautes autorités sikhes en Inde ont confirmé l’argument selon lequel le kirpan doit être en fer ou en acier et porté en permanence.
La politique était-elle discriminatoire? Le conseil scolaire peut-il prouver que le fait de permettre aux sikhs de pratiquer leur religion (et donc de porter le kirpan) causerait
un préjudice injustifié pour l’école? Est-ce que cela menacerait considérablement la sécurité des élèves?
Le Tribunal des droits de la personne a basé sa décision sur les principaux éléments suivants :
- Il n’existe pas la moindre preuve d’un incident au cours duquel un sikh khalsa avait fait un mauvais usage de son kirpan dans une école canadienne.
- La ressemblance entre le kirpan et une arme n’est pas un argument pertinent, surtout lorsque le kirpan est porté solidement attaché sous un vêtement.
- Certes, d’autres personnes peuvent voler un kirpan pour s’en servir d’arme. Néanmoins, une personne ayant l’intention de commettre une agression peut très bien se procurer d’autres objets pouvant servir d’armes dans l’école même, comme des tournevis, des couteaux, des fourchettes ou des bâtons de baseball.
Dans sa décision, le Tribunal des droits de la personne a jugé qu’il était inacceptable de priver les sikhs de leurs droits pour contrôler des personnes non sikhes qui pourraient avoir un comportement violent, compte tenu des autres mesures possibles pour freiner
la violence dans les écoles.
Le Tribunal a conclu que le conseil scolaire n’avait pas prouvé qu’il subirait un préjudice injustifié et lui a ordonné de retirer la disposition sur le port du kirpan de sa politique sur les armes. Il a donc reconnu aux sikhs khalsa le droit de porter le kirpan dans les écoles.
Cependant, afin de tenir compte des préoccupations des deux parties, le Tribunal a indiqué que les kirpans devraient être d’une longueur raisonnable, portés sous les vêtements et bien attachés, afin qu’il soit difficile de les sortir de leur gaine. De plus,
les directrices et directeurs d’école auront le droit d’interdire le port du kirpan à toute personne qui en ferait un mauvais usage.
Étude de cas no 3 : Danté
Après avoir cherché pendant plusieurs mois un travail de fin de semaine, Danté, un jeune homme noir, a finalement obtenu une entrevue avec le propriétaire d’une station-service très fréquentée, qui fait aussi office de lave-auto. Le propriétaire semblait hésiter à l’embaucher, mais Danté a réussi à le convaincre de lui donner sa chance.
Le propriétaire lui a donc offert l’emploi, en lui disant qu’il travaillerait seulement les
fins de semaine, avec une équipe de sept autres jeunes gens, tous des étudiants de la région. Le superviseur lui apprendrait à se servir des machines pour laver les voitures.
Pour le premier jour de travail de Danté, le superviseur a seulement passé quelques minutes à lui expliquer le fonctionnement des machines. Danté a donc regardé ce que les autres jeunes gens faisaient, mais ceux-ci ne l’aidaient pas beaucoup lorsqu’il leur posait des questions.
Au cours des fins de semaine suivantes, Danté s’est concentré sur son travail, mais
à cause de certains incidents, il s’est retrouvé de plus en plus isolé. Quelques-uns
de ses collègues l’ont invité à se joindre à eux à l’heure du déjeuner ou pendant les pauses, mais d’autres n’arrêtaient pas de lui lancer des plaisanteries racistes, souvent assez fort pour que le superviseur les entende. Un jour, Danté a entendu le superviseur dire que c’était à cause des Noirs qu’il y avait de plus en plus de violence dans la collectivité. Cette déclaration a encouragé certains employés, qui avaient pourtant déjeuné avec Danté à plusieurs reprises, à se moquer eux aussi des personnes de race noire. Quand ses collègues lui jetaient des regards en racontant leurs plaisanteries, Danté se levait et s’éloignait d’eux.
Un samedi après-midi, alors qu’il y avait beaucoup de monde au lave-auto, plusieurs machines de lavage sont tombées en panne, parce que quelqu’un les avait laissé surchauffer. Danté avait travaillé sur ces machines jusqu’à sa pause, quand un autre travailleur l’a remplacé. La panne s’est produite un peu plus tard.
Le superviseur, furieux, a accusé Danté de négligence. Danté a répondu qu’il pensait que les machines fonctionnaient bien quand il s’est arrêté pour sa pause. Il a répété que la panne n’était pas de sa faute, mais le superviseur l’a renvoyé. Danté pense qu’il a été victime de discrimination parce qu’il est noir, alors que les autres travailleurs et les responsables sont blancs.
Questions pour amorcer la discussion :
-
Le superviseur avait-il une bonne raison de licencier Danté? Pourquoi?
-
Quels facteurs un tribunal des droits de la personne prendrait-il en compte?
Éléments de discussion :
Le superviseur avait-il une bonne raison de licencier Danté? Non, probablement pas. Le superviseur aurait du mal à prouver que Danté était responsable de la défaillance des machines, puisqu’il était déjà parti pour sa pause. Il n’est pas clair non plus si tout ou partie de la responsabilité était attribuable à un autre employé.
Danté pense qu’il a été renvoyé parce qu’il est noir. Quels autres facteurs faudrait-il prendre en compte dans le cadre d’une audience d’un tribunal des droits de la personne? Le propriétaire a promis à Danté que le superviseur lui apprendrait à
se servir des machines, mais le superviseur ne lui a donné que quelques minutes d’explications. Pourquoi? Est-il possible que le superviseur ne veuille pas travailler
avec Danté? Est-ce que le propriétaire s’en était douté et avait ainsi hésité à embaucher Danté?
Danté a entendu le superviseur dire que c’était à cause des Noirs qu’il y avait de plus en plus de violence dans la collectivité. Est-ce que Danté pouvait raisonnablement s’attendre à un traitement égal de la part d’un superviseur qui a ce genre d’attitude?
Le superviseur a aussi contribué au harcèlement subi par Danté et à la création d’une atmosphère empoisonnée en échangeant des plaisanteries racistes avec les collègues de Danté.
De plus, certains des collègues de Danté se comportaient comme s’il n’existait pas
et l’ont écarté du groupe, ce qui a aussi pu renforcer le harcèlement. Leur attitude et l’existence d’une atmosphère empoisonnée constituaient une forme de discrimination.
L’audience tenue par un tribunal permettrait de déterminer si le licenciement de Danté était, en partie du moins, dû au fait que le superviseur pratiquait à son égard une discrimination fondée sur la race. En effet, si le tribunal juge que la discrimination a joué un rôle, même partiel, dans la décision de l’employeur, alors celui-ci a bel et bien enfreint le Code.
Étude de cas no 4 : Tammy
Cette affaire, appelée Youth Bowling Council c. McLeod, a d’abord été entendue par un tribunal, avant d’être portée en appel devant la Cour divisionnaire, qui a rejeté l’appel. La décision de la Cour divisionnaire a ensuite été confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario.
Tammy, âgée de 11 ans, jouait aux quilles depuis déjà cinq ans dans sa ligue récréative locale. Elle s’est qualifiée, avec plusieurs autres jeunes, pour participer à
une compétition provinciale parrainée par le Youth Bowling Council.
Tammy est atteinte de paralysie cérébrale et utilise un fauteuil roulant, mais elle peut réaliser et coordonner quelques mouvements. Son père lui a construit une rampe en bois pour qu’elle puisse jouer aux quilles. Tammy pose le haut de la rampe sur ses genoux, puis elle l’aligne sur les quilles et fait rouler la boule sur la rampe.
Juste avant la compétition, le Youth Bowling Council a décidé que Tammy ne pouvait pas y participer. Bien que les règles de ce conseil autorisent les personnes handicapées à utiliser des accessoires spéciaux pour les aider à jouer aux quilles (à condition que ces accessoires n’ajoutent pas de la puissance ou de la vitesse à la boule), elles interdisent l’emploi de ces accessoires en compétition.
L’affaire a été portée devant le Tribunal des droits de la personne, puis devant la Cour suprême de l’Ontario. Le Youth Bowling Council a indiqué qu’il n’avait pas violé les droits garantis à Tammy par le Code, parce que Tammy ne pouvait pas effectuer les gestes essentiels du jeu de quilles, c’est-à-dire lancer la boule manuellement. L’organisme a également affirmé que l’emploi d’accessoires spéciaux fausserait la compétition, parce qu’elle ne reposerait plus sur des compétences communes à tous les concurrents.
Les avocats de Tammy ont insisté sur le fait que Tammy jouait bien aux quilles, puisqu’elle utilisait la boule pour les abattre. Ils ont aussi indiqué que le Youth Bowling Council devait, en vertu du Code, tenir compte de ses besoins en la laissant utiliser sa rampe. Les tests de vitesse et de précision ont montré que Tammy n’avait aucun avantage sur les autres joueuses ou joueurs. Sa boule ne pouvait pas atteindre la vitesse suffisante pour obtenir les meilleurs résultats et son lancer n’avait qu’une précision moyenne.
Questions pour amorcer la discussion :
-
Tammy était-elle capable d’exécuter les gestes essentiels du jeu de quilles? Est-ce que ce facteur devrait être pris en considération pour déterminer s’il y a eu violation du Code?
-
Est-ce que le Youth Bowling Council devrait tenir compte des besoins de Tammy (en lui permettant, par exemple, d’utiliser sa rampe pour participer à des compétitions?)
-
Le Youth Bowling Council subirait-il un préjudice injustifié s’il autorisait Tammy à se servir de sa rampe en compétition? Est-ce que cela changerait trop la nature du sport? Justifiez votre réponse.
Éléments de discussion :
Cette affaire, appelée Youth Bowling Council c. McLeod, a été entendue par un tribunal, avant d’être portée en appel devant la Cour divisionnaire, qui a rejeté l’appel. La décision de la Cour divisionnaire a ensuite été confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario.
Voici le cœur du problème : Tammy était-elle capable d’exécuter les gestes essentiels du jeu de quilles, et est-ce que ce facteur devrait être pris en considération pour déterminer s’il y a eu violation du Code?
La Cour a reconnu que le fait de tenir et de lancer la boule manuellement constituait un critère essentiel du jeu de quilles. Puisque Tammy avait besoin d’une rampe pour lancer la boule, elle n’était pas capable d’accomplir le geste essentiel du jeu.
Le Youth Bowling Council était-il dans l’obligation de tenir compte des besoins de Tammy, qui ne pouvait pas accomplir l’un des gestes essentiels du jeu sans une rampe? « Oui », a répondu le tribunal. En effet, la règle selon laquelle la boule doit être lancée manuellement a un effet défavorable sur de nombreuses personnes ayant le même handicap que Tammy ou un autre handicap à la main ou au bras.
D’après le Code, un organisme doit tenir compte des besoins d’une personne qui, en raison d’un handicap, ne peut pas satisfaire à certaines exigences essentielles, à moins de pouvoir prouver que cela causerait un préjudice injustifié.
Est-ce que les mesures d’adaptation nécessaires pour permettre à Tammy de participer à des compétitions causeraient un préjudice injustifié? La Cour a décidé que non, et ce, pour plusieurs raisons. Le fait d’autoriser Tammy à utiliser la rampe ne lui donnerait aucun avantage injuste sur les autres joueuses et joueurs, comme cela a été confirmé par des tests. Le Youth Bowling Council a souligné que tous les concurrents devaient avoir les mêmes aptitudes, mais il n’a rien dit sur d’autres différences, comme la taille, le poids ou la maturité, qui influent aussi sur les habiletés des joueurs.
La Cour a rejeté l’argument selon lequel des accessoires spéciaux peuvent être permis pour les jeux de quilles récréatifs, mais interdits pour les compétitions.
Était-ce juste de permettre aux personnes handicapées de participer à des jeux de quilles récréatifs, mais pas aux compétitions, alors que les mesures d’adaptation nécessaires pour leur permettre de jouer ne leur donnaient aucun avantage sur les autres? Comme l’a rappelé le tribunal, tous les joueurs jouent pour gagner, qu’ils participent à des jeux récréatifs ou à des compétitions, et tout le monde devrait avoir le droit de participer à ces deux types d’activités.
La Cour a confirmé la décision du tribunal selon laquelle Tammy avait fait l’objet d’une discrimination fondée sur son handicap. Elle a ordonné au Youth Bowling Council d’autoriser Tammy à utiliser sa rampe durant les compétitions. Cela permet ainsi à toutes les personnes handicapées qui voudraient jouer aux quilles d’utiliser des accessoires spéciaux, dans la mesure où ces derniers n’ajoutent aucune puissance ni aucune vitesse à la boule.
Étude de cas no 5 : Kyle
Ce cas de figure est basé sur l’affaire Kyle Maclean c. The Barking Frog.
Kyle est un jeune homme qui s’est rendu au Barking Frog, un bar situé à London, en Ontario, pour participer à une « soirée pour les filles » (Ladies’ Night). Dans tout l’Ontario (et même dans tout le Canada et dans certaines régions des États-Unis), les bars organisent régulièrement des « soirées pour les filles » : les femmes accèdent ainsi au bar soit gratuitement, soit en payant un droit d’entrée moins élevé que les hommes, ou bénéficient d’un rabais sur les boissons qu’elles consomment. Ce genre de soirées est une pratique courante en Ontario et ailleurs depuis plusieurs décennies.
Kyle s’est rendu au Barking Frog, où le videur lui a indiqué que le droit d’entrée était de 20 dollars pour les hommes et de seulement 10 dollars pour les femmes du groupe.
Kyle a porté plainte pour atteinte des droits de la personne, affirmant que les différents droits d’entrée constituaient une discrimination fondée sur le sexe.
Questions pour amorcer la discussion :
-
Kyle a-t-il été victime de discrimination? Si oui, de quel type de discrimination?
-
Quels facteurs faudrait-il prendre en considération pour déterminer s’il y a eu violation du Code?
-
En quoi l’égalité réelle est-elle différente de l’égalité formelle?
Éléments de discussion :
Au tribunal, l’arbitre a expliqué que le Code des droits de la personne de l’Ontario vise à atteindre l’égalité réelle, plutôt que l’égalité formelle. L’égalité réelle reconnaît que certaines différences de traitement ne mènent pas toutes à une discrimination réelle
en vertu du Code. Le tribunal a souligné le fait que, dans le contexte social et culturel de l’Ontario, l’organisation d’une soirée pour les filles ne pouvait pas être considérée comme discriminatoire envers les hommes [voir Ontario (Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées) c. Tranchemontagne, 2010 ONCA 593 (CanLII), par. 77 à 91].
De quel type de discrimination Kyle se dit-il être victime? Il affirme faire l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe. D’après lui, l’existence de plusieurs droits d’entrée
en fonction du sexe des personnes constitue une atteinte à son droit de ne pas subir
de discrimination dans les services.
Kyle a indiqué au tribunal qu’en faisant payer aux hommes un droit d’entrée deux fois plus élevé qu’aux femmes, le Barking Frog a soutenu l’idée que les hommes sont moins dignes que les femmes. Il a également avancé que l’existence d’un droit d’entrée plus élevé pour les hommes les dissuade d’entrer dans le bar. Le tribunal n’a accepté aucun de ces arguments, soulignant que les hommes occupent une place privilégiée dans notre société.
Le tribunal a toutefois constaté que Kyle avait peut-être eu le sentiment que l’écart entre les droits d’entrée paraissait injuste. Cependant, bien qu’une chose soit injuste pour le sentiment général, elle n’est pas nécessairement discriminatoire au sens de la législation sur les droits de la personne. Le tribunal a donc rejeté l’affaire, affirmant que les soirées pour les filles ou l’instauration d’un droit d’entrée inférieur pour les femmes ne sont pas discriminatoires envers les hommes.
Dans ce cas de figure, existe-t-il des règles et des conditions différentes pour les hommes et les femmes dans les services? La différence de traitement est-elle justifiée? Êtes-vous d’accord avec la décision de l’arbitre de rejeter la requête?
Étude de cas no 6 : Rita
Rita et sa famille ont quitté une collectivité éloignée pour venir s’installer à la ville en plein milieu de l’année scolaire. En moins d’une semaine, Rita s’est inscrite à l’école secondaire de son nouveau quartier où elle a commencé à suivre des cours. Elle faisait le chemin entre l’école et sa maison en autobus scolaire.
Au bout de deux semaines, Rita commençait à s’habituer à ses cours. Elle était toutefois un peu inquiète vis-à-vis de son cours d’histoire. Lors du premier cours, son enseignante d’histoire lui avait fait comprendre qu’elle avait beaucoup de retard à rattraper si elle voulait obtenir un crédit.
La semaine suivante, un groupe d’élèves a fait un exposé sur le voyage de Christophe Colomb vers le « Nouveau Monde » en 1492. Une discussion animée a eu lieu, et des textes et des dessins représentant l’arrivée de Colomb dans différents territoires ont |été distribués à la classe. Plusieurs de ces textes parlaient des « sauvages » et des « Peaux-Rouges » contre lesquels les colons devaient se battre pour s’installer dans
le Nouveau Monde.
Rita, qui est une Indienne crie, a été choquée que l’enseignante ne remette pas en question la représentation des Autochtones donnée dans cet exposé. Elle est donc allée la voir le lendemain, avant le cours, pour lui en parler. Au début du cours, l’enseignante a annoncé à la classe que l’exposé sur Christophe Colomb avait dérangé Rita. Elle s’est ensuite tournée vers Rita pour lui demander de donner sa version de la « découverte de Colomb » du point de vue des Autochtones.
Surprise, Rita a présenté plusieurs arguments de façon hésitante, mais elle s’est vite rassise parce que plusieurs élèves ont commencé à ricaner. Plus tard, dans l’autobus qui la ramenait à la maison, plusieurs jeunes se sont moqués d’elle, disant que si elle n’aimait pas la façon dont on lui enseignait l’histoire, elle n’avait qu’à abandonner l’école. Elle a tourné la tête et fait mine de les ignorer. Le lendemain, les élèves ont continué à se moquer d’elle dans les couloirs. À l’heure du déjeuner, elle s’est aperçue que quelqu’un avait gribouillé les mots « partie à la chasse » sur la porte de son casier. Encore une fois, elle a essayé de ne pas prêter attention aux élèves autour d’elle.
Rita a parlé de ces incidents à ses parents. Ils ont téléphoné à la directrice de l’école, qui leur a répondu qu’elle « passerait un savon » aux élèves responsables. Elle a aussi suggéré que Rita fasse plus d’efforts pour s’intégrer à la classe et s’entendre avec ses camarades.
Questions pour amorcer la discussion :
- Qu’aurait dû faire l’enseignante quand Rita lui a parlé de ce qui l’avait dérangée dans l’exposé sur Christophe Colomb?
- La directrice de l’école aurait-elle dû prendre d’autres mesures?
Éléments de discussion :
Qu’aurait dû faire l’enseignante quand Rita lui a parlé de ce qui l’avait dérangée dans l’exposé présenté en classe? Ce genre de situation devrait de moins en moins se produire, à mesure que les programmes scolaires reflètent mieux la question de la diversité. L’exposé des élèves présentait un point de vue très ethnocentrique des événements liés au voyage de Christophe Colomb. De toute évidence, la colonisation de l’Amérique du Nord n’a pas été vécue de la même façon par les peuples autochtones que par les personnes venues d’Europe.
L’enseignante a été très injuste en demandant à Rita de présenter le « point de vue des Autochtones ». Elle supposait que Rita pouvait parler au nom de tous les Autochtones
et par cette attitude, elle a appliqué un stéréotype. Par ailleurs, elle laissait entendre que ce n’était pas son rôle de veiller à donner une vision équilibrée de la question.
Lorsqu’elle a demandé aux élèves de préparer l’exposé, ou lorsque Rita a soulevé ses objections, l’enseignante aurait pu prendre l’une des mesures suivantes pour prévenir la situation qui s’est produite :
- demander à la classe de discuter des événements de 1492 du point de vue de Christophe Colomb et du point de vue des peuples autochtones d’Amérique
- parler d’autres événements similaires dans l’histoire de l’humanité et demander aux élèves de considérer aussi bien le point de vue des « envahisseurs » que des « envahis ».
L’une de ces mesures aurait permis d’éviter que Rita se retrouve isolée et se sente différente à cause de son ascendance autochtone. En s’adressant uniquement à Rita, l’enseignante a ouvert la voie du harcèlement et de l’intimidation qui ont suivi.
Qu’est-ce que la directrice de l’école aurait dû faire? L’école doit offrir à tous les élèves un milieu d’apprentissage libre de tout harcèlement et de toute discrimination. La directrice aurait dû prendre l’affaire très au sérieux et veiller à ce que tout le monde comprenne que ce type de comportement ne serait pas toléré à l’école.
Or, si la directrice décide de punir les élèves coupables, elle risque de rendre la situation encore plus difficile pour Rita, car les élèves punis pourraient penser que leur punition est de sa faute. Rita pourrait alors faire l’objet de railleries pour avoir semé la zizanie, en plus des actes de racisme qu’elle subit déjà.
La directrice devrait organiser une séance d’information pour parler des questions
de diversité, d’équité et de droits de la personne avec l’ensemble des élèves et du personnel enseignant. L’école devrait aussi prendre des mesures pour aider toutes les personnes qui fréquentent l’école à mieux apprécier la culture autochtone, par exemple en demandant aux élèves de lire certains textes, en projetant des vidéos, en invitant certaines personnalités à l’école, etc.
Si Rita continue d’être harcelée, la directrice ou l’enseignante devront peut-être prendre des mesures disciplinaires.
Étude de cas no 7 : Cindy
Ce cas de figure s’inspire de l’affaire Cameron c. Nel-Gor Castle Nursing Home, qui
a été soumise à un tribunal, puis portée en appel devant la Cour divisionnaire.
Cindy, âgée de 19 ans, a posé sa candidature pour un poste d’aide-infirmière dans une maison de soins infirmiers. Elle a déjà eu un emploi à temps partiel comme assistante d’une institutrice de maternelle et elle s’est également occupée d’enfants handicapés physiques et mentaux quand elle était à l’école secondaire. Pendant sa première entrevue, l’administratrice adjointe de la maison de soins infirmiers a dit à Cindy qu’elle était une candidate idéale et qu’elle serait très probablement embauchée.
La maison de soins infirmiers a demandé à Cindy de passer au préalable un examen médical auprès de son médecin de famille. Le médecin a confirmé que Cindy serait tout à fait capable de soulever des personnes malades.
La recruteuse qu’elle a rencontrée lors de la deuxième entrevue a étudié les résultats de son examen médical et s’est aperçue que Cindy avait un problème à la main. Au cours de la première entrevue, l’administratrice adjointe ne s’était pas rendu compte que l’index, le majeur et l’annulaire de la main gauche de Cindy étaient beaucoup plus courts que chez la plupart des gens. À partir de ce moment-là, la recruteuse et une
autre directrice des soins infirmiers ont longuement parlé du handicap de Cindy et des exigences de l’emploi. Bien qu’elles aient toutes les deux très envie d’embaucher Cindy, elles ne la croyaient pas capable de tenir correctement les malades pour les soulever.
Cindy leur a indiqué qu’elle pourrait parfaitement exécuter les fonctions liées au poste
et qu’elle avait déjà effectué des tâches semblables avec des enfants handicapés, mais elle n’a pas été embauchée.
Questions pour amorcer la discussion :
- La recruteuse avait-elle de bonnes raisons de croire que Cindy ne serait pas capable de faire son travail?
- Sur quoi la recruteuse s’est-elle basée pour décider que Cindy ne pourrait pas satisfaire une exigence professionnelle établie de bonne foi?
Éléments de discussion :
À votre avis, quelle décision la recruteuse et la directrice des soins infirmiers auraient-elles dû prendre, et pourquoi? Sur quoi les responsables de la maison de soins se sont-ils basés pour évaluer les capacités physiques de Cindy? Avaient-elles de bonnes raisons de croire que Cindy ne pourrait pas faire son travail comme il faut?
Il semble que l’administratrice et la directrice pensaient bien faire, compte tenu de leur expérience en matière de médecine et de soins infirmiers. Leur décision était toutefois en contradiction avec l’évaluation du médecin et le jugement que Cindy portait sur ses propres compétences. Cindy avait déjà fait un travail similaire par le passé et elle s’estimait capable de satisfaire aux exigences du poste.
L’idée que Cindy ne pourrait pas effectuer les tâches essentielles de l’emploi était fondée sur l’« impression » subjective qu’elle ne serait pas capable de soulever les malades.
L’administratrice n’a pas appelé le médecin de Cindy, ni demandé à celle-ci de passer un test pour établir si elle pouvait ou non accomplir les tâches essentielles de l’emploi.
Le tribunal a conclu qu’une « impression » était par nature subjective et que les personnes accusées de discrimination devaient justifier leur décision de façon objective, en présentant soit des faits, soit des preuves confirmant que l’incapacité présumée de Cindy l’empêcherait de satisfaire aux exigences essentielles de l’emploi.
Même si les responsables de la maison de soins infirmiers ont pris leur décision de bonne foi, sans vouloir faire de la discrimination, cette décision a toutefois eu un effet discriminatoire sur Cindy.
Étude de cas no 8 : Maria
Cette étude de cas est basée sur l’affaire Maria Vanderputten c. Seydaco Packaging Corp. et Gerry Sanvido (nos 2, 3 et 4). Dans cette affaire, les avocats de la plaignante ont exposé les problèmes suivants :
- La plaignante a été victime de harcèlement au travail et a été exposée à une atmosphère de travail empoisonnée.
- Elle a été licenciée en raison de son identité sexuelle.
Lorsque Maria a commencé à travailler dans l’usine d’emballage Seydaco Packaging Corp., elle s’appelait Tony. Elle a été embauchée comme manœuvre le 24 août 2003. En 2008, elle a été admise en clinique d’identité sexuelle et a entamé une transition sexuelle d’homme en femme. Elle a commencé le processus de changement de sexe et a suivi un traitement hormonal pour développer sa poitrine. Dans sa plainte, Maria a déclaré avoir été victime de harcèlement, d’une atmosphère de travail empoisonnée, d’un licenciement pour un motif illicite en vertu du Code des droits de la personne.
Maria a indiqué que Gerry, chef d’équipe et opérateur de machine, a largement contribué au harcèlement dont elle a été victime et à l’incident qui a mené à son licenciement. L’usine d’emballage a répondu que les événements décrits par Maria n’ont jamais eu lieu. L’usine a insisté sur le fait qu’elle avait fourni à la plaignante un traitement approprié en décidant de la considérer comme un homme et de la traiter comme les autres hommes jusqu’à ce qu’elle présente des documents médicaux ou juridiques confirmant qu’elle était devenue une femme. Les responsables de l’usine ont affirmé l’avoir licenciée à cause de son comportement colérique, de ses actes d’insubordination et de son implication dans plusieurs conflits dont elle serait à l’origine.
Questions pour amorcer la discussion :
- Selon vous, de quelles façons Maria a-t-elle été victime de discrimination dans son travail?
- À votre avis, quelles seraient les raisons données par le superviseur pour licencier Maria? Que pensez-vous de ces raisons?
- Selon vous, quelles réparations Maria devrait-elle obtenir du fait d’avoir été victime de discrimination?
Éléments de discussion :
Atmosphère de travail empoisonnée : Maria a indiqué que les éléments suivants avaient contribué à la création d’une atmosphère de travail empoisonnée :
- Ses collègues lui lançaient des remarques désobligeantes sur son identité sexuelle et elle était obligée de se changer dans le vestiaire des hommes.
- Le propriétaire de l’usine insistait pour que Maria soit traitée comme un homme à tous les égards jusqu’à son opération de changement de sexe, et lui a notamment imposé de se changer avec ses collègues masculins.
- Le propriétaire n’a pas cherché à examiner les accusations de harcèlement fondé sur le sexe et l’identité sexuelle, et n’a rien fait pour y apporter une réponse raisonnable.
L’arbitre a entendu des témoignages confirmant que, dans le passé, Maria avait souvent été en conflit avec ses collègues et qu’elle avait été sanctionnée pour avoir lancé une remarque raciste au travail au cours d’une dispute avec un collègue. À l’époque de la plainte, Maria s’habillait en femme avant d’enfiler la combinaison neutre que tous les employés étaient tenus de porter dans l’atelier. Par ailleurs, elle arrivait souvent au travail maquillée.
Harold, le directeur des opérations, a affirmé ne pas avoir été au courant de la transition sexuelle de Maria avant 2008, lorsque Maria a commencé à porter des vêtements féminins. Maria ne lui aurait jamais vraiment parlé de sa transition sexuelle. Elle ne lui aurait pas non plus demandé d’aménager son travail ou de revoir la politique de séparation des vestiaires en fonction du sexe des employés.
Sur son lieu de travail, Maria a été dévisagée, elle s’est fait pousser et bousculer et on lui a lancé des objets. D’après elle, certains employés avaient même reçu la consigne de l’éviter le plus possible et de ne pas l’aider dans son travail. Lorsqu’un collègue lui lançait des remarques désobligeantes, elle lui répondait en l’insultant.
L’arbitre a fait remarquer que Maria faisait bien son travail, mais qu’elle était souvent impliquée dans des conflits avec les autres employés. Elle a notamment fait l’objet de mesures disciplinaires pour avoir lancé une remarque raciste au cours d’une dispute avec un collègue et pour s’être fâchée avec d’autres employés de l’usine. Elle a été licenciée après avoir été sanctionnée pour ces incidents. Peu après, Harold a quitté l’usine et Maria a été réintégrée. En novembre 2007, elle a été suspendue sans salaire pendant une semaine pour s’être comportée de manière agressive : en effet, au cours d’une dispute, elle avait insulté l’un de ses collègues et lui avait jeté un bout de bois.
L’arbitre a toutefois souligné qu’avant son licenciement, Maria était exposée à une atmosphère de travail empoisonnée, parce qu’elle faisait l’objet de remarques harcelantes sur son identité sexuelle et qu’elle était obligée de se changer dans le vestiaire des hommes. Le chef d’équipe, Gerry, a joué un rôle important dans la création de cette atmosphère empoisonnée en exigeant que Maria soit traitée comme un homme à tous les égards. L’arbitre a donc estimé que le fait d’exiger que la plaignante soit traitée de la même façon que les hommes jusqu’à ce que sa transition soit complètement terminée constituait une forme de discrimination, car cela ne prenait en compte ni les besoins de la plaignante ni son identité.
Maria a obtenu la somme de 22 000 dollars en dommages et intérêts pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l’estime de soi, ainsi que des intérêts avant jugement et le montant des salaires qu’elle aurait perçus si elle avait conservé son emploi jusqu’au 11 janvier 2011.
L’arbitre a également ordonné à l’usine d’embaucher un spécialiste des droits de la personne chargé de l’aider à élaborer et à mettre en œuvre des politiques de défense des droits de la personne et de lutte contre le harcèlement. Par ailleurs, tous les responsables de l’usine ont dû suivre une formation sur la législation relative aux droits de la personne et sur la façon de faire appliquer les dispositions des politiques contre le harcèlement.
Étude de cas no 9 : Tawney
L’affaire Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commissions) c. BCGSEU est souvent appelée « affaire Meiorin » ou « affaire des pompiers de Colombie-Britannique ». Même s’il s’agissait d’un grief à l’origine, cette affaire concerne tout de même les droits de la personne puisque, dans de nombreuses provinces, la législation sur le travail donne aux arbitres la responsabilité de faire appliquer les lois sur les droits de la personne dans des cas bien précis. [Pour l’Ontario, se reporter à
la Loi de 1995 sur les relations de travail, alinéa 48 (12) j).] C’est la Cour suprême du Canada qui a finalement rendu une décision dans cette affaire, ce qui signifie que cette décision s’applique également en Ontario.
Tawney travaillait pour la province de Colombie-Britannique en tant que membre de l’équipe de pompiers forestiers d’une petite région de la province. Le travail de l’équipe consistait à lutter contre les incendies de forêt et à les éteindre lorsqu’ils étaient mineurs et pouvaient être facilement maîtrisés. Ses superviseurs jugeaient son travail satisfaisant et ne mettaient pas en doute sa capacité à accomplir son travail de manière sûre et efficace.
Trois ans après son embauche, le gouvernement a adopté une nouvelle série de tests d’évaluation de la condition physique des pompiers forestiers. Ces tests ont été établis après le dépôt d’un rapport d’enquête du coroner qui recommandait que, par mesure de sécurité, seuls les employés en bonne condition physique soient affectés en première ligne à la lutte contre les incendies de forêt. Ces tests exigeaient que les pompiers forestiers pèsent moins de 200 livres ou 100 kilos (avec leur matériel) et qu’ils effectuent une course, un exercice de flexion verticale des bras, ainsi qu’un exercice de portage de pompes et de tir de tuyaux dans des délais précis.
L’épreuve de la course visait à évaluer la condition aérobique des pompiers forestiers. Les pompiers devaient courir une distance de 2,5 kilomètres en 11 minutes. Après quatre essais, Tawney n’a pas réussi à satisfaire à la norme aérobique, ayant parcouru la distance requise en 11 minutes et 49,4 secondes, plutôt que dans le délai imposé de 11 minutes. Elle a donc été licenciée.
Le syndicat de Tawney a déposé un grief en son nom, jugeant que le test était discriminatoire envers les femmes.
Questions pour amorcer la discussion :
- Que pensez-vous de l’idée d’adopter des normes différentes pour les hommes et pour les femmes?
- Le test constituait-il selon vous une méthode équitable pour évaluer a capacité d’un pompier de faire son travail?
- Si le temps de parcours de Tawney, bien qu’inférieur à la norme, avait été jugé acceptable, cela aurait-il signifié que Tawney aurait été favorisée par rapport aux hommes?
Éléments de discussion :
Les preuves apportées lors des audiences ont démontré qu’en raison de différences physiologiques, la plupart des femmes ont une capacité aérobique moindre que la plupart des hommes. Contrairement aux hommes, la majorité des femmes sont incapables, même en s’entraînant, d’accroître leur capacité aérobique d’une manière suffisante pour satisfaire à la norme adoptée par le gouvernement. Selon les témoignages entendus, entre 65 et 70 p. 100 des candidats réussissent les tests du premier coup, contre seulement 35 p. 100 des candidates. Les preuves présentées ont donc permis de montrer qu’il s’agissait bien d’un cas de discrimination fondée sur le sexe, puisqu’à cause de ces exigences, les femmes étaient bien moins nombreuses que les hommes au sein de l’équipe de pompiers dont faisait partie Tawney.
En réponse, le gouvernement a expliqué qu’il avait effectué des recherches approfondies afin de déterminer les seuils de réussite de ces tests. Cependant, il
n’a pas pu convaincre la Cour que la capacité aérobique imposée était réellement nécessaire pour que les hommes comme les femmes puissent exécuter efficacement le travail de pompier forestier. Au contraire, le test ne semblait pas valable puisque Tawney avait bien fait son travail dans le passé, sans poser de risque apparent pour elle-même, ses collègues ou le public. Même si la condition physique peut faire partie des exigences de l’emploi en question, le test de capacité aérobique ne peut pas mesurer adéquatement la capacité d’une personne à accomplir les tâches de pompier forestier.
Certains ont suggéré que si Tawney était autorisée à conserver son emploi, cela pourrait créer une « discrimination à rebours » : établir une norme moins élevée pour les femmes que pour les hommes serait discriminatoire envers les hommes qui n’ont pas réussi à satisfaire à la norme qui leur était applicable, mais qui ont néanmoins pu satisfaire à la norme applicable aux femmes. La Cour n’était pas d’accord avec ce raisonnement. Elle a soutenu que l’égalité consiste à être traité en fonction de son propre mérite, de ses propres capacités et de sa propre situation. L’égalité véritable doit tenir compte des différences, car un traitement égal nécessite parfois que l’on traite les gens différemment. Ainsi, une norme aérobique moins exigeante permettant de repérer les femmes capables d’exécuter le travail de manière efficace et en toute sécurité ne serait pas nécessairement discriminatoire envers les hommes.
La Cour a jugé que la norme aérobique était discriminatoire envers les femmes. Dans sa défense, le gouvernement a tenté de démontrer, en vain, que la norme était nécessaire à l’exécution sûre et efficace des fonctions essentielles de l’emploi de pompier forestier.
Ainsi, Tawney a été réintégrée dans ses fonctions et le gouvernement a été chargé de trouver une façon non discriminatoire d’évaluer la condition physique des pompiers comme exigence d’emploi.
Étude de cas no 10 : Réjeanne
Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) et Mercier c. Montréal (Ville) (2000), 37 C.H.R.R. D/271 (Cour suprême du Canada)
Il s’agit d’une décision très importante en matière de droits de la personne pour l’Ontario, même si elle a été rendue dans une autre province. Chaque province possède son propre système de protection des droits de la personne, qui est chargé de promouvoir les lois sur les droits de la personne et de les faire appliquer sur son territoire. Les décisions rendues dans une province peuvent orienter les tribunaux des autres provinces qui examinent des affaires similaires. Les décisions rendues par la Cour suprême établissent généralement des précédents dans l’ensemble des provinces et territoires du Canada.
Réjeanne vivait à Montréal et rêvait de devenir horticultrice. Elle a suivi des études collégiales et effectué un stage comme jardinière au Jardin botanique de Montréal. Lorsqu’elle a su que la Ville cherchait un horticulteur, elle a immédiatement posé sa candidature.
Parfaitement qualifiée pour ce poste, Réjeanne a été convoquée à une entrevue qui s’est bien déroulée. Elle a dû ensuite subir un examen médical pour confirmer qu’elle était en mesure capable d’effectuer le travail. L’examen a révélé qu’elle avait une légère déviation de la colonne vertébrale, que l’on appelle scoliose. Réjeanne a été très étonnée d’apprendre cela, puisqu’elle n’avait jamais ressenti de symptôme de ce trouble assez répandu. En fait, elle n’a jamais ressenti de douleur ni éprouvé aucune limitation en raison de sa scoliose. Plus tard, une autre évaluation a démontré que Réjeanne était tout à fait capable d’exécuter les fonctions de jardinière-horticultrice sans mettre en danger sa sécurité ni celle des autres et qu’il n’était pas nécessaire de limiter ses tâches.
Lorsqu’elle a eu connaissance de l’état de santé de Réjeanne, la Ville a décidé d’embaucher un autre candidat qui risquait moins d’avoir des problèmes de dos et qui était donc moins susceptible de faire augmenter les dépenses en soins de santé. Pour justifier sa décision, la Ville a déclaré qu’elle avait le droit et même la responsabilité d’embaucher des individus qui coûteraient le moins cher possible aux contribuables.
Croyant que la Ville avait rejeté sa candidature en raison d’un handicap, Réjeanne a porté plainte devant le Tribunal des droits de la personne du Québec. Réjeanne a accusé la Ville d’avoir agi d’une façon discriminatoire qui l’a privée de prestations d’assurance-chômage, qui lui a causé beaucoup de stress et qui l’a profondément humiliée. La Ville a répondu qu’étant donné que Réjeanne n’avait aucune limitation fonctionnelle, on ne pouvait pas dire qu’elle souffrait d’un handicap en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne (la loi du Québec sur les droits de la personne).
Questions pour amorcer la discussion :
- Selon vous, pour quelles raisons la Ville aurait dû ou n’aurait pas dû embaucher Réjeanne?
- Comme il est possible que Réjeanne ait un jour des problèmes de dos, pensez-vous que la Ville a eu raison de ne pas l’embaucher?
- Pensez-vous que la perception qu’a la société des personnes handicapées a un effet positif ou négatif sur les obstacles auxquels elles sont confrontées?
Éléments de discussion :
Dans le cas de Réjeanne, le tribunal provincial des droits de la personne a rejeté la plainte, s’appuyant sur l’argument de la Ville qui considérait qu’elle avait le droit de choisir les candidats en meilleure santé. Le tribunal a déclaré que, puisque Réjeanne ne semblait pas avoir de limitation fonctionnelle en raison de son état de santé, elle ne pouvait déposer de plainte fondée sur un « handicap » en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
Les avocats de Réjeanne ont porté en appel le jugement du tribunal devant la Cour d’appel du Québec. La Cour d’appel et, par la suite, la Cour suprême du Canada ont annulé la décision du tribunal et ont statué en faveur de Réjeanne. Le raisonnement de la Cour témoigne d’un point de vue, alors nouveau, sur la discrimination : la discrimination exercée en raison d’un handicap et d’autres motifs peut se fonder autant sur la perception, les mythes et les stéréotypes que sur l’existence de limitations fonctionnelles réelles.
On parle aujourd’hui de « handicap perçu » (se reporter à l’annexe 5 : Comprendre la discrimination dans un contexte social – « Construction sociale d’un désavantage ».)
Selon la Cour, la Charte ne définit pas la notion de « handicap ». La Cour a toutefois fait remarquer que, conformément à l’intention des lois sur les droits de la personne, la notion de handicap doit être interprétée de façon large lorsqu’on considère ce qui sera accepté comme plainte ou requête.
Elle a également soutenu que les tribunaux canadiens ont commencé à considérer à la fois l’aspect objectif de certaines exclusions (par exemple, si la personne a réellement un handicap) et la perception subjective et erronée qu’ont les employeurs et les propriétaires sur les limites d’une personne. Ainsi, le terme « handicap » peut désigner l’existence réelle d’une déficience ou la perception qu’une déficience existe. Ce qui importe, c’est l’effet que peut avoir la distinction, la préférence ou l’exclusion sur une personne. La nature, la cause ou l’origine précise du handicap ne sont pas pertinentes.
Par ailleurs, la Cour a souligné que la Charte canadienne des droits et libertés interdit la discrimination fondée sur la possibilité qu’une personne développe un handicap à l’avenir.
Estimant que la Ville avait fait preuve de discrimination envers Réjeanne à cause de son handicap, la Cour a renvoyé l’affaire au tribunal, pour qu’il détermine une réparation. Réjeanne a ainsi obtenu une somme de 102 075,67 dollars, montant qui comprend les pertes de salaire, les intérêts et des dommages-intérêts de 5 000 dollars pour atteinte à l’estime de soi. Le tribunal a par ailleurs ordonné que la Ville de Montréal offre à Réjeanne des heures de travail suffisantes pour qu’elle puisse terminer sa période d’essai dans un délai de 12 mois et chercher ensuite un emploi à temps plein.
Étude de cas no 11 : Alia et Ahmed
Ce cas de figure s’inspire de l’affaire Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général).
De nombreuses personnes sont atteintes de surdité, sont devenues sourdes ou sont malentendantes en Ontario. Pour certains, la langue des signes est leur langue maternelle ou leur moyen de communication préféré. Leur mauvaise connaissance de l’anglais les empêche de communiquer, à moins d’avoir recours à un interprète. D’ailleurs, ces Ontariennes et ces Ontariens ont beaucoup de mal à communiquer de manière efficace et à obtenir un accès équitable aux services et aux emplois.
Alia et Ahmed sont tous les deux sourds de naissance. Ces futurs parents, qui attendaient la naissance de jumeaux, avaient l’habitude de faire eux-mêmes appel à un interprète en langue des signes lors des visites chez le médecin. En l’absence d’un interprète, la communication était souvent une source de frustration pour eux. De plus, une mauvaise communication de renseignements de nature médicale pourrait avoir de graves conséquences.
Alia a accouché un mois avant la date prévue. Elle et son mari se sont alors retrouvés à l’hôpital sans interprète. Ni le médecin traitant ni les infirmières n’arrivaient à communiquer efficacement avec les parents qui se sont sentis isolés et effrayés.
Après leur naissance, les jumeaux ont été transférés dans une autre salle pour observation. À part une note laissée par une infirmière leur indiquant que les jumeaux « allaient bien », Alia et Ahmed n’ont eu aucune autre explication sur l’état de santé des jumeaux.
Dans la plainte qu’ils ont déposée, Alia et Ahmed ont accusé l’hôpital de fournir des services non équitables parce qu’il n’avait pas tenu compte de leurs besoins particuliers. L’hôpital a répondu qu’il était trop difficile de faire venir des interprètes à la dernière minute et qu’il était trop coûteux d’avoir des interprètes de garde 24 heures par jour.
Questions pour amorcer la discussion :
- Si vous étiez dans la même situation qu’Alia ou Ahmed, comment vous sentiriez-vous?
- Qui est chargé de fournir des services d’interprétation en langue des signes dans le secteur public?
- Comment cette plainte serait-elle traitée en vertu du Code?
- Selon vous, est-il déraisonnable que les personnes sourdes s’attendent à ce que des interprètes soient disponibles en cas d’urgence? Et dans les situations non urgentes?
Éléments de discussion :
La Cour suprême du Canada a rendu une décision unanime dans cette affaire : elle a exigé que le gouvernement de la Colombie-Britannique fournisse des services d’interprétation en langue des signes lorsqu’ils sont nécessaires pour assurer une communication efficace au cours de la prestation de services médicaux. En n’offrant pas de tels services, le gouvernement porte atteinte aux droits des personnes sourdes qui ne peuvent pas correctement bénéficier des services de santé sans l’aide d’un interprète. La Cour a jugé que le système de santé est tenu de répondre aux besoins des personnes sourdes en vertu des dispositions sur l’égalité de la Charte des droits et libertés.
La décision rendue dans l’affaire Eldridge a d’importantes conséquences. En plus de garantir aux personnes sourdes les services d’un interprète au cours de visites médicales, la décision établit que les gouvernements ont l’obligation légale d’assurer à toutes les personnes, y compris celles ayant un handicap, un accès équitable aux services publics. Dans des limites raisonnables, on ne doit pas empêcher les personnes handicapées de recourir aux services gouvernementaux, comme les soins de santé, l’éducation et la formation ou les services sociaux, qui sont offerts à tous les citoyens. Les services doivent être entièrement accessibles et tout obstacle qui pourrait empêcher une personne de participer pleinement à la communauté doit être éliminé.
Le gouvernement a fait valoir que la prestation continue de services d’interprétation en langue des signes était trop coûteuse et causait un « préjudice injustifié ». C’est à la personne ou à l’organisme chargé d’adopter les mesures d’adaptation qu’il appartient de prouver l’existence d’un préjudice injustifié. Pour déterminer si oui ou non une mesure d’adaptation crée un préjudice injustifié, il faut prendre en compte les facteurs
suivants : le coût et les risques pour la santé et la sécurité. Dans ce cas de figure, le ministère de la Santé n’a pu prouver que la prestation de services d’interprétation en langue des signes constituerait une menace grave pour les ressources du gouvernement. En fait, les coûts engendrés par le petit nombre d’interprètes nécessaires pour assurer le service n’auraient presque aucune incidence sur le budget total du ministère. Cependant, une petite entreprise pourrait toujours invoquer l’existence d’un « préjudice injustifié ».
Pour évaluer s’il y a oui ou non préjudice injustifié, il faut tenir compte de la taille de l’organisme et de ses opérations, de la nature de ses activités, et de ses capacités financières.
Étude de cas no 12 : Marc
Hall (Tuteur à l’instance de) c. Powers, 2002, CanLII 49475 (ON SC), http://canlii.ca/t/1w3mh
Marc est un jeune homme gai de 17 ans qui fréquente une école secondaire catholique publique. Il souhaite aller au bal de fin d’année avec son petit ami. Le bal de fin d’année sera organisé en dehors de l’école, dans une salle spécialement louée pour l’occasion.
Ne souhaitant pas approuver un comportement contraire aux enseignements de l’église, le directeur de l’école et le conseil scolaire catholique ont interdit à Marc de venir au bal avec un autre garçon. Marc pense qu’il s’agit là d’une violation de ses droits. Il envisage de demander une injonction judiciaire, car le bal aura lieu dans seulement quelques semaines.
Questions pour amorcer la discussion :
- De quel domaine social la requête de Marc relève-t-elle? Sur quel motif prévu par le Code est-elle fondée?
- Dans ce cas de figure, quels sont les droits contradictoires en jeu?
Les questions qui suivent reprennent chaque étape du cadre analytique de conciliation des droits contradictoires de la CODP. Commencez par passer en revue les questions et les éléments qui les suivent. Organisez ensuite une discussion avec la classe pour savoir si ces éléments peuvent vous aider à répondre à la question posée.
1. Les revendications concernent-elles des droits ou intérêts légitimes?
a. À quels droits et/ou intérêts les revendications de chaque partie sont-elles liées? Ces revendications concernent-elles des personnes ou des groupes, ou plutôt le mode de fonctionnement de l’école?
- Marc et son petit ami, qui fréquente une école différente
- Les amis et pairs de Marc qui peuvent être accompagnés d’une personne de sexe opposé
- D’autres élèves LGBT qui auraient souhaité venir au bal accompagnés
- Les parents de Marc et les parents d’autres élèves LGBT qui participent à la vie de l’école et sont heureux que leurs enfants assistent à ce « rite de passage »
- Le personnel de l’école qui a travaillé étroitement avec les élèves et veut les soutenir lors de cette célébration
- Les membres et défenseurs de la communauté LGBT qui n’ont pas pu assister
à leur bal de fin d’année accompagnés d’une personne de même sexe et continuent de faire l’objet de stigmatisation et de discrimination - Le directeur de l’école catholique qui pense que ses fonctions incluent le fait d’imposer un environnement religieux aux activités sociales et parascolaires
- Les membres du conseil scolaire catholique qui pense que leurs fonctions incluent le fait de promouvoir les enseignements religieux par le biais des politiques et des pratiques du conseil
- L’église catholique qui pense que son rôle est d’orienter, sur le plan spirituel,
des politiques et des pratiques du conseil en matière de religion - D’autres élèves, membres du personnel et parents qui désirent maintenir un environnement religieux qui ne fait pas la promotion de l’homosexualité
- D’autres écoles du conseil qui peuvent avoir à traiter des demandes semblables et suivent le déroulement de cette affaire.
b. Quels sont les droits de la personne, les autres droits reconnus par la loi ou les intérêts raisonnables et de bonne foi que les parties pourraient faire valoir?
- Droit de ne pas subir de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, y compris le droit à une atmosphère non empoisonnée en vertu de l’article 1
du Code des droits de la personne de l’Ontario et du paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés sur les droits à l’égalité - Liberté d’expression, alinéa 2b) de la Charte
- Liberté d’association, alinéa 2d) de la Charte
- Limites raisonnables aux droits, art. 1 de la Charte
- Droit à l’éducation de 6 à 18 ans et exigences relatives à l’éducation élémentaire et secondaire en vertu de la Loi sur l’éducation de l’Ontario
- Droit à l’éducation sans discrimination en vertu des articles 2, 13.1 et 13.2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
- Liberté de religion, restreinte uniquement par le besoin de protéger les droits d’autrui, art. 18.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Les activités sociales et parascolaires sanctionnées par l’école peuvent constituer des services de bonne foi et raisonnables de la vie scolaire
- Maintien des droits des écoles séparées (catholiques) en vertu de l’art. 19 du Code des droits de la personne de l’Ontario, de l’art. 29 de la Charte et de l’art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867
- Dispositions de la Loi sur l’éducation et des règlements pris en application de cette loi qui régissent les conseils scolaires catholiques
- Liberté de conscience et de religion en vertu de l’alinéa 2a) de la Charte et de l’article 18.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
c. Les protections liées à ces droits ou à ces intérêts s’appliquent-elles dans ce cas de figure?
Revendication de Marc :
- Les activités sociales et parascolaires ayant lieu en dehors des locaux de
l’école ne constituent pas des éléments centraux de l’enseignement. - Le bal de fin d’année n’est pas un événement religieux ou de nature éducative
et a lieu en dehors de l’école. - Manque de cohérence et diversité des points de vue et des pratiques au sein
de la religion catholique : l’école accepte les élèves homosexuels mais empêche toute activité en lien avec leur sexualité.
Revendication du conseil scolaire catholique :
- Les droits des écoles catholiques incluent le droit du conseil à agir à sa seule discrétion en matière de religion.
- Toutes les activités sanctionnées par l’école, sur son terrain ou ailleurs, doivent promouvoir et respecter les enseignements religieux.
- Les pratiques du conseil scolaire respectent ses politiques, même si l’Église catholique inclut une diversité de points de vue.
2. La situation constitue-t-elle davantage qu’une atteinte minimale aux droits?
Revendication de Marc :
- Contrairement à d’autres élèves, il n’est pas libre de choisir la personne qui l’accompagnera aux activités sociales de l’école et doit assister au bal sans
son petit ami. - Le fait de lui interdire d’amener un petit ami de même sexe nuit considérablement à la nature du bal, qui consiste habituellement à venir accompagné et à danser avec une personne de son choix.
- Marc n’aurait pas l’occasion d’assister à ce « rite de passage » qui célèbre
la fin d’année et la remise des diplômes. - Un traitement différent fondé sur l’orientation sexuelle constitue une atteinte grave à la dignité.
Revendication du conseil scolaire catholique :
- Si elle autorisait les couples de même sexe à assister aux activités sociales et parascolaires, l’école ne pourrait plus promouvoir un environnement scolaire religieux et transmettre un enseignement religieux qui respecte les enseignements de la foi durant les heures d’école.
- Cela aurait des répercussions considérables sur l’église et d’autres écoles catholiques.
Concilier les droits
3. Existe-t-il une solution pour que chacun puisse jouir de ses droits?
Option 1
- Interdire aussi aux élèves non LGBT d’assister au bal de fin d’année accompagnés d’une autre personne.
- Permettre à tous les élèves d’inviter une personne qui ne fréquente pas l’école.
- Exiger que tous les élèves s’abstiennent d’adopter des comportements intimes.
- L’adoption d’une terminologie neutre et de politiques inclusives pourrait aider à éviter la stigmatisation future des personnes en fonction de leur orientation sexuelle.
- Sinon, l’école devrait limiter l’imposition de la politique officielle du conseil scolaire et de la position de l’église aux enseignements religieux au milieu scolaire et aux heures d’école.
- Le conseil pourrait adopter une politique de discrétion absolue sur les invités, |qui ne porterait pas atteinte aux droits des écoles catholiques.
Option 2
- Modifier la politique de l’école/du conseil scolaire afin de ne plus sanctionner, organiser ou financer les bals de fin d’année à titre d’activités scolaires officielles; ce serait désormais aux élèves de planifier ces activités à l’extérieur de l’école, sans soutien officiel de l’école ou du conseil catholique.
4. Si une telle solution n’existe pas, y a-t-il une solution de remplacement adéquate pour l’un des deux droits ou les deux?
Revendication de Marc :
- Permettre à Marc d’assister au bal avec un « invité » de son choix et aux autres élèves de participer avec un « petit copain » ou une « petite copine » de sexe opposé.
Revendication du conseil scolaire catholique :
- Se conformer à toute injonction judiciaire déposée et autoriser Marc à assister au bal avec son « petit ami » cette fois-ci seulement.
- Décider que ce genre d’injonction ne porte pas préjudice aux droits de l’école catholique.
- Examiner de plus près la doctrine de l’église par rapport à la politique de l’école ou du conseil scolaire pour déterminer si les bals de fin d’année se situent au cœur ou à la périphérie des droits des écoles catholiques.
Prendre des décisions
Les décisions prises doivent respecter les lois sur les droits de la personne ainsi que les autres lois, décisions rendues par les tribunaux et principes juridiques, et prendre
en compte les politiques de la CODP.
Revendication de Marc :
- Hall c. Powers, Cour supérieure de justice de l’Ontario 2002 (ordonnance d’injonction permettant à Marc Hall d’assister à son bal de fin d’année accompagné d’une personne du même sexe)
- Smith c. Knights of Columbus, BCHRT 2005 (relativement à la portée des obligations d’un organisme dans ses locaux et en dehors)
Revendication du conseil scolaire catholique :
- Hall c. Powers, Cour supérieure de justice de l’Ontario 2002 (aucun jugement sur les droits des écoles catholiques)
- Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, CSC 1996 (relativement à l’atmosphère empoisonnée)
Au moins un des droits revendiqués doit relever du Code pour faire l’objet d’une requête auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario
Revendication de Marc :
- L’école constitue un « service » en vertu de l’art. 1 du Code.
- La revendication de Marc porte sur l’orientation sexuelle, un motif illicite de discrimination en vertu du Code.
Revendication du conseil scolaire catholique :
- La revendication du conseil scolaire s’appuie sur l’art. 19 du Code. Le paragraphe 19 (1) précise :
« La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à un droit ou à un privilège dont jouissent les conseils d’écoles séparées ou leurs contribuables en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 et de la Loi sur l’éducation relativement aux écoles séparées. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 19 (1). »
Décision de la Cour : La Cour a ordonné au conseil scolaire d’interdire à tout membre du personnel au courant de l’affaire d’empêcher Marc de venir au bal accompagné de son petit ami.
Pour plus de renseignements sur les droits de la personne contradictoires, se reporter à la Politique sur les droits de la personne contradictoires de la CODP, disponible à l’adresse www.ohrc.on.ca/fr/politique-sur-les-droits-de-la-personne-contradictoires, ou au numéro spécial de Diversité canadienne sur la conciliation des droits de la personne, à l’adresse www.ohrc.on.ca/fr/centre_des_nouvelles/un-num%C3%A9ro-sp%C3%A9cial-de-diversit%C3%A9-canadienne-parle-des-droits-de-la-personne-contradictoires.