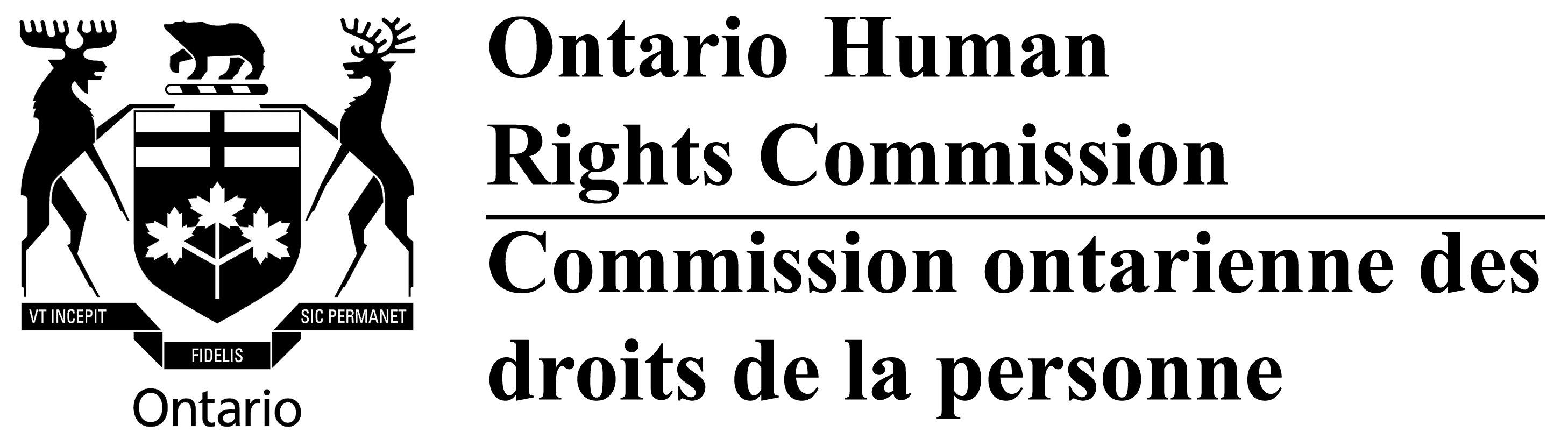Introduction
Nous vivons dans une société de plus en plus diversifiée et complexe, dans laquelle tous les citoyens ont des droits, libertés et obligations. Il est inévitable que ces droits légaux se chevauchent à l’occasion.
Même si les causes traitant de plaintes relatives à des droits de la personne ou droits à l’égalité contradictoires sont relativement rares, les tribunaux ont rendu des décisions qui donnent des indications sur les principes juridiques à mettre en application pour résoudre un litige sur des droits contradictoires. Il n’existe pas de formule préétablie pouvant être appliquée pour trancher ces différends, mais les tribunaux judiciaires, en particulier la Cour suprême du Canada, et les tribunaux administratifs ont mis au point et peaufiné des outils juridiques permettant de concilier des droits qui s’opposent. Il peut s’agir d’opposition entre la liberté d’expression ou de religion et le droit à un procès équitable, ou entre le droit à la protection de la vie privée et le droit à l’accès à l’information dans une instance criminelle ou civile, ou encore entre la liberté de religion et le droit de vivre à l’abri de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou le sexe, pour ne citer que quelques exemples.
La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) a entrepris d’élaborer un cadre de stratégique pour concilier ces droits contradictoires. L’objectif de ce projet est de fournir des pistes d’action aux organismes, parties à un litige, arbitres et autres décideurs sur la façon d’évaluer, de traiter et, éventuellement, de résoudre des plaintes relatives à des droits contradictoires.
Ce document explique le contexte juridique dans lequel s’inscrira le cadre stratégique de la CODP. Il est divisé en deux sections principales. La première présente un survol et un résumé des principes juridiques clés tirés de décisions judiciaires importantes. Cette section a pour but d’aider les lecteurs à comprendre le contexte juridique pertinent au moment de concilier des droits contradictoires, sinon d’opérer un quelconque rapprochement entre ces droits. La deuxième partie du document présente les principales causes traitant de droits contradictoires. Elle offre aussi des exemples de façons dont les tribunaux ont appliqué les décisions rendues dans les causes principales et les principes clés qui en découlent. La section est organisée selon la prévalence des types de conflits opposant des droits. Étant donné l’importance du contexte factuel pour la conciliation des droits, des détails sont fournis sur les circonstances de chaque affaire présentée.
Principes clés
La jurisprudence affirme sans ambiguïté qu'en cas de conflit apparent entre des droits, les principes de la Charte exigent une « conciliation » qui respecte pleinement l’importance des deux catégories de droits concernés. Comme l’indiquait le juge Iacobucci dans son article intitulé « Reconciling Rights: the Supreme Court of Canada’s Approach to Competing Charter Rights »[1], et cité avec l'approbation de la Cour d'appel de l'Ontario[2] :
...Il est approprié pour les tribunaux d'interpréter dans leur sens le plus large tous les droits protégés par la Charte, en tenant compte du contexte factuel ainsi que des autres valeurs constitutionnelles en jeu.
Cependant, la jurisprudence ne précise pas comment effectuer cette « conciliation » des droits. Il n'existe aucune formule ou « règle nette »[3] pour régler un conflit de droits contradictoires. Les décisions des tribunaux ont plutôt établi un certain nombre de principes fondamentaux qui donnent des indications sur l'approche à adopter et les mécanismes à éviter en cas de plaintes relatives à des droits contradictoires[4]. Un grand nombre de ces principes sont abstraits, ce qui procure une certaine souplesse dans le règlement des différends au cas par cas. Il ressort clairement de la jurisprudence que les lois régissant ce domaine sont en constante évolution et que les nouveaux développements sur le plan juridique, comme la récente décision de la Cour d'appel de l'Ontario connue sous le nom de « décision sur le niqab », continuent d’alimenter notre compréhension de la façon de concilier des droits contradictoires[5].
La jurisprudence rappelle constamment le principe selon lequel les droits légaux n'ont pas de caractère absolu et comportent des limites inhérentes découlant des droits et libertés d'autrui[6]. Par exemple, dans le contexte de la liberté de croyance ou de religion, les tribunaux ont conclu que « la liberté de croyance est plus large que la liberté d'agir sur la foi d'une croyance » lorsque cette liberté d’agir empiète sur les droits d'autrui. Autres exemples : limiter le droit à la liberté d'expression garanti par l’alinéa 2(b) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) si cette liberté a pour effet de compromettre le droit à un procès équitable garanti par l'alinéa 11(d) et l'article 7 de la Charte[7], d’inciter à la haine au sens du Code criminel du Canada et de certaines lois sur les droits de la personne[8] ou de causer de la discrimination contre un groupe minoritaire de la société[9].
Il faut également tenir compte du fait qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les droits protégés par la Charte[10]. Les droits méritent tous le même respect et il faut éviter d’adopter une approche qui placerait certains droits au-devant d'autres[11]. Les principes juridiques exigent plutôt de procéder à une pondération des droits en jeu qui respecte l'importance de chacune des catégories de droits[12].
À la lumière de ces principes généraux, les tribunaux juridiques ont formulé des étapes à suivre en situation de conflits de droits. Premièrement, les tribunaux affirment qu'une situation de conflit de droits contradictoires ne peut survenir que si un droit légal existe[13].
Lorsque les faits et les dispositions légales applicables sont isolés clairement et mis en contexte, il se peut que la plainte relative aux droits contradictoires ne soit pas valide sur le plan juridique. Pour établir la validité du conflit sur le plan juridique, il faut se poser deux questions : (1) La plainte porte-t-elle sur un droit légal existant ou la caractérise-t-on ainsi faussement? (2) Après examen des preuves, l'auteur de la plainte peut-il prouver que le droit invoqué s'applique à sa personne[14]?
En ce qui concerne le premier élément de la démarche, à savoir déterminer si la plainte porte sur un droit juridique existant ou si on la caractérise ainsi faussement, les tribunaux des droits de la personne ont étudié et rejeté plusieurs justifications de conduite discriminatoire qui pourraient être caractérisées comme des droits contradictoires. Par exemple, la « préférence du client » ou des « droits commerciaux ou économiques » ne sont pas considérés comme des droits contradictoires valides dans des affaires de discrimination contraire à la législation sur les droits de la personne[15]. De même, dans une décision de la Commission d'enquête de l'Ontario concernant le refus d'une personne de vendre son bien-fonds à une personne racialisée, la notion selon laquelle les gens auraient la liberté, aux termes de l'article 7 de la Charte, de décider à qui vendre leur bien-fonds n'a pas été acceptée. La Commission a conclu que, dans les circonstances de l'espèce, le droit à la liberté n'englobait pas la liberté d’exercer de la discrimination fondée sur un motif interdit dans le contexte d'une vente publique d'un bien privé[16].
Si la plainte porte sur un droit légal, il faut établir si, en fonction des faits de l'espèce, l'auteur de la demande peut démontrer que le droit invoqué s’applique à sa personne. Il pourrait être nécessaire de prouver que la plainte s’inscrit dans le champ d'application du droit, à moins que les circonstances de l’affaire fassent clairement ressortir la présence du droit[17].
R. c. Kapp[18] offre un bon exemple d’une cause entendue par la Cour suprême du Canada dont le droit invoqué pourrait être considéré non applicable. Dans cette affaire, des pêcheurs commerciaux en majorité non autochtones ont allégué une violation de leurs droits à l'égalité en vertu de l'article 15 de la Charte, parce qu'un programme accordait aux membres de trois bandes autochtones des permis de pêche collective pendant une période de 24 heures. La Cour a conclu que même s’il imposait une distinction fondée sur la race, le programme ne créait pas de discrimination en vertu de l'article 15 de la Charte, car il s'agissait d'un programme gouvernemental de type « amélioratif », destiné à établir une égalité réelle en aidant un groupe défavorisé, au sens du paragraphe 15(2) de la Charte. La Cour a souligné le droit collectif des Autochtones à pêcher à des fins alimentaires, sociales et cérémoniales[19].
Bien que les tribunaux n'aient pas étendu ce droit des Autochtones à la pêche commerciale, la Cour a jugé que les revendications relatives aux droits de pêche des Autochtones s’inscrivaient dans l’objectif d’amélioration du programme gouvernemental. La Cour n'a pas accepté l'importance de l'applicabilité de l'article 25 de la Charte, qui stipule que la garantie de certains droits et libertés prévus dans la Charte ne peut s'appliquer d'une façon qui porte atteinte à certains droits des Autochtones, dont les droits découlant de traités et d'autres « droits et libertés » issus de la Proclamation royale ou d'ententes sur des revendications territoriales. La majorité des juges de la Cour ont préféré considérer l'article 25 comme une « disposition servant à interpréter des droits garantis par la Charte qui sont susceptibles d'entrer en conflit ». Toutefois, le juge Bastarache aurait rejeté l'argument reposant sur l'article 15 en se fondant sur l'article 25 de la Charte, donnant en gros préséance à cette disposition sur les autres droits conférés par la Charte.
Une fois que les droits constitutionnels contradictoires ont été établis et décrits, il reste à les définir les uns par rapport aux autres en examinant le contexte sous-jacent à l’origine du conflit apparent[20]. Cette approche contextuelle est indispensable, car les tribunaux ont réitéré à plusieurs reprises que les droits protégés par la Charte et les droits de la personne n'existaient pas en vase clos et qu'ils devaient être analysés en fonction de leur contexte avant que le conflit créé ne soit réglé. Lorsqu'on concilie des droits contradictoires, il faut cerner et comprendre tous les faits et valeurs constitutionnelles en jeu[21]. Cette délimitation de la portée des droits permet d'éviter certains conflits de droits et d'en résoudre d'autres.
Plusieurs facteurs doivent être pris en considération pour délimiter la portée des droits. Il est nécessaire de déterminer si un droit empiète réellement sur un autre droit. Un conflit n'existe qu'en cas d'atteinte réelle à un droit par un autre[22]. La seule reconnaissance des droits d'un groupe (par exemple, la légalisation des mariages entre personnes du même sexe) ne peut pas, en soi, violer les droits d'un second groupe (par exemple, le droit des groupes religieux qui ne reconnaissent pas le droit de personnes de même sexe de se marier), à moins qu'une atteinte réelle n'ait été portée aux droits de quelqu'un (par exemple, des autorités religieuses à qui on demande de célébrer des mariages entre personnes de même sexe). De même, il ne suffit pas de présumer qu'une violation de droits va se produire. Il faut des preuves que la jouissance d'un droit aura un effet préjudiciable sur la jouissance d'un autre droit, et non seulement une présomption non étayée. Par exemple, le fait d’exiger que des étudiants inscrits à un programme d’études en sciences de l’éducation adhèrent à des « normes communautaires » interdisant les « activités homosexuelles » ne signifie pas que ces personnes, une fois diplômées, feront preuve de discrimination ou d'intolérance fondée sur l'orientation sexuelle[23] à l'égard de leurs élèves.
L'étape de délimitation de la portée des droits, par l'examen des faits et des valeurs constitutionnelles en jeu, peut mener à la conclusion que certains droits ne sont pas réellement conflictuels et qu'ils peuvent être conciliés. Par exemple, dans une cause complexe portée devant la Cour suprême et traitant de l'objection de parents témoins de Jéhovah, pour des motifs religieux, à ce qu’on fasse subir à leur nourrisson une transfusion sanguine nécessaire pour le maintenir en vie, une minorité de juges de la Cour ont estimé qu'il n'y avait en réalité aucun conflit entre la liberté de religion des parents et le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de l'enfant, du fait que le droit à la liberté de religion des parents n'englobait pas le droit de prendre des décisions médicales fondées sur la foi susceptibles de porter préjudice à leur enfant[24]. En définissant la liberté de religion sous cet angle, on évitait un conflit entre deux catégories de droits contradictoires. À l’opposé, par contre, la majorité des juges de la Cour ont conclu que la liberté de religion comprenait le droit des parents à élever leurs enfants selon leurs principes religieux et que la pondération entre la liberté de religion des parents et le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de l'enfant relevait de l'article 1 de la Charte. En bout de ligne, la Cour a établi que la restriction des droits parentaux était justifiée en vertu de l'article 1 de la Charte pour protéger l'intérêt véritable de l'enfant et l'importance de protéger les enfants à risque.
Dans d'autres contextes, cependant, lorsque la simple délimitation de la portée des droits ne permet pas de concilier entièrement des droits contradictoires, il devient parfois nécessaire de déterminer le niveau d’empiètement d’un droit sur un autre. Si l’empiètement est mineur ou insignifiant, le droit touché ne va probablement pas bénéficier d'une protection[25].
Si l'empiètement sur le droit est important, il faut procéder à une pondération des droits et prendre la décision de donner la préséance à un droit sur un autre ou de compromettre les deux droits. La loi semble privilégier la primauté d'une catégorie de droits dans des situations où l'atteinte concerne une activité qui serait contraire à l'aspect fondamental des droits d'une autre personne. Par exemple, les tribunaux judiciaires ont établi une distinction entre le fait d’exiger que des autorités religieuses célèbrent des mariages entre personnes de même sexe, une activité contraire à un aspect fondamental de leurs croyances religieuses[26], et le refus d'un exploitant d'entreprise de fournir des services d'impression à un organisme à l’intention des personnes homosexuelles. Dans cette dernière affaire, le tribunal a fait remarquer qu'une entreprise commerciale se trouvait à la « périphérie » de la liberté de religion et, qu'en conséquence, compte tenu des circonstances de l'espèce, les droits religieux devaient céder la place au droit de vivre à l'abri de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle[27].
De plus, malgré la constante confirmation par les tribunaux du droit des personnes d'adhérer librement aux croyances religieuses de leur choix ou d'exprimer leur opinion, les tribunaux ont indiqué clairement qu'il y avait des limites à l'exercice de ces croyances et de cette liberté d'expression si cet exercice niait le droit à l'égalité et au respect de membres d'un groupe minoritaire de la société. Par exemple, les droits religieux et droits à la liberté d'expression ont été limités par le passé lorsque leur exercice a porté une atteinte considérable à la dignité inhérente et à l'égalité des personnes protégées par la législation relative aux droits de la personne, par exemple lorsque les publications d'un enseignant ont été jugées préjudiciables à l'environnement scolaire d’élèves de confession juive[28].
Dans une autre cause, les croyances religieuses de parents n’ont pas été considérées comme un facteur pertinent pour exclure du programme scolaire les discussions sur les familles composées de parents de même sexe. Selon la majorité des juges de la Cour suprême du Canada ayant entendu l’affaire, même si les parents n'ont pas à renoncer à leurs opinions sur les relations entre personnes de même sexe, ces opinions ne justifient pas l’exclusion de certains modèles familiaux légaux du système scolaire, qui doit intégrer les croyances parentales d’une façon qui respecte la diversité et encourage la tolérance à l'école. La Cour suprême semblait indiquer qu’il s’agissait d’un solution raisonnable à l'opposition entre ces deux catégories de droits : « Ce principe est juste envers les deux groupes, en ce qu'il garantit à chacun autant de reconnaissance qu'il peut logiquement exiger tout en accordant aux autres la même reconnaissance. »[29]
En outre, si un conflit a une incidence réelle sur le droit d'une personne accusée d'un acte criminel à une défense pleine et entière, ce droit l'emporte. Le droit opposé devra céder la place, car notre système de justice a toujours considéré que le risque de déclarer coupable un innocent était un élément central des principes de justice fondamentale[30].
La conciliation de droits repose aussi sur l’adoption de compromis potentiels aux deux catégories de droits, décrits récemment par la Cour d'appel de l'Ontario comme des « compromis constructifs ». Ces compromis peuvent « minimiser les conflits apparents (...) et aboutir à une solution qui protège et respecte les deux valeurs opposées »[31]. Pour chercher un compromis, il faut envisager des mesures qui atténuent le préjudice causé à chaque catégorie de droits. Par exemple, dans la décision sur le niqab, le tribunal a suggéré plusieurs mesures qu'un juge pourrait envisager comme accommodements raisonnables de la liberté de religion du témoin et au droit des accusés à une défense pleine et entière. L'effort déployé pour trouver des options de conciliation de droits est semblable à l'effort qu'il faut fournir dans le cadre de l'obligation d'accommodement dans le contexte des droits de la personne. Ainsi, dans Dagenais et d’autres causes semblables, la Cour suprême a ordonné aux tribunaux judiciaires examinant une demande d'interdiction de publication qu'ils trouvent « d'autres mesures raisonnables et efficaces » susceptibles d'atteindre les objectifs importants en jeu. Dans l'affaire O’Connor[32], une affaire opposant le droit d'une victime à la protection de sa vie privée dans des dossiers médicaux au droit de l'accusé à une défense pleine et entière, un compromis a été atteint lorsqu’il a été décidé de soumettre dans un premier les dossiers à l'examen du tribunal.
L'analyse de droits opposés doit aussi tenir compte des défenses légales. La Cour suprême du Canada et d'autres décideurs ont fait remarquer que les dispositions légales sur les droits de la personne qui procurent des défenses à ce qui constituerait autrement de la discrimination peuvent témoigner de l'intention du législateur de concilier des droits contradictoires. Dans Caldwell c. Stewart[33], la Cour suprême du Canada a conclu que la protection offerte aux écoles catholiques par le Human Rights Code de la Colombie-Britannique s'étendait au droit d'un groupe religieux de diriger son école confessionnelle selon ses croyances et pratiques religieuses. En conséquence, même si la décision de ne pas renouveler le contrat d'une enseignante catholique ayant épousé un homme divorcé lors d’une cérémonie civile (ce qui allait à l'encontre des règles de l'Église sur le mariage) aurait autrement été considérée comme discriminatoire, la Cour a reconnu que l'école intimée avait le « droit » de préserver sa base religieuse en employant des enseignants qui acceptent et pratiquent les enseignements de l'Église.
Comme le législateur avait volontairement promulgué une défense pour étendre le droit aux écoles confessionnelles et autres établissements semblables, la Cour a affirmé que la défense ne devait pas être interprétée étroitement : « Tout en imposant des limites à des droits dans les cas où il s'applique, cet article confère et protège également des droits »[34]. Une conclusion semblable a été atteinte en ce qui concerne une disposition similaire dans la Charte des droits et liberté de la personne du Québec. La Cour suprême a établi qu'une défense qui autorisait certaines organisations de nature charitable, politique ou religieuse à établir des distinctions parmi leurs employés avait un double but : conférer des droits à certaines personnes, à savoir le droit à la liberté d'association aux fins d'exprimer des opinions particulières ou de participer à certaines activités, et limiter le droit d'autres personnes de vivre à l'abri de la discrimination dans le domaine de l'emploi[35].
Par conséquent, si une défense des droits de la personne semble reconnaître un droit opposé au droit de vivre à l'abri de la discrimination, il y a lieu de choisir prudemment la méthode d'interprétation des dispositions légales. À cette fin, il faut examiner soigneusement le libellé de la disposition pertinente (tant la version anglaise que la version française), l'objet de la loi et l'intention du législateur (ce qui pourrait inclure un examen de l'historique législatif de la disposition). Enfin, la personne qui interprète cette disposition doit analyser son but. Si elle arrive à la conclusion que ce but est double, à savoir reconnaître les droits de certaines personnes tout en limitant les droits d'autres personnes, elle doit éviter une interprétation étroite de la disposition[36]. Néanmoins, la personne ou l'organisme qui souhaiterait faire valoir une disposition d'exemption devra démontrer que la situation remplit les critères établis par la disposition[37].
Décisions judiciaires traitant de droits contradictoires
Vous trouverez aux pages suivantes une analyse exhaustive de la jurisprudence traitant de la conciliation d’une variété de droits et d’intérêts qui ont été opposés l’un à l’autre. Cette analyse inclut une description complète du contexte factuel de certaines affaires, dont il est essentiel de bien comprendre le dénouement. Bien que les affaires présentées aux pages suivantes soient ordonnées selon la prévalence de l’opposition des droits dont elles traitent, bon nombre des principes clés qu’elles établissent on une application universelle, sans égard à la combinaison particulière de droits à l’origine du conflit, comme l’indique la section Principes clés.
Liberté d’expression, procès équitable et administration de la justice
Bien que les questions de liberté d’expression, de procès criminel équitable et d’administration de la justice puissent ne pas sembler avoir directement trait aux droits fondamentaux garantis par les lois sur les droits de la personne, nous devons l’une des décisions les plus importantes en matière de droits contradictoires à un conflit opposant ces questions.
Dans Dagenais c. Société Radio-Canada[38], la Cour suprême du Canada a mis de l’avant un cadre en vue de concilier liberté d’expression et droit à un procès équitable. La Cour a établi plusieurs principes clés qui ont depuis été appliqués à une variété de plaintes relatives à des droits contradictoires.
Dans cette affaire, la Cour a dû se prononcer sur le bien-fondé d’une décision rendue par un tribunal judiciaire inférieur qui interdisait à la Société Radio-Canada de diffuser une minisérie présentant le récit fictif de mauvais traitements physiques et sexuels infligés aux élèves d’une école catholique pour garçons de Terre-Neuve durant le procès de sept membres d’un ordre religieux catholique, accusés de sévices physiques et sexuels à l’endroit de jeunes écoliers de l’Ontario. La demande d’interdiction de publication soumise au tribunal exigeait un juste équilibre entre les droits constitutionnels clés qui sont la liberté d’expression (alinéa 2(b) de la Charte) et le droit à un procès équitable (alinéa 11(d)).
La Cour suprême a confirmé que tous les droits avaient le même statut au regard de la loi et qu’aucun droit n’était plus important que les autres.[39]
Il faut se garder d’adopter une conception hiérarchique qui donne préséance à certains droits au détriment d’autres droits, tant dans l’interprétation de la Charte que dans l’élaboration de la common law. Lorsque les droits de deux individus sont en conflit, comme cela peut se produire dans le cas d’une interdiction de publication, les principes de la Charte commandent un équilibre qui respecte pleinement l’importance des deux catégories de droits.
.
Au moment de reformuler l’approche adoptée en matière d’interdiction de publication dans le contexte du procès criminel, la Cour suprême a fait appel à une approche contextuelle qui exigeait de tenir compte des faits afférents à l’affaire, en plus de concilier droit à la liberté d’expression et droit à un procès équitable. La Cour a aussi souligné l’importance de déterminer s’il existait d’autres mesures pouvant atteindre les objectifs de l’interdiction de publication.
La Cour a déterminé que l’interdiction de publication ordonnée par le tribunal judiciaire inférieur dans cette affaire ne pouvait pas être maintenue. Bien qu’elle ait clairement eu comme but d’éviter de causer un préjudice réel et considérable sur le plan de l’équité du procès, l’interdiction de publication était trop vaste. Elle interdisait la diffusion non seulement de la minisérie à l’échelle du Canada, mais également de tout reportage sur l’interdiction de publication elle-même. De plus, il aurait été possible d’obtenir les mêmes résultats à l’aide d’autres mesures, qui ne portaient pas à ce point atteinte au droit à la liberté d’expression.
Dans une décision subséquente, R. c. Mentuck,[40] la Cour suprême a modifié le critère énoncé dans Dagenais pour l’adapter à un contexte différent. Mentuck traitait de la question de l’administration de la justice, plutôt que du droit de l’accusé à un procès équitable. Dans le cadre de cette affaire, la Couronne a demandé une interdiction de publication afin de protéger l’identité d’agents de police et d’assurer l’efficacité des infiltrations policières. Les médias et l’accusé s’opposaient à l’interdiction de publication. Le juge de première instance a accordé une interdiction de divulgation de l’identité des agents de police d’une durée d’un an, mais a refusé d’interdire la divulgation des méthodes utilisées par les services policiers pour effectuer leurs infiltrations.
La Cour suprême a souligné que les faits soulevés dans cette affaire « mettent cependant en jeu un objet et des droits différents de ceux que soulevaient les faits dans Dagenais (...) Par conséquent, l’application littérale du critère énoncé dans Dagenais ne permet pas de bien tenir compte des droits à pondérer. »[41] La Cour a donc reformulé le critère énoncé dans Dagenais pour mieux reconnaître la capacité des interdictions de publication de faire intervenir d’autres droits et intérêts que les seuls droits à un procès équitable ou à la liberté d’expression. La Cour a également rappelé l’importance de tenir compte du contexte factuel particulier de l’affaire pour établir un juste équilibre entre les droits et intérêts en jeu[42]:
Il vaut également la peine de répéter que les droits et intérêts pertinents se situent différemment les uns par rapport aux autres dans des cas différents, et il faut prendre en considération au cas par cas les objets et les effets que les parties invoquent.
La Cour suprême était en accord avec le juge de première instance, selon lequel l’interdiction de publication de l’identité des agents de police était nécessaire pour éviter de causer un préjudice grave à la bonne administration de la justice, tandis qu’une interdiction de publication des détails de l’opération d’infiltration ne l’était pas.
La Cour suprême a de nouveau pris en compte l’analyse de l’affaire Dagenais relativement à la demande d’ordonnances de confidentialité dans le contexte de procédures judiciaires. Dans Sierra Club du Canada c. Canada (ministre des Finances)[43], la Cour s’est prononcée sur une demande d’ordonnance de confidentialité demandée par Énergie atomique du Canada Limitée (EACL) relativement à des documents contenant des renseignements commerciaux très délicats. Les tribunaux inférieurs avaient refusé d’octroyer l’ordonnance de confidentialité. Encore une fois, la Cour suprême a appliqué les critères de Dagenais au contexte particulier de la liberté d’expression et de la tenue de procédures judiciaires publiques et faciles d’accès. Cette fois-ci, elle a déterminé qu’une ordonnance de confidentialité devait être rendue. La divulgation de documents confidentiels imposerait un risque grave pour un important intérêt commercial d’EACL et il n’existe pas d’autres mesures raisonnables de remplacement au fait de délivrer l’ordonnance.
Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (« TDPO ») a appliqué Dagenais et d’autres décisions traitant de demandes d’ordonnance de confidentialité et d’interdictions de publication dans le contexte de procédures touchant les droits de la personne. Dans le contexte des droits de la personne, on fait typiquement la demande de telles ordonnances pour protéger la vie privée des parties ou participants aux procédures judiciaires, assurer la tenue d’un procès équitable, protéger l’intégrité des processus du TDPO et promouvoir l’accessibilité au système de droits de la personne[44]. À l’instar des tribunaux judiciaires, le TDPO a exigé que lui soient présentés des motifs suffisants pour justifier l’interdiction de publication, fondés sur des renseignements factuels et accompagnés de preuves à l’appui[45]. De plus, le TDPO a pris en considération chaque demande à la lumière du contexte factuel particulier de l’affaire, a concilié droit à la liberté d’expression et d’autres intérêts visés par la demande d’interdiction de publication et a tenté de limiter le plus possible les répercussions sur les droits de la personne :
Compte tenu du critère établi dans Dagenais, précité, il m’appert qu’une interdiction de publication qui empêche uniquement la divulgation de l’identité du requérant sans compromettre d’aucune autre façon le caractère public du procès ou la capacité des médias de faire rapport sur l’affaire atteint un équilibre approprié entre les intérêts évidents du requérant en matière de vie privée et de dignité, et le droit des membres du public de connaître les faits entourant l’affaire. Outre la mise en œuvre de l’interdiction de publication, je ne vois "d’autres mesures raisonnables et efficaces" pouvant atteindre les importants objectifs cernés. Il me semble que l’interdiction de publication partielle demandée est aussi limitée que possible tout en atteignant les objectifs escomptés, et qu’il y a proportionnalité entre les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’interdiction.[46]
Vie privée, défense pleine et entière et égalité
Bon nombre de décisions traitant de la production de dossiers contenant des renseignements médicaux ou autrement délicats dans le contexte de procédures devant des tribunaux judiciaires ou administratifs ont traité de la relation entre les droits à la vie privée et à l’égalité, et le droit à une défense pleine et entière. De façon similaire, les décideurs ont dû concilier intérêts en matière de vie privée et droits de la personne au moment de déterminer la façon de donner suite aux demandes de production de dossiers personnels pouvant être utiles pour établir s’il y a eu discrimination ou harcèlement, en contravention des mesures législatives sur les droits de la personne.
Dans R. c. O’Connor[47], la Cour suprême du Canada a établi une procédure visant à déterminer quand le dossier médical et thérapeutique d’une victime, en la possession d’une tierce partie comme un médecin, doit être transmis à un accusé pour assurer sa défense pleine et entière[48]. La majorité des juges de la Cour ont établi une méthode en deux étapes dans le cadre de laquelle l’accusé (ou la personne demandant la production des documents) doit en premier faire la preuve que l’information recherchée sera probablement pertinente. S’il est établi qu’elle sera probablement pertinente, les dossiers sont transmis au juge ou au décideur, qui les examinera et déterminera s’ils doivent être soumis à la personne en ayant fait la demande. Au moment de concilier les droits contradictoires en jeu, les décideurs doivent examiner la portée des droits dans leur contexte, par exemple en considérant entre autres le degré d’importance du dossier pour assurer à l’accusé une défense pleine et entière, la nature et l’étendue de l’attente raisonnable de confidentialité des dossiers, la possibilité que la divulgation du dossier repose sur un préjugé ou une croyance discriminatoire, et le risque de préjudice à la dignité, à la vie privée ou à la sécurité de la personne découlant de la production de son dossier médical.
Après la décision O’Connor, le Parlement fédéral a modifié le Code criminel pour y prévoir un processus touchant la production de dossiers dans le cadre de procès pour agression sexuelle qui soit différent de l’approche adoptée dans O’Connor. Puis, dans R. c. Mills, la Cour suprême du Canada a pris en considération une contestation de ces dispositions fondée sur la Charte. La Cour a mené un examen complet de la portée contextuelle des droits et des principes en jeu, notamment les droits à une défense pleine et entière, à la vie privée et à l’égalité.
La Cour suprême a fait remarquer qu’aucun droit ne pouvait être défini d’une manière qui en annule un autre et « [a]ucun de ces principes n’est absolu et n’est susceptible de l’emporter sur les autres; tous doivent être définis à la lumière de revendications opposées. »[49] La notion selon laquelle aucun droit n’a préséance sur d’autres droits est un autre principe important de l’examen de revendications de droits contradictoires.
La Cour a repris le cadre énoncé dans Dagenais, notamment pour établir un juste équilibre qui respecte pleinement l’importance des deux catégories de droits. La Cour a de nouveau souligné l’importance d’utiliser l’approche contextuelle de conciliation des droits :
Cela montre l’importance de donner aux droits une interprétation fondée sur le contexte – non pas parce qu’ils ont une importance sporadique, mais parce qu’ils sous-tendent ou s’inspirent souvent d’autres droits ou valeurs aussi louables qui sont en jeu dans des circonstances particulières.[50]
La Cour a examiné en détail les principes et droits pertinents, en portant une attention toute particulière au contexte, et a conclu que la portée du droit à une défense pleine et entière doit être déterminée à la lumière des droits à l’égalité et à la vie privée des appelants et témoins. Elle a souligné que le poids à attribuer aux intérêts à protéger doit être établi au cas-par-cas. En bout de ligne, si la non-divulgation des dossiers d’une tierce partie empêche la défense pleine et entière de l’accusé, les droit de l’accusé doivent l’emporter, étant donné que le risque de déclarer coupable une personne innocente frappe au cœur même du principe de justice fondamentale[51].
Dans R. c. McNeil[52], la Cour suprême du Canada a de nouveau confirmé le rôle de la l’approche O’Connor pour examiner le bien-fondé d’ordonner la production de dossiers d’une tierce partie. La Cour a souligné que la première étape de l’approche O’Connor consistait à démontrer la « pertinence probable » des dossiers dans le cadre de l’instance en cour. La deuxième étape consiste à concilier les intérêts contradictoires que soulèvent les circonstances particulières de l’affaire. Mises à part quelques exceptions, la Cour a noté que le droit à une défense pleine et entière lors de poursuites criminelles a préséance sur tout intérêt contradictoire lié à la vie privée. Cependant, il demeure important de prendre des mesures pour minimiser l’incidence sur la vie privée, par exemple en veillant à ce que seule l’information pertinente soit produite et qu’elle soit transmise à un nombre limité de personne uniquement.
Des considérations similaires ont été à l’origine de décisions éclairées relatives à la production de dossiers et aux droits à la vie privée et à l’égalité dans les contextes des droits civils et droits de la personne. Dans M. (A.) c. Ryan, la Cour suprême du Canada s’est demandé si, lors de poursuites pour dommages au civil, le droit du défendeur d’obtenir des documents pertinents lui permettant de répondre d’accusations devrait avoir préséance sur les intérêts relatifs à la vie privée et à l’égalité de l’appelant. En tenant de nouveau compte du contexte, la Cour a souligné que, contrairement aux poursuites criminelles où ce qui est en jeu est leur liberté, les défendeurs dans des affaires civiles risquent de perdre de l’argent ainsi que leur réputation, mais pas leur liberté. Leurs intérêts peuvent donc connaître un sort différent lorsqu’on applique l’approche de conciliation des droits et qu’on les examine à la lumière des intérêts relatifs à la vie privée des appelants. « Par conséquent, l’équilibre entre le droit à la divulgation du défendeur et le droit à la vie privée de l’appelant peut différer selon qu’il s’agit d’une affaire civile ou d’une affaire criminelle; il se peut que des documents produits dans une affaire criminelle ne puissent pas être produits dans une affaire civile où le droit à la vie privée de l’appelant peut plus facilement l’emporter sur le droit à la production de dossiers du défendeur. »[53]
Le TDPO a opposé les intérêts contradictoires que sont le droit à la vie privée, d’une part, et la capacité de déposer une plainte pour discrimination ou de défendre pleinement ou entièrement une telle plainte, de l’autre. Face à des demandes de production d’information délicate, comme des dossiers médicaux ou dossiers d’emploi, le TDPO a dû se pencher sur les mêmes « intérêts contradictoires » que les tribunaux judiciaires dans les affaires présentées précédemment. Jusqu’à présent, le TDPO n’a établi aucune procédure à suivre dans toutes les affaires soulevant ce genre de question. Dans bon nombre d’affaires, cependant, et en particulier quand les intérêts relatifs à la vie privée associés aux dossiers en jeu sont considérables, le TDPO a adopté l’approche O’Connor comme meilleur moyen d’établir le juste équilibre entre les droits à la vie privée d’une partie et l’intérêt d’une autre relativement à la production de dossiers pour déterminer s’il y a eu contravention des droits d’une personne prévus dans le Code des droits de la personne[54].
Liberté de religion et défense pleine et entière
Dans le contexte du droit criminel, un ensemble de circonstances particulières a donné à la Cour suprême du Canada l’occasion de se pencher sur un apparent conflit entre le droit constitutionnel à la liberté de religion d’un témoin dans un procès criminel et le droit constitutionnel de l’accusé à une défense pleine et entière. La Cour suprême s’apprête à entendre, en décembre 2011, l’appel interjeté dans l’affaire R. c. N.S. (la décision sur le niqab).
Le témoin, N.S.[55] est une victime présumée d’agressions sexuelles répétées. Il s’agit aussi d’une femme musulmane qui, selon ses croyances religieuses, doit porter un voile (aussi appelé niqab) lui recouvrant le visage à l’exception des yeux au moment de témoigner en cour. Les deux accusés, un oncle et un cousin, plaident que le fait de lui permettre de témoigner contre eux le visage recouvert compromettrait leur droit à un procès équitable. Dans sa décision, la Cour d’appel de l’Ontario a établi un processus à suivre par le décideur, dans le cas présent un juge chargé d’une enquête préliminaire, afin de déterminer comment concilier les droits complexes en jeu.
Avant que ne débute toute analyse constitutionnelle, la Cour d’appel a souligné « l’importance de se rappeler ce qui est en jeu sur le plan humain »[56]. La Cour a donné un aperçu de la très réelle incidence que pourrait avoir sur la partie adverse les droits protégés par la Charte de chaque partie. Devant cette apparente « collision » de droits, la Cour a réitéré plusieurs principes clés tirés de décision précédentes, notamment : le tribunal doit (1) tenter de concilier les droits de chacun de façon à ce que chacun maintienne son plein effet dans le contexte approprié; (2) ne pas considérer comme absolu les droits protégés par la Charte; (3) ne pas considérer un droit comme étant intrinsèquement supérieur aux autres (4) ne pas examiner des droits de manière abstraite sans tenir compte du contexte factuel spécifique.. Au moment de souligner l’importance du contexte, la Cour a fait remarquer ce qui suit : « La conciliation de valeurs contradictoires prévues dans la Charte doit nécessairement s’effectuer au cas par cas. Le contexte est d’une importance capitale et le contexte est variable. Il n’existe pas de règle simple et claire. »[57]
Dans un premier temps, la Cour a décrit le droit à un procès équitable soulevé par la demande de N.S. de pouvoir témoigner le visage recouvert. La Cour a fait remarquer qu’on ne mesure pas le caractère équitable d’un procès de la seule perspective de l’accusé, mais aussi en tenant compte de l’intérêt plus général de la société relativement à l’obtention de verdicts justes, qui respectent la dignité de toutes les parties concernées. Le contre-interrogatoire de témoins dont le visage est recouvert pourrait compromettre le caractère équitable des procès en réduisant la capacité des juges d’évaluer le comportement des témoins, ce qui sert à mesurer leur crédibilité et la fiabilité de leur preuve. Le recouvrement du visage pourrait également réduire la capacité des personnes chargées de mener les contre-interrogatoires de questionner efficacement les témoins en faisant en sorte qu’elles ne puissent réagir aux messages non verbaux des témoins, comme les expressions du visage. En bout de ligne, c’est un examen des faits spécifiques d’une affaire et autres intérêts légitimes en cause qui déterminera si un accusé à qui on refuse le droit de voir le visage d’un témoin perd son droit constitutionnel à une défense pleine et entière.
Dans un deuxième temps, la Cour s’est penchée sur les droits religieux du témoin, aux termes de l’alinéa 2(a) de la Charte, et a souligné que la liberté de religion a une portée vaste, et intervient lorsqu’une personne croit sincèrement à une pratique ayant un lien avec ses croyances religieuses, et que cette pratique fait l’objet d’une entrave non négligeable et non insignifiante. La Cour a aussi fait remarquer que la protection accordée aux croyances religieuses est plus complète que la protection accordée aux gestes posés en raison de ces croyances. Un témoin qui demande d’exercer une pratique religieuse au moment de témoigner devra faire la preuve que la pratique religieuse en question relève du droit à la liberté de religion, habituellement en témoignant du lien qui existe entre la pratique et ses croyances religieuses sincères.
Ayant jeté les bases, la Cour d’appel a ensuite établi l’approche à adopter pour concilier les droits en jeu. Tout tribunal judiciaire devant rendre une décision concernant des droits contradictoires de cette nature devrait commencer par déterminer si les valeurs constitutionnelles à l’origine des deux revendications de droits entrent réellement en jeu dans la présente affaire. Cette évaluation doit reposer sur des faits. S’il est satisfait que le témoin a mis de l’avant une revendication valide sur le plan du droit à la liberté de religion, mais que sa pratique religieuse, dans le cas présent le droit au port du niqab, porterait une atteinte non négligeable et non insignifiante à la capacité des accusés de le contre-interroger, le juge doit tenter de concilier ces deux droits en les appliquant tout les deux. À ce stade, le contexte revêt une importance particulière. Au nombre des considérations pertinentes en matière de contexte figurent le degré d’entrave à l’évaluation du comportement du témoin, l’habileté du juge de surmonter cet obstacle en donnant des directives appropriées au jury lors de procès criminels, la nature de l’instance, la nature de la preuve que doit soumettre le témoin et la nature de la défense. L’analyse du contexte exige aussi que le tribunal tienne compte d’autres valeurs constitutionnelles et intérêt sociétaux, dont le droit à l’égalité des femmes, l’élimination des stéréotypes négatifs à l’endroit des musulmans, l’accès à la justice et la confiance des membres du public envers le système judiciaire.
La Cour a aussi laissé entendre que l’exercice de conciliation comprenait une importante composante procédurale. La démarche suivie par le tribunal et les motifs de la décision du juge jouent un rôle important et deviennent partie intégrante de la conciliation.
Si une personne a la pleine possibilité de présenter sa position et si elle reçoit une explication raisonnable de la conduite à adopter, la reconnaissance offerte aux droits de cette personne dans le cadre du processus proprement dit a tendance à valider la revendication de cette personne, même si la décision ultime ne donne pas à cette personne tout ce qu’elle veut.[58]
Le processus de conciliation doit également tenir compte des "compromis constructifs" possibles. Cela inclut le fait de chercher des moyens de réduire l’incidence possible sur l’une ou les deux catégories de droits. Cependant, la Cour a reconnu que les efforts déployés en vue de concilier les droits du témoin et des accusés peuvent, en bout de ligne, ne pas porter des fruits. Si le juge conclut que le port du niqab dans toutes les circonstances ferait entrave au droit à une défense pleine et entière des accusés, le droit à une défense pleine et entière doit avoir préséance sur les droits religieux du témoin et il doit être ordonné au témoin de retirer son niqab[59]. Cela est dû au fait que notre système de justice a toujours considéré que le risque de déclarer coupable un innocent était un élément central des principes de justice fondamentale.
La Cour a donc reconnu que, malgré le besoin de traiter équitablement les différents droits au début du processus, un droit peut devoir céder la place à un autre si la conciliation devient impossible même au moyen de compromis constructifs. Dans de tels cas, il est nécessaire de choisir lequel des droits revêt l’importance la plus fondamentale dans notre société, selon les faits présentés.
La Cour suprême du Canada a accordé le droit de faire appel de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario. Par conséquent, elle aura bientôt l’occasion de commenter l’approche relative aux droits contradictoires adoptée, ou de la réviser.
Liberté d’expression et droits de la personne/ à l’égalité
La tension croissante entre la liberté d’expression (qu’on pourrait dans certaines circonstances lier à la liberté de religion) et les droits à l’égalité continue d’être source de grande controverse. La liberté d’expression, qu’on appelle parfois libre expression, est un droit fondé sur les libertés civiles individuelles décrit comme l’un des piliers de la démocratie moderne.[60] La Cour suprême du Canada a reconnu à plusieurs reprises l’importance fondamentale de la liberté d’expression pour promouvoir l’épanouissement personnel, le partage d’idées et d’opinions variées et la participation à la vie sociale et politique. C’est pourquoi, au cours des dernières années, la tendance a voulu qu’un plus grand souci soit accordé à la protection de la liberté d’expression. En même temps, cependant, la liberté d’expression n’est pas absolue et peut se voir limiter par d’autres droits au sein d’une société libre et démocratique[61], y compris le droit de vivre à l’abri de la discrimination. Au cours des 20 dernières années, différentes décisions ont traité de la nature des limites à imposer, dont un appel interjeté auprès de la Cour suprême du Canada qui sera entendu en octobre 2011 et portera une fois de plus sur cette question épineuse.
Dans sa décision de 1990 intitulée Commission canadienne des droits de la personne c. Taylor[62], la Cour suprême du Canada a entendu une contestation constitutionnelle d’une disposition de la Loi canadienne sur les droits de la personne qui interdit la communication de messages téléphoniques susceptibles d’exposer des personnes identifiables sur la base d’un motif de discrimination interdit, dans ce cas des personnes juives, à de la haine et du mépris. La question était de déterminer si la disposition violait le droit à la liberté d’expression que confère l’alinéa 2(b) de la Charte. La majorité des membres de la Cour suprême ont jugé que la disposition imposait une limite raisonnable au droit à la liberté d’expression. Selon la Cour, cette limite est appropriée tant que la disposition permet uniquement de taire les messages haineux qui « ne visent que des émotions exceptionnellement fortes et profondes de détestation se traduisant par des calomnies et la diffamation (...) », soit l’expression dans sa forme la plus extrême. Cependant, un jugement dissident rédigé par la juge McLachlin (nommée depuis juge en chef) laissait entendre que l’article n’imposait pas de limite raisonnable en raison de sa portée trop large susceptible d’empêcher plus de conduites d’expression que n’en justifieraient les objectifs, par exemple en interdisant l’expression de propos pouvant être pertinents dans le cadre de débats sociaux ou politiques.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un cas de contravention présumée d’une loi sur les droits de la personne, la Cour suprême a rendu publique sa décision dans R. c. Keegstra[63] en même temps que sa décision Taylor. Dans Keegstra, la Cour a longuement traité de l’importance de la liberté d’expression, d’une part, et de la protection contre la discrimination à l’endroit des minorités et des groupes marginalisés, de l’autre. Des accusations ont été portées contre M. Keegstra en vertu des dispositions sur la propagande haineuse du Code criminel. La Cour a rejeté l’idée de restreindre la portée des droits protégés par l’alinéa 2(b) en y opposant les droits à l’égalité. Selon elle, c’est plutôt au moment d’examiner si la violation des droits de M. Keegstra, aux termes de l’alinéa 2(b), est justifiée aux termes de l’art. 1 de la Charte qu’il y a lieu de prendre en considération les divers facteurs contextuels comme le préjudice causé par la propagande haineuse, les ententes internationales interdisant les propos racistes desquelles le Canada est signataire et les autres droits protégés par la Charte comme les droits à l’égalité prévus à l’article 15. Dans le cadre de cette analyse, il a été facile de justifier les restrictions appliquées à la propagande haineuse en raison de la nature de l’expression :
Je suis d’avis que la propagande haineuse apporte peu aux aspirations des Canadiens ou du Canada, que ce soit dans la recherche de la vérité, dans la promotion de l’épanouissement personnel ou dans la protection et le développement d’une démocratie dynamique qui accepte et encourage la participation de tous. Bien que je ne puisse conclure que la propagande haineuse ne mérite qu’une protection marginale conformément à l’analyse de l’article 1, je peux prendre conscience du fait que les limites imposées à la propagande haineuse visent une catégorie particulière d’expression qui s’éloigne de l’esprit de l’alinéa 2(b) et, par conséquent, conclure « qu'il se pourrait que des restrictions imposées à des expressions de ce genre soient plus faciles à justifier que d'autres atteintes à l’alinéa 2(b) ».
En bout de ligne, une faible majorité des juges de la Cour suprême ont respecté la loi[64].
Plusieurs années plus tard, dans Ross c. New Brunswick School District No. 15[65], la Cour suprême s’est penchée sur une situation opposant la liberté de Malcolm Ross de s’exprimer et d’exprimer ses croyances religieuses au moyen de commentaires et de publications antisémites, et le droit de vivre à l’abri de la discrimination d’élèves juifs et issus d’autres minorités. La Cour suprême a confirmé à l’unanimité les conclusions d’une commission d’enquête sur les droits de la personne, selon lesquelles les propos antisémites formulés par Malcolm Ross dans ses temps libres avaient nui à sa capacité de remplir ses fonctions d’enseignant, et établi que la commission d’enquête avait eu raison de conclure que son maintien en poste à titre d’enseignant constituait un cas de discrimination en matière d’éducation publique. La Cour a également déterminé que le remède à la situation ordonné par la commission d’enquête, qui comprenait le retrait de Malcolm Ross de la salle de classe, avait bel et bien contrevenu à son droit à la liberté d’expression. Le remède était cependant justifié aux termes de l’article 1, à l’exception de la partie de l’ordonnance corrective qui exigeait que le conseil scolaire mette immédiatement fin à son emploi de non-enseignant s'il publiait, vendait ou produisait des écrits antisémites dans l’avenir[66].
En concluant que le remède contrevenait aux droits à la liberté d’expression, la Cour suprême a confirmé la portée et l’importance de la garantie de liberté ou de libre expression, sans égard à l’impopularité du point de vue exprimé, ou à sa répugnance.
La Cour a aussi pris en compte l’argument selon lequel la décision de la commission avait également enfreint le droit à la liberté de religion de Malcolm Ross étant donné que ses écrits, propos et publications exprimaient ses opinions religieuses. La Cour a fait remarquer que, bien que le droit à la liberté de religion garantisse à chaque personne la liberté d’embrasser et de professer des croyances sans ingérence de l’État :
Cette liberté n'est toutefois pas absolue, étant restreinte par le droit des autres personnes d'embrasser et de professer leurs propres croyances et opinions, et de ne pas être lésées par l'exercice de la liberté de religion d'autrui. La liberté de religion est soumise aux restrictions nécessaires pour préserver la sécurité, l’ordre, la santé ou les mœurs publics ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui[67].
Néanmoins, la Cour suprême a fait remarquer que, plutôt que de formuler des limites internes à la liberté de religion garantie par la Charte, il était préférable de prévoir une interprétation plus large de ce droit, et de fonder la conciliation des droits contradictoires sur l’analyse faite en vertu de l’article 1 dans R. c. Oakes[68].
En appliquant l’analyse menée dans Oakes pour déterminer s’il était possible de justifier la contravention des droits de Malcolm Ross prévus aux alinéas 2(a) et 2(b), la Cour a de nouveau souligné l’importance de mener une analyse contextuelle reposant sur la pondération des valeurs et principes essentiels. Cela inclut l’accommodement d’une grande diversité de croyances, d’une part, ainsi que le respect de chaque culture et de chaque groupe, la foi dans les institutions sociales qui favorisent la participation des particuliers et le respect de la dignité humaine, de l’autre.
Dans une affaire similaire, la conduite d’un enseignant de la Colombie-Britannique dans ses temps libres a donné lieu à une instance disciplinaire, menée contre lui par le British Columbia College of Teachers (BCCT). En raison d’articles et de lettres qu’il avait fait parvenir au rédacteur en chef du journal local à des fins de publication, et dans lesquels il exprimait son point de vue à l’endroit de l’homosexualité, M. Kempling a été trouvé coupable de conduite indigne d’un membre du BCCT. Parmi les autres mesures disciplinaires adoptées contre lui, le collège lui a retiré son certificat d’enseignant pendant un mois. M. Kempling a interjeté appel de la décision devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique puis devant la Cour d’appel, arguant qu’on avait violé les droits que lui confère la Charte, y compris le droit à la liberté de religion, le droit à la liberté d’expression et les droits à l’égalité. La Cour d’appel en a jugé autrement. En tenant compte du contexte dans son entier, et en particulier des écrits du plaignant, la Cour a jugé non seulement que ses écrits étaient discriminatoires, mais également qu’ils étaient liés à son poste d’enseignant et qu’ils démontraient que le plaignant était déterminé à assumer ses obligations publiques et professionnelles de façon discriminatoire et intolérante. Ces propos minaient la valeur fondamentale de non-discrimination inhérente au système d’éducation public.
Quant aux droits protégés par la Charte de M. Kempling, la Cour d’appel a conclu qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de sa revendication en matière de liberté de religion. Il n’y avait aucune information concernant la religion et les principes de M. Kempling, et aucune preuve à l’appui du fait que sa capacité de pratiquer sa religion serait de quelque façon compromise si on limitait son droit de formuler des propos discriminatoires en public. Ses droits à l’égalité n’étaient pas touchés parce qu’il n’a pas été traité différemment que les autres enseignants. Enfin, en ce qui a trait à l’alinéa 2(b), la Cour a accepté qu’on ait enfreint le droit à la liberté d’expression de M. Kempling, mais a jugé que cela ait été justifié aux termes de l’article 1 de la Charte.
La Cour a souligné que la conciliation des droits contradictoires en jeu doit reposer sur une analyse menée en vertu de l’article 1. Cette analyse exige une évaluation de quatre facteurs contextuels liés au non-respect de l’alinéa 2(b) : 1) la nature du préjudice; 2) la vulnérabilité du groupe; 3) l’appréhension et les craintes subjectives d’un préjudice 4) la nature de l’expression en jeu.
La Cour a porté son attention sur le premier et le quatrième facteurs contextuels. Dans le cas du premier, la nature du préjudice consistait en un déni d’accès à un milieu éducatif non discriminatoire pour les élèves LGBT et une atteinte à l’intégrité du système scolaire dans son ensemble. Pour établir qu’il y avait eu préjudice, il n’était pas nécessaire de prouver que des élèves particuliers avaient été touchés. Dans le cas du quatrième facteur, bien que certains des écrits de M. Kimpling se soient inscrits dans un débat rationnel sur des questions politiques et sociales, une bonne partie de ses propos versait dans la rhétorique discriminatoire qui s’éloignait beaucoup des valeurs fondamentales de la liberté d’expression. Pris dans son ensemble, l’expression ne méritait pas une très grande protection constitutionnelle. Puisque l’expression a causé un préjudice et ne reflétait pas les valeurs fondamentales inhérentes à l’alinéa 2(b), il était facile pour la Cour de conclure que les mesures prises par le BCCT étaient justifiées aux termes de l’article 1 de la Charte. Comme l’a fait remarquer la Cour, la suspension d’un mois imposée à M. Kimpling doit être « acceptable sur le plan constitutionnel » si, dans Ross, la Cour suprême a confirmé la décision d’imposer une suspension de 18 mois et une interdiction à vie de travailler au sein du conseil scolaire.
De nombreuses décisions relatives aux droits de la personne se sont inspirées de Ross, Taylor et Keegstra. Dans quelques cas, l’expression s’est révélée si grossière que le tribunal a déterminé qu’il y avait eu contravention de la loi sur les droits de la personne pertinente. Il s’agissait habituellement de situations où l’expression s’accompagnait d’une incitation à agir d’une manière normalement considérée comme discriminatoire[69]. Dans bien d’autres cas, l’affaire a été abandonnée pour des motifs de compétence ou autre[70] et, dans le cas où on a tenu une audience, le droit à la liberté d’expression a été maintenu[71].
En Ontario, le TDPO a pris en considération l’article 13 du Code des droits de la personne de l’Ontario qui s’applique aux avis, écriteaux, symboles, emblèmes et autres représentations analogues qui indiquent l’intention de porter atteinte à un droit visé à la Partie I du Code ou qui a pour objet d’inciter à une telle atteinte. Dans Whiteley c. Osprey Media Publishing[72], le TDPO était d’accord avec l’argument de la Commission ontarienne des droits de la personne selon lequel les éditoriaux de journaux qui expriment des opinions sur un sujet ne constituent pas des « représentations analogues » et qu’ils ne sont par conséquent pas couverts par cette disposition du Code. Étant donné que la publication d’opinions dans les médias est une pierre angulaire de la liberté d’expression et de la liberté de presse au sein de sociétés démocratiques, toute ambigüité à l’article 13 devrait être interprétée dans le sens de l’exclusion de telles questions des visées du Code. Le TDPO a aussi établi que le contenu des éditoriaux ne constituait pas un « service » au sens du Code.
Récemment, dans Whatcott[73] la Cour d’appel de la Saskatchewan a entendu un appel relatif à une décision du Human Rights Tribunal de la Saskatchewan indiquant qu’on avait enfreint aux dispositions du Code des droits de la personne de la Saskatchewan interdisant la propagande haineuse. La Cour suprême du Canada a accepté d’entendre l’affaire en octobre 2011 et examinera la constitutionalité de l’article du Code de la Saskatchewan à la lumière de l’incidence qu’il a ou pourrait avoir sur la liberté d’expression et la liberté de religion.
William Whatcott a distribué quatre circulaires à des foyers des régions de Saskatoon et de Regina en 2001 et 2002, sous le nom de Christian Truth Activists. Quatre des récipiendaires de circulaires ont porté plainte auprès de la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan, alléguant que les circulaires incitaient à la haine fondée sur l’orientation sexuelle ou contrevenaient d’autre façon au Code des droits de la personne de la Saskatchewan. La disposition du Code étant visée est l’alinéa 14(1)(b), qui interdit la publication de toute représentation qui, pour un motif interdit par le Code, expose ou tend à exposer à la haine, à ridiculiser ou à rabaisser une personne, ou qui par tout autre moyen porte atteinte à la dignité de toute personne ou catégorie de personnes. Le paragraphe 14(2) indique que le paragraphe (1) ne limite en rien le droit à la liberté d’expression au sens de la loi, quel que soit le sujet.
Les circulaires contenaient plusieurs déclarations à propos de l’« homosexualité », des « homosexuels », et des « sodomites » qui appelaient à prendre des mesures pour maintenir hors du système scolaire la « propagande homosexuelle ». La Cour d’appel de la Saskatchewan a qualifié de « crues, insultantes et péjoratives » bon nombre des déclarations que contenaient les circulaires. M. Whatcott arguait qu’il exerçait son droit à la liberté de religion et à la liberté d’expression. Il soutenait aussi que, même s’il était déterminé que ses propos incitaient à la haine, ses commentaires avaient trait à des activités ou comportements sexuels, et que l’activité sexuelle et l’orientation sexuelle sont deux concepts distincts.
Le Human Rights Tribunal de la Saskatchewan a conclu que les circulaires contenaient plusieurs déclarations qui, lorsqu’elles forment un tout, peuvent être objectivement perçues comme exposant des personnes à la haine et au ridicule, les rabaissant, ou portant autrement atteinte à leur dignité en raison de leur orientation sexuelle. Comme l’a clarifié en appel la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, pour qu’il y ait contravention de l’article du Code, la communication doit exprimer des « sentiments extrêmes et profondes émotions de haine, de calomnie et de diffamation ». Tout en gardant à l’esprit ce seuil élevé, la Cour d’appel a confirmé que le tribunal avait eu raison de conclure que le Code avait été enfreint. La Cour d’appel était particulièrement troublée par les déclarations incluses aux circulaires qui qualifiaient les « homosexuels » de pédophiles, d’agresseurs et d’agresseurs d’enfants. Le Banc de la Reine s’est aussi demandé si l’article pertinent du Code constituait une limite raisonnable à la liberté de parole et a déterminé que « oui », à l’instar d’une décision précédente de la Cour d’appel de la Saskatchewan.
Dans deux décisions séparées, la Cour d’appel de la Saskatchewan a renversé les décisions du tribunal et de la Cour du Banc de la Reine, jugeant que, selon l’interprétation qu’il convient de donner à l’alinéa 14(1)(b), les circulaires n’exposaient pas ou ne tendaient pas à exposer à la haine, ne ridiculisaient pas ou ne rabaissaient pas une personne, ou par tout autre moyen ne portaient pas atteinte à la dignité de toute personne ou catégorie de personnes pour un motif interdit par le Code.
La décision de la juge Hunter (avec l’accord du juge Sherstobitoff) mettait l’accent sur l’équilibre entre l’interdiction de « propagande haineuse » et le droit à la liberté d’expression conféré par la Charte et par le Code des droits de la personne de la Saskatchewan (art. 5 et paragraphe 14(2)). La juge Hunter a indiqué qu’au moment de résoudre le conflit entre la liberté d’expression et le droit à ne pas être soumis à des circulaires qui exposent ou tendent à exposer les personnes à de la haine au motif de leur orientation sexuelle, il est essentiel d’examiner le contexte et en particulier les circonstances entourant la rédaction et la distribution de la publication. La juge Hunter a ensuite fait valoir que le contexte de l’affaire en cause incluait des questions de moralité et a décrit les circulaires comme désapprouvant des pratiques sexuelles entre personnes du même sexe. En conséquence, elle était prête à accorder une grande latitude à l’expression, comme suit :
Au sein d’une démocratie, il est acceptable que des personnes passent des commentaires sur la moralité du comportement d’autrui. C’est pourquoi la société fait preuve d’une tolérance relativement grande à l’égard du langage utilisé lors des débats sur les questions morales, en dedans d’une certaine limite bien sûr. Toute mesure qui limite le débat sur la moralité de comportements constitue une atteinte au droit à la liberté d’expression.
Selon la décision de la juge, le Humam Rights Tribunal de la Saskatchewan et la Cour du Banc de la Reine de la province n’avaient pas examiné les circulaires d’une façon objective, compte tenu du contexte et des circonstances, en prenant soin d’établir un équilibre entre les droits en jeu. La juge Hunter a examiné les circulaires à la lumière de ce cadre et, malgré le caractère dégradant de certains mots et expressions qu’on y retrouve, a conclu qu’ils ne répondaient pas aux critères applicables à la haine, établis dans Taylor. Les circulaires doivent être examinées dans le contexte d’un débat légitime sur l’inclusion de l’éducation « homosexuelle » dans le curriculum scolaire. L’usage de termes choquants ou dénigrants pour décrire un groupe ne constitue par de la haine et la présence d’une seule phrase non appropriée ne ternit pas toute une publication et ne fait pas pencher la balance en faveur de la limitation de la liberté d’expression.
Dans une décision concordante distincte, la juge Smith (avec l’accord du juge Sherstobitoff) a fourni une analyse contextuelle qui prenait en compte non seulement l’importance de la liberté d’expression, mais aussi les désavantages et la vulnérabilité historiques du groupe ciblé, et le préjudice causé par les publications. La juge a aussi reconnu que les critiques à l’endroit des comportements entre personnes de même sexe pouvaient équivaloir à des attaques à l’égard des personnes à orientation homosexuelle. Cependant, comme sa collègue, la juge Smith a déterminé que les circulaires visaient principalement l’activité et non l’orientation des personnes homosexuelles et qu’elles portaient principalement sur des questions de morale sexuelle qui se situent « près du cœur de l’expression méritant notre protection contre les effets terribles de l’interdiction législative ».
De façon similaire, la juge Smith a déterminé que la nature offensant et péjorative du langage utilisé ne changeait rien au fait que les messages véhiculés dans les circulaires constituaient une question importante et légitime d’intérêt public. La juge Smith a mis l’accent sur l’objectif de la publication et déterminé que, puisque la communication n’avait pas pour objet de promouvoir la haine, l’article pertinent du Code ne devrait pas être interprété de façon à l’interdire. Elle a aussi fait des observations sur le bien-fondé de réexaminer la décision de la Cour suprême dans l’affaire Taylor et suggéré que les expressions qui ciblent des personnes sur la base de leur race et de leur religion, comme dans Taylor, font intervenir des valeurs constitutionnelles différentes de celles qui visent d’autres motifs protégés par le Code, comme l’orientation sexuelle.
Non sans surprise, l’appel devant la Cour suprême du Canada a suscité beaucoup d’intérêt d’une variété d’organisations allant des groupes de défense des libertés civiles aux organisations religieuses, en passant par les organisations de promotion des droits de groupes défavorisés particuliers et organisations de droits de la personne qui interviendront pour présenter leurs points de vue sur la manière de concilier les droits en jeu. La décision de la Cour suprême ouvrira sans doute un nouveau chapitre dans la conciliation des droits à la liberté d’expression et à l’égalité au Canada.
Liberté de religion et droits de la personne/à l’égalité
Bien que de nombreuses situations puissent entraîner des conflits sur le plan des droits, ce sont souvent celles qui opposent la liberté de religion au droit de vivre à l’abri de la discrimination, surtout fondée sur l’orientation sexuelle, qui attirent le plus d’attention. Une variété de décisions des tribunaux relatives à ces situations offrent aussi des indications sur les facteurs à considérer durant le processus de conciliation des droits.
Dans Trinity Western[74], la Cour suprême du Canada s’est demandé si des diplômés d’une université chrétienne privée, qui exige de ses étudiants qu’ils suivent certaines « normes communautaires » interdisant, entre autres, les « activités homosexuelles », devraient obtenir du British Columbia College of Teachers leur permis d’enseignement au sein du système d’éducation public. L’ordre des enseignants arguait que les programmes d’enseignement devaient être offerts dans un milieu qui reflétait les valeurs inhérentes aux droits de la personne et qu’un établissement qui veut former des enseignants à des fins d’emploi au sein du système d’éducation public doit démontrer qu’il offre un environnement qui prépare adéquatement les futurs enseignants à la diversité des élèves qui composent le système d’éducation public. Autrement dit, l’ordre soutenait qu’il se préoccupait avec raison du risque qu’un enseignant, ayant obtenu son diplôme du programme de l’université Trinity Western, se rendrait coupable de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
La Cour suprême a déterminé que cette affaire pouvait être réglée par la « juste délimitation des droits et valeurs en jeu ». Le fait de bien définir la portée des droits évite les conflits. Selon la Cour, la ligne devait être tracée entre la liberté d’embrasser des croyances et l’adoption de comportements fondés sur ces croyances. Il n’existait aucune preuve concrète à l’appui du fait que l’adoption de croyances sur « l’homosexualité » mènerait les diplômés de l’université Trinity Western à poser des gestes discriminatoires.
La Cour suprême a de nouveau examiné la relation entre les droits religieux et les droits à l’égalité des gais et lesbiennes dans Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe[75] lorsqu’elle a été appelée à se prononcer sur la constitutionalité d’un projet de loi qui étendrait le droit de se marier aux personnes du même sexe. Certaines personnes soutenaient que l’accès équitable des personnes de même sexe au mariage aurait pour effet de violer le caractère équitable des droits religieux des personnes qui s’opposent au mariage entre personnes de même sexe pour des motifs religieux. La Cour a rejeté l’argument des droits contradictoires, en ajoutant que la reconnaissance du droit des gais et lesbiennes de se marier ne pouvait pas, en soi, contrevenir aux droits d’autres personnes.
En ce qui a trait aux préoccupations à l’égard du conflit en matière de droits que pourrait entraîner la légalisation du mariage entre personnes de même sexe, la Cour a refusé d’émettre des décisions sur des situations hypothétiques, et confirmé l’importance de présenter des faits véridiques pour appliquer de façon appropriée l’approche contextuelle devant être utilisée pour concilier des droits. La Cour a fait remarquer que les décisions passées démontrent bien que de nombreux conflits, sinon tous, peuvent être réglés au moyen de la Charte, par la juste délimitation des droits et l’atteinte d’un équilibre interne.
La Cour d’appel de la Saskatchewan s’est récemment demandé si les commissaires aux mariages civils devraient avoir le droit de refuser de célébrer des mariages entre personnes de même sexe en raison de leurs croyances religieuses dans Commissaires aux mariages nommés en vertu de la Loi de 1995 sur le mariage (Renvoi)[76]. Dans deux décisions distinctes, tous les cinq juges de la Cour d’appel ont établi que les modifications proposées à la Loi de 1995 sur le mariage de la Saskatchewan, qui auraient permis à des commissaires aux mariages de refuser de célébrer des mariages, si le fait de célébrer ces mariages allait à l’encontre de leurs croyances religieuses, contrevenaient à la disposition sur les droits à l’égalité (art. 15) de la Charte. Conformément à l’approche générale de conciliation des droits contradictoires en application de la Charte, les deux décisions ont opposé le droit de vivre à l’abri de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle aux droits religieux des commissaires aux mariages, aux termes de l’article 1 de la Charte, et ont établi pour des raisons légèrement différentes que la violation des droits à l’égalité ne pouvait pas être justifiée malgré le désir de tenir compte des objections des commissaires aux mariages pour des motifs religieux.
La Cour d’appel a décrit la marginalisation et les mauvais traitements dont ont été victimes les gais et lesbiennes tout au long de l’histoire et a souligné les conséquences très considérables et réellement choquantes du fait de communiquer avec un commissaire aux mariages pour se voir refuser ses services sur la base de son orientation sexuelle. La décision majoritaire tenait également compte de facteurs contextuels qui auraient des répercussions sur l’accès aux services de mariage si des commissaires pouvaient refuser de célébrer certains mariages. En particulier, les juges ont fait remarquer qu’aucune mesure n’avait été prévue afin de veiller à ce qu’un nombre minimum de commissaires soit en tout temps disponible pour célébrer les mariages ou afin de tenir compte des impératifs géographiques, de sorte que les personnes vivant dans des collectivités du Nord, collectivités rurales et petits centres urbains ne soient pas forcées de se déplacer sur une longue distance pour trouver un commissaire prêt à les marier.
Les deux décisions prenaient en compte que le fait d’obliger les commissaires aux mariages à célébrer des mariages contraires à leurs croyances religieuses contreviendrait dans une certaine mesure à leurs droits religieux. Cependant, il y a une différence considérable entre les mariages religieux célébrés par le clergé conformément aux croyances, rites et sacrements de leurs croyances religieuses et les mariages civils dont le but est de n’avoir aucune participation de la religion. Quand un dirigeant religieux célèbre un mariage religieux, il prend part à une pratique religieuse ou à un rite religieux qui est un élément central du droit à la liberté de religion. À l’opposé, les commissaires aux mariages civils n’agissent pas à titre de citoyens lorsqu’ils remplissent leurs fonctions officielles. Ils célèbrent plutôt des mariages non confessionnels au nom du gouvernement. Le fait de permettre aux commissaires aux mariages civils de refuser de célébrer certains mariages contreviendrait au principe de base qui consiste à veiller à ce que les services gouvernementaux soient offerts à tous de façon équitable, sur une base impartiale et non discriminatoire.
Encore une fois, la comparaison de la conclusion tirée dans cette décision à la discussion entretenue dans Renvoi sur le mariage entre personnes de même sexe illustre l’importance du contexte pour la conciliation de droits potentiellement contradictoires. Bien que les deux décisions traitent du droit de refuser de célébrer des mariages entre personnes de même sexe, les conclusions tirées s’avèrent différentes si la situation concerne un élément central des droits religieux ou fait intervenir ces droits d’une façon beaucoup plus « secondaire ».
Une approche similaire a été adoptée dans la décision Brockie c. Brillinger en application du Code des droits de la personne de l’Ontario[77]. L’affaire concernait M. Brillinger, un homme gai qui s’est présenté à l’entreprise de M. Brockie pour faire imprimer du papier à en-tête et des cartes de visite au nom de l’organisme Gay and Lesbian Archives. M. Brockie a refusé de fournir les services demandés, au motif que la prestation de services d’impression à l’organisme entrerait en conflit avec ses croyances religieuses. La Commission d’enquête de l’Ontario (le précurseur du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario) a déterminé que M. Brockie avait fait preuve de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle à l’endroit de M. Brillinger et de l’organisme. La Commission a ordonné à M. Brockie de fournir des services d’impression aux personnes gaies et lesbiennes et aux organisations de personnes gaies et lesbiennes, et de verser 5 000 $ en dommages.
M. Brockie a interjeté appel de la décision devant la Cour divisionnaire. Il a demandé à la Cour de rejeter la décision en raison de son droit constitutionnel à la liberté de religion. Les parties à l’appel ont reconnu que l’ordonnance de la Commission avait bel et bien porté atteinte à la liberté de religion de M. Brockie en l’obligeant à agir d’une façon qui était contraire à ses croyances religieuses.
La Cour s’est ensuite demandé si l’ordonnance de la Commission avait limité de façon excessive les droits religieux de M. Brockie, ou si la limite imposée pouvait être qualifiée de raisonnable aux termes de l’article 1 de la Charte. La Cour a décrit certains des aspects de la liberté de religion et certaines des limites à cette liberté, lesquels ont été établis par la Cour suprême du Canada[78]. Elle a rappelé que plus une activité s’éloigne des éléments centraux de la liberté, plus elle a de risques d’avoir des répercussions sur autrui et de ne pas mériter de protection. Les services d’impression commerciale fournis par M. Brockie ont été jugés à la périphérie des activités protégées par la liberté de religion. Il était donc justifié d’imposer des limites à l’exercice de ces droits pour limiter les préjudices à autrui, sous forme de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Cependant, la Cour a ouvert la porte à l’enregistrement d’un jugement différent dans un contexte différent, par exemple dans le cas où le matériel à imprimer entrerait plus directement en conflit avec les éléments centraux des croyances de M. Brockie[79].
Dans Smith c. Knights of Columbus[80], un tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a examiné une plainte pour discrimination déposée après qu’une organisation d’hommes catholiques ait refusé à un couple de lesbiennes d’organiser leur réception de mariage dans leur salle de réception. La salle de réception appartenait à l’Église catholique et était exploitée par l’organisme Knights of Columbus, qui la louait aux membres du public pour une variété d’événements, comme des anniversaires, des rencontres des AA et un programme pour tout-petits.
Les Knights of Columbus soutenaient qu’ils avaient une justification véritable et raisonnable pour avoir annulé le contrat et, sinon, qu’ils avaient droit à la protection de la défense légale prévue à l’article 41 du Human Rights Code de la Colombie-Britannique.
Le Tribunal a rejeté l’application du moyen de défense prévu à l’article 41 (voir la section Défenses légales pour obtenir une explication de cet aspect de la décision). Au moment d’examiner si l’organisme avait une justification raisonnable et véritable pour annuler le contrat de location et s’il avait pu satisfaire à la demande des appelantes sans que cela n’impose de contrainte excessive, le tribunal a de nouveau souligné l’importance du contexte. Le tribunal s’est penché sur une variété de facteurs, y compris la relation entre les Knights of Columbus et l’Église catholique, les croyances religieuses de l’Église catholique en matière de mariage entre personnes de même sexe, non seulement en ce qui a trait à la célébration du mariage mais aussi à la réception qui la suit, ainsi que la façon dont la salle avait été louée par le passé et si elle avait été uniquement louée à des Catholiques.
Le tribunal a déterminé que la salle était offerte au grand public, sans égard à la religion, mais qu’elle ne pouvait pas être utilisée à des fins contraires aux croyances de base de la religion catholique. Le tribunal a appliqué une analyse de l’accommodement pour déterminer si les Knights of Columbus avaient pu satisfaire à la demande des appelantes, compte tenu de leurs croyances religieuses de base sur le mariage entre personnes de même sexe, sans que cela n’impose de contrainte excessive. Le tribunal a qualifié cette analyse d’« analyse à large spectre », ce qui signifie qu’il devait déterminer où, le long d’un continuum, tracer la ligne entre les droits religieux des Knights of Columbus et les droits à l’égalité du couple de lesbiennes. Le tribunal a confirmé que plus un acte s’éloigne des croyances religieuses de base de la personne qui refuse de fournir le service, moins l’acte est susceptible d’être considéré comme justifié.
À la lumière des faits présentés, le tribunal a jugé que les Knights of Columbus ne pouvaient pas être tenus d’agir d’une façon contraire à leurs croyances religieuses de base. Bien qu’on ne leur ait pas demandé de participer à la célébration du mariage entre personnes de même sexe, le fait de louer la salle à des fins de célébration du mariage aurait exigé qu’ils « approuvent indirectement » un acte contraire à leurs croyances religieuses de base.
Par contre, l’analyse du tribunal ne s’est pas arrêtée là. Selon le tribunal, l’organisme a déclenché l’obligation d’accommodement des droits des appelantes lorsqu’il a pris à l’origine des mesures pour louer la salle aux appelantes, et aurait dû chercher une solution viable qui aura réduit les effets négatifs sur les droits des appelantes. En particulier, avant de communiquer avec les appelantes dans le but d’annuler le contrat, l’organisme aurait dû prendre des mesures additionnelles en vue de reconnaître la dignité inhérente des appelantes, par exemple les rencontrer pour leur expliquer la situation, leur offrir des excuses formelles, leur offrir immédiatement de rembourser toute dépense engagée en raison de l’annulation du contrat et peut-être même offrir de les aider à trouver une autre solution. Essentiellement, le tribunal cherchait un compromis qui aurait protégé les droits religieux des Knights of Columbus tout en reconnaissant les répercussions sur la dignité des appelantes du fait d’apprendre soudainement qu’elles ne pouvaient pas louer la salle après avoir signé le contrat et envoyer les invitations.
En Ontario, le paragraphe 18.1 du Code prévoit une exception pour une autorité religieuse qui refuse de célébrer un mariage qui est contraire à ses croyances religieuses ou aux « doctrines, rites ou coutumes de la confession religieuse à laquelle elle appartient ». Il permet aussi aux autorités religieuses de refuser que des lieux sacrés, qui s’entend d’un lieu de culte et de « toutes installations auxiliaires ou accessoires », soient utilisés en vue de célébrer un mariage ou pour la tenue d’un événement lié à la célébration d’un mariage qui est contraire à leurs croyances religieuses. Jusqu’à présent, aucune décision n’a porté sur l’application de cette disposition du Code.
La tension entre les droits religieux et le droit de vivre à l’abri de la discrimination s’est manifestée de nombreuses façons dans le contexte de l’éducation et du milieu scolaire. Et tout porte à croire que le milieu de l’éducation continuera de présenter des défis sur le plan de la conciliation de droits contradictoires.
En 2002, la Cour suprême du Canada et la Cour suprême de l’Ontario ont dû rendre des décisions, respectivement, dans des affaires relatives au programme d’études et au droit d’assister au bal des finissants avec un conjoint du même sexe.
Dans Chamberlain c. Surrey School District No. 36[81] la Cour suprême s’est penchée sur la contestation d’une décision d’un conseil scolaire de ne pas approuver trois ressources documentaires complémentaires illustrant des familles dont les deux parents sont du même sexe pour l’enseignement du programme d’éducation à la vie familiale. La décision du conseil reposait sur l’objection de nature confessionnelle de certains parents. La décision majoritaire rendue par la Cour suprême faisait référence au fait que la School Act de la Colombie-Britannique exigeait la laïcité et interdisait la discrimination, et qualifiait la décision du conseil de déraisonnable compte tenu des circonstances. Selon la Cour, les préoccupations d’ordre religieux des parents pouvaient faire partie des considérations, mais ne pouvaient pas servir à refuser à d’autres membres de la collectivité une reconnaissance et un respect égaux. La décision majoritaire mettait l’accent sur le droit d’embrasser des convictions religieuses, y compris le droit de désapprouver des pratiques d’autrui. Cependant, pour favoriser un climat de tolérance et de respect à l’école, ces convictions ne peuvent pas constituer les bases des politiques scolaires. La Cour a fait remarquer que le conseil n’avait aucunement considéré les besoins des enfants issus de familles composées de parents de même sexe ou la pertinence du matériel dans le cadre des objectifs du programme d’études.
La décision majoritaire abordait l’argument selon lequel les manuels auraient pu transmettre des messages discordants aux enfants dont les parents désapprouvaient des relations entre personnes de même sexe. Les juges ont souligné qu’en tant que membres d’une population étudiante diversifiée au sein du système d’éducation public, les enfants étaient exposés au fait que tout le monde ne partage pas leurs valeurs et croyances. L’exposition à des points de vue différents permet aux enfants d’apprendre la tolérance. De plus, la tolérance permet aux personnes d’embrasser leurs propres croyances tout en respectant les droits des autres.
Lorsqu’on demande aux gens d’être tolérants envers autrui, on ne leur demande pas de renoncer à leurs convictions personnelles. On leur demande simplement de respecter les droits, les valeurs et le mode de vie des personnes qui ne partagent pas ces convictions. La croyance que les autres ont droit au même respect s’appuie non pas sur la croyance que leurs valeurs sont justes, mais sur la croyance qu’ils ont droit au même respect que leurs valeurs soient justes ou non. Apprendre la tolérance, c’est donc apprendre que les autres ont droit à notre respect, que leurs convictions soient les mêmes ou non. Les enfants ne peuvent l’apprendre que s’ils sont exposés à des points de vue qui diffèrent de ceux qui leur sont enseignés à la maison.
Deux juges de la Cour suprême auraient qualifié la décision du conseil de raisonnable. Dans une décision dissidente, les juges ont fait valoir le droit des parents d’élever leurs enfants conformément à leurs croyances religieuses ou autres.
Pendant que Chamberlain traitait de programmes d’études, Hall (Litigation Guardian of) c. Powers[82] se penchait sur un aspect très différent de la vie scolaire. M. Hall, un jeune homme homosexuel catholique de 17 ans voulait amener son conjoint de même sexe à son bal de finissants. Le directeur de l’école secondaire catholique que fréquentait le jeune le lui a interdit, sous prétexte que cela excuserait une conduite contraire aux enseignements de la religion catholique. Le conseil scolaire catholique a réitéré la décision de l’école. M. Hall a demandé à un tribunal judiciaire de rendre une injonction interlocutoire pour empêcher l’école de lui interdire d’assister au bal de finissants accompagné de son copain. Le jour du bal de finissants, la Cour suprême de l’Ontario a accordé l’injonction.
En raison des protections spéciales accordées aux écoles catholiques par la Constitution canadienne, la Cour devait établir un équilibre entre les droits à l’égalité de M. Hall et les droits religieux et droits des écoles confessionnelles établis au paragraphe 93(1) de la Loi constitutionnelle de 1867. La Cour a dû concilier ces droits dans le contexte du critère d’octroi d’une injonction interlocutoire[83].
Au moment d’évaluer les droits à l’égalité de M. Hall, la Cour a fait remarquer que les activités de loisir effectuées en milieu scolaire sont importantes pour le développement de l’élève, de sorte que « le fait de retirer à un élève une occasion significative de participer à la vie scolaire, comme le bal de finissants, constitue une restriction de l’accès à une institution sociale fondamentale. » La Cour a aussi passé en revue les éléments de preuve tirés de l’histoire sociale et ayant trait aux stigmates et stéréotypes attribués aux gais et lesbiennes.
En ce qui a trait au contexte entourant les droits de l’école catholique, la Cour suprême a mené un examen du catéchisme de l’Église et de l’application pratique des enseignements de l’Église en matière d’« homosexualité » au sein de la communauté catholique. La Cour a souligné qu’il existait une grande diversité d’opinions sur la réaction appropriée à l’homosexualité et sur ce qui constituait un « acte homosexuel ».
Dans le cadre de son analyse contextuelle, la Cour a reconnu au bal des finissants deux aspects : un aspect lié aux relations amoureuses et un aspect de célébration sociale. Selon elle, on ne peut présumer que les personnes qui assistent à un bal des finissants accompagnées d’une autre personne ont eu, ou comptent avoir, des relations sexuelles avec cette personne. La Cour s’est demandé si le fait de danser avec une personne du même sexe lors d’un bal des finissants constitue un péché ou une conduite sexuelle qui serait interdite par l’Église catholique. Fait probablement encore plus important, la Cour a souligné que le bal des finissants ne faisait pas partie d’un service religieux ni du volet pédagogique des activités du conseil, qu’il n’avait pas lieu sur le terrain de l’école et qu’il n’avait pas de nature pédagogique.
En ce qui a trait au bien-fondé de recourir à l’article 93 de la Loi constitutionnelle[84] pour justifier l’atteinte aux droits à l’égalité de M. Hall, la Cour a indiqué que l’article 93 ne signifiait pas que la Charte ne s’appliquait pas aux écoles séparées. La Cour doit établir au cas-par-cas un équilibre entre une conduite nécessaire pour assurer le bon fonctionnement d’une école catholique et une conduite qui enfreint les droits protégés par la Charte, comme les droits à l’égalité protégés aux termes de l’article 15. Dans cette affaire, il s’agit de déterminer si le fait de permettre à un élève gai d’assister à son bal des finissants accompagné de son copain affecterait de façon préjudiciable les droits conférés aux écoles confessionnelles aux termes de l’article 93 de la Loi constitutionnelle[85].
La réponse de la Cour à cette question est « non ». Premièrement, la preuve démontre qu’il existe une diversité d’opinions au sein de la communauté catholique, de sorte qu’on ne puisse déterminer clairement quel mode d’action serait requis pour veiller à ce qu’on n’affecte pas de façon préjudiciable les droits des écoles confessionnelles. Deuxièmement, le droit en jeu (de contrôler qui peut assister à des soirées dansantes) n’avait pas cours en 1867. Enfin, si on examine la question de façon objective, on ne peut pas dire que la conduite en cause touche la nature essentiellement confessionnelle de l’école.
En bout de ligne, la Cour a conclu que les droits à l’égalité de M. Hall seraient plus gravement touchés si on lui enlevait la possibilité d’assister à son bal des finissants. D’un autre côté, une injonction n’imposerait pas d’enseignement particulier à l’école, ne restreindrait pas l’enseignement offert, et n’aurait aucune incidence sur les croyances catholique. Puisqu’elle aurait pour effet de restreindre la conduite et non les croyances, une injonction ne nuirait pas à la liberté de religion des intimés.
Le Human Rights Tribunal de la Colombie-Britannique s’est penché sur une cause liée à l’emploi en milieu scolaire. Dans Chiang c. Vancouver Board of Education[86], une enseignante-bibliothécaire, qui agissait aussi à titre de marraine du Christian Fellowship Club (club de fraternité chrétienne) de l’école où elle travaillait, a déposé une plainte pour discrimination en emploi fondée sur sa religion. La plainte faisait suite à une discussion entre Mme Chiang et une autre enseignante, Mme Fergusson, enseignante marraine du Pride Club (club de fierté gaie connu aussi sous le nom d’alliance homosexuelle/hétérosexuelle) de l’école, et à la façon dont la directrice de l’école avait réagi à l’incident.
Mme Chiang se préoccupait du fait que Mme Fergusson distribuait des autocollants arcs-en-ciel aux enseignants afin qu’ils les collent volontairement sur la porte de leur salle de classe pour montrer leur appui aux élèves gais, lesbiennes et transgenres (GLBT). Mme Chiang était d’avis que son choix de ne pas placer d’autocollant sur sa porte donnerait à ses collègues l’impression qu’elle était intolérante ou même homophobe, et les amènerait à conclure que sa décision était basée sur ses croyances religieuses. Cependant, Mme Chiang n’a jamais précisé qu’elles étaient ces croyances religieuses.
Un vidéoclip portant sur une petite église baptiste radicale des États-Unis qui militait activement contre les « homosexuels » a causé un second conflit. Mme Fergusson avait distribué le vidéoclip à tous les membres du personnel, en affirmant qu’il rappelait comment on apprend à certains enfants à haïr. Mme Chiang soutenait que le vidéoclip pointait du doigt les Chrétiens et créait pour elle un climat de travail hostile.
De plus, Mme Chiang avait reçu une lettre de la directrice de l’école indiquant qu’elle s’attendait à ce que les membres du personnel « appuient et respectent tous les élèves sans égard à leur point de vue à propos de l’homosexualité ». Mme Chiang a reçu cette lettre en raison de délais dans l’approvisionnement de la bibliothèque en livres portant sur la réalité GLBT, un processus dont Mme Chiang était la seule responsable. D’autres éléments, comme des présentoirs et du matériel portant sur la jeunesse gaie et lesbienne, avaient aussi été sources de conflits avec Mme Chiang.
Le tribunal de la Colombie-Britannique a débuté son analyse en situant les questions soulevées dans le contexte juridique régissant les droits de la personne au sein du système d’éducation public. Le tribunal a souligné la nature laïque du système d’éducation et le devoir du conseil de fournir un environnement d’apprentissage libre de discrimination fondée sur la religion ou l’orientation sexuelle. En ce qui a trait aux droits religieux, le tribunal a rappelé la décision de la Cour suprême du Canada dans Trinity Western, laquelle établissait que la protection des croyances religieuses ne s’étend pas nécessairement à la protection des conduites motivées par les croyances religieuses.
Le tribunal a examiné la preuve pour déterminer si les allégations de Mme Chiang correspondaient bien à une atteinte du droit de vivre à l’abri de la discrimination fondée sur la religion, et a déterminé que non. Premièrement, le tribunal a conclu que Mme Chiang n’avait jamais fait connaître ses croyances religieuses et n’avait pas démontré qu’elle avait subi de fardeau ou de préjudice en raison de ces croyances. Par exemple, chaque enseignant pouvait décider de placer ou non l’autocollant sur la porte de sa salle de classe. Ensuite, le tribunal a souligné que la plupart, sinon l’ensemble, des allégations de Mme Chiang étaient de nature spéculative. Selon lui, Mme Chiang formulait une supposition non fondée lorsqu’elle alléguait que Mme Fergusson avait pointé du doigt tous les Chrétiens, ainsi qu’elle, en les dépeignant de bigots intolérants lorsqu’elle avait distribué son vidéoclip.
Enfin, le tribunal a conclu que l’administration des écoles publiques doit strictement reposer sur des principes laïques. La non-discrimination est une valeur fondamentale du système d’éducation public qui est essentielle à l’établissement d’un climat tolérant et non discriminatoire pour tous les élèves. Par conséquent, bien que les enseignants soient libres d’embrasser des croyances religieuses, leur conduite doit respecter les principes de tolérance et de non-discrimination. Si leur conduite basée sur des croyances religieuses ne respecte pas ces principes, le conseil scolaire ou le directeur de l’école peut prendre des mesures pour modifier cette conduite, sans que cela ne constitue une atteinte aux droits de l’enseignant. Les mesures prises pour tenter de composer avec le comportement de Mme Chiang à l’égard des questions relatives aux GLBT étaient donc appropriées.
La plainte a été rejetée. Cependant, le tribunal a fait remarquer que si Mme Chiang avait informé l’école que sa conduite était fondée sur ses croyances religieuses et si elle avait demandé des mesures d’adaptation, cela aurait pu soulever des questions différentes, y compris celle de déterminer si le conseil était tenu de prévoir des mesures d’adaptation pour ses croyances religieuses. On ne peut clairement savoir comment cela aurait fonctionné dans la pratique et si nous aurions assisté à un dénouement différent. Néanmoins, il est possible que dans l’avenir, on ait à faire appel à un décideur pour déterminer quoi faire quand un enseignant demande une mesure d’adaptation, comme une exemption d’enseignement de parties du programme d’études en raison de ses croyances religieuses.
Un conflit opposant les droits religieux et le droit de vivre à l’abri de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle était également à l’origine d’une cause relative au logement traitée dans des Territoires du Nord-Ouest. Dans cette affaire, un propriétaire a refusé de louer un appartement à un couple gai en raison de son orientation sexuelle. Durant l’audience, le propriétaire a indiqué qu’il croyait que s’il permettait aux plaignants de vivre dans son appartement, Dieu le punirait sur terre et il ferait face au « jugement de Dieu à sa mort ». Il soutenait que cela représentait une « contrainte excessive » et que sa discrimination fondée sur l’orientation sexuelle était donc justifiée. En se basant sur le langage utilisé par la Cour suprême du Canada dans R. c. Big M Drug Mart, l’arbitre a déterminé que, bien que l’intimé pouvait embrasser ses croyances religieuses et agir en conséquence, sa liberté de religion ne pouvait pas servir à justifier la violation du droit à l’égalité d’une autre personne. Selon lui, l’intimé n’avait pas fourni de « justification véritable et raisonnable » pour ses actions discriminatoires, comme l’exige la Loi sur les droits de la personne des Territoires du Nord-Ouest. Au moment d’évaluer les dommages pour discrimination à accorder, l’arbitre a aussi refusé de réduire le montant des dommages au motif que l’intimé « suivait la parole de Dieu ». Il n’existe aucune preuve à l’appui du fait que la parole de Dieu inclut le fait de faire fi de l’obligation juridique de traiter autrui de façon respectueuse.
Droits religieux et égalité entre les sexes
La relation entre la liberté de religion et les droits à l’égalité n’a pas souvent fait l’objet de décisions des tribunaux judiciaires civils. Cependant, dans Bruker c. Marcovitz, la Cour suprême du Canada s’est penchée sur la question, dans une certaine mesure, dans le contexte d’une dispute conjugale faisant intervenir les droits religieux et droits à l’égalité entre les sexes.
La dispute provenait du refus du mari d’accorder un divorce religieux à sa femme. Le couple avait signé une entente sur la façon de régler leurs conflits matrimoniaux, qui incluait l’obligation de l’époux d’accorder le get à sa femme. Le get est un divorce juif qui libère la femme des obligations du mariage et lui permet de se remarier selon la foi juive. Seul l’époux peut accorder le get. La religion juive ne prévoit aucun autre moyen pour la femme mariée de se libérer de ses obligations du mariage. Dans cette affaire, l’époux a refusé pendant plus de 15 ans d’assumer son engagement à accorder le get dans le cadre de l’entente en soutenant qu’un tribunal judiciaire civil ne pouvait pas imposer l’application de l’entente qu’il avait signée sans enfreindre ses droits religieux.
La majorité des juges de la Cour suprême du Canada étaient en désaccord. Ils ont conclu que le contrat représentait une obligation valide et exécutoire en droit québécois et que l’époux n’était pas exonéré de toute responsabilité pour ne pas avoir respecté son obligation au motif de sa liberté de religion. Ainsi, la Cour suprême a laissé entendre que non seulement les droits de la femme étaient un facteur, mais l’étaient également les valeurs fondamentales canadiennes.
La majorité des juges de la Cour ont indiqué que, malgré la réticence des tribunaux judicaires à examiner des questions religieuses de nature « strictement spirituelle ou purement doctrinale », ils interviendraient dans les cas de violation de droits civils et de droits de propriété. Les juges ont ensuite mis en question la revendication par l’époux de ses droits religieux, ajoutant qu’ils voyaient difficilement comment le fait de l’obliger à honorer son engagement d’accorder le get allait à l’encontre d’une croyance religieuse sincère et aurait des conséquences non négligeables pour lui. Cependant, même si l’époux avait pu établir cela, sa revendication d’un droit religieux devait être examinée en regard de droits contradictoires ou des préjudices qu’entraînerait le respect de ce droit.
Dans leur conciliation des droits en jeu, les juges ont fait remarquer que l’époux avait « bien peu à mettre dans la balance », à la fois parce qu’il avait de plein gré conclu une obligation contractuelle qu’il qualifie maintenant d’atteinte à ses droits et parce que le fait de le laisser se désister de sa promesse serait contraire à l’ordre public :
L’intérêt que porte le public à la protection des droits à l’égalité et de la dignité des femmes juives dans l’exercice indépendant de leur capacité de divorcer et se remarier conformément à leurs croyances, tout comme l’avantage pour le public d’assurer le respect des obligations contractuelles valides et exécutoires, comptent parmi les intérêts et les valeurs qui l’emportent sur la prétention de M. Marcovitz selon laquelle l’exécution de l’engagement pris au paragraphe 12 de l’entente pourrait restreindre sa liberté de religion.
Dans cette affaire, un aspect très intéressant de la décision majoritaire a trait à l’attention portée par les juges à la manière dont on concilie cette question de droits sur la scène internationale et à la manière dont les autres démocraties composent avec les valeurs de politiques publiques en jeu. Deux juges de la Cour suprême en désaccord avec la décision étaient essentiellement d’avis que la situation faisait intervenir les droits religieux de l’épouse et non ses droits civiles et que, par conséquent, le différend aurait dû être réglé par les autorités religieuses.
Le TDPO a récemment entendu une plainte déposée par une femme qui s’opposait à une inscription gravée sur un monument offert part une organisation d’hommes catholique et placé sur un terrain appartenant à l’Église catholique[87]. Selon l’appelante, la référence à la vie « de la conception jusqu’à la mort naturelle » constituait une déclaration contre l’avortement qui est choquante et discriminatoire parce qu’elle dénonce, victimise et exclut les femmes. L’appelante soutenait aussi que l’inscription violait son droit de vivre à l’abri de coercition religieuse, ce qui inclut les messages religieux. Il faillait se trouver sur le terrain de l’église pour lire l’inscription, qui n’était pas lisible à partir du trottoir public.
Dans le cadre d’une procédure d’audience sommaire, le TDPO a rejeté la demande de l’appelante, en indiquant qu’il n’avait pas la compétence nécessaire pour examiner le contenu de croyances et d’enseignements religieux, particulièrement lorsqu’ils sont véhiculés sur le terrain d’une organisation religieuse.
Le TDPO a décrit les dimensions positives (le droit d’exprimer et de propager ses croyances) et négatives (le droit de vivre à l’abri de coercition visant à faire accepter ou adopter des croyances, des pratiques ou des formes de culte) des droits contradictoires en jeu. Le TDPO a fait remarquer que l’appelante faisait valoir un droit protégé par le Code qui faisait intervenir des situations situées au cœur même d’autres droits protégés par la Charte, notamment le droit de l’intimé d’afficher un message en accord avec ses croyances religieuses sur le terrain d’une institution religieuse. Selon le TDPO, l’interprétation des droits de l’appelante en vertu du Code doit se garder de vider de leur sens les droits religieux positifs de l’intimé. Le TDPO a conclu qu’il n’était pas approprié d’invoquer les protections des droits de la personne prévues dans le Code pour contester le système de croyances et les enseignements de l’Église catholique.
Dans le cadre d’une autre procédure d’audience sommaire, le TDPO a rejeté la plainte d’un homme gai selon laquelle un prête avait exprimé des points de vue sur l’« homosexualité » qui contrevenaient au Code lorsque l’appelant lui a demandé de l’aider à modifier les opinions de ses parents à propos de l’« homosexualité ». Dans sa décision Tesseris c. Greek Orthodox Church of Canada[88], le TDPO a pris en compte les droits contradictoires du prête pour déterminer s’il avait la compétence d’entendre l’affaire. En jugeant qu’un membre du clergé exécutant des fonctions purement religieuses n’est pas couvert par l’aspect social relatif aux « services » du Code, le TDPO a fait remarquer que, dans les circonstances, le terme « services » devrait être interprété de façon à protéger les droits du prêtre aux termes de la Charte. Le TDPO a souligné le fait que l’enseignement et la transmission des croyances religieuses étaient des éléments centraux des droits religieux du prêtre. En formulant des commentaires sur l’« homosexualité » qui cadraient avec ses croyances religieuses, le prêtre exerçait des droits qui sont au cœur de sa liberté de religion et sont purement associés à son rôle religieux. Par conséquent, l’interaction alléguée entre l’appelant et le prête n’était pas assujettie au Code, et la plainte a été rejetée.
Par son recours à une procédure d’audience sommaire, son rejet des requêtes Tesseris et Daillaire, et son exclusion des installations et services religieux de son interprétation de l’aspect « services », le TDPO a indiqué clairement qu’il ne constitue pas la tribune appropriée pour contester le système de croyances ou les enseignements d’une religion. Cela cadre bien avec l’approche qu’il a adoptée dans Whiteley et qu’aborde la section Liberté d’expression et droits de la personne/à l’égalité. Par conséquent, il se pourrait que le TDPO donne suite aux plaintes les plus simples concernant des droits contradictoires qui lui sont présentées en déclarant qu’il n’a pas les compétences requises pour les examiner.
Conflits liés à des droits religieux différents
Il arrive aussi que les droits religieux d’un groupe ou d’une personne se heurtent aux droits religieux d’autres groupes ou personnes. Dans certains cas, le conflit oppose le droit de pratiquer sa religion de l’un au droit de l’autre de vivre sans se faire imposer de religion. Dans d’autres cas, les arguments ont trait à un traitement préférentiel réservé à la majorité ou à un groupe religieux particulier.
L’imposition de lois et de pratiques basées sur l’observance des pratiques religieuses chrétiennes a été contestée avec succès à plusieurs reprises. R. c. Big M. Drug Mart[89] est l’une des plus importantes causes traitant des droits religieux au Canada. Dans cette affaire, la Loi sur le dimanche du Canada, qui interdisait aux magasins d’ouvrir le dimanche moyennant certaines exceptions, a fait l’objet d’une contestation fondée sur la Charte. La Cour suprême a déterminé que la loi avait pour objet d’obliger l’observance du sabbat chrétien, ce qui contrevenait à la liberté de religion des personnes non chrétiennes. La Cour a fait valoir que l’imposition d’exigences de la foi chrétienne créait un climat hostile et paraissait discriminatoire à l’endroit des Canadiens non chrétiens. La Cour a également jugé que le fait d’imposer un jour de repos préféré par une religion ne concorde pas avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. Selon la Cour, le non-respect de l’alinéa 2(b) n’était pas justifié aux termes de l’article 1 de la Charte.
Peu de temps après avoir rendu sa décision dans Big M Drug Mart, la Cour s’est penchée sur la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail de l’Ontario, qui elle aussi interdisait aux entreprises d’ouvrir le dimanche. Dans ce cas-ci néanmoins, l’objet de la loi n’était pas de nature religieuse, mais visait plutôt à assurer un jour de congé au personnel des entreprises de commerce de détail. Néanmoins, dans R. c. Edwards Books and Art[90], la Cour suprême a déterminé que la loi contrevenait à la liberté de religion étant donné que, bien que son objet soit de nature laïque, elle avait pour effet d’imposer un fardeau économique aux commerces de détail qui observent le sabbat un jour autre que le dimanche. Cependant, à la différence de la Loi sur le dimanche, qui ne pouvait pas être justifiée aux termes de l’article 1, la loi a pu être maintenue dans Edwards Books aux termes de l’article 1 de la Charte étant donné que son objet laïque, c’est-à-dire assurer un jour de congé commun, revêtait une importance suffisante pour justifier un empiétement sur la liberté de religion. Fait intéressant, la Cour a fait mention d’une autre question de droits contradictoires potentielle, notamment l’importance de permettre aux parents de bénéficier d’un jour de congé régulier qui coïncide avec un jour de congé d’école de leurs enfants[91].
La récitation de la prière du Seigneur dans les écoles et lors d’assemblées publiques constitue une autre situation où il a été déterminé que les pratiques religieuses d’un groupe empiétaient sur la liberté de religion d’un autre. Dans le contexte de l’éducation, la Cour d’appel de l’Ontario[92] s’est penchée sur un règlement exigeant que les écoles publiques commencent ou terminent chaque journée par un exercice religieux qui consistait à lire des textes sacrés ou à réciter la prière du Seigneur ou une autre prière convenable. Ce règlement n’était pas constitutionnel, même s’il était de portée assez large pour permettre la récitation de prières non chrétiennes et s’il permettait aux élèves d’être exemptés de l’activité. Encore une fois, c’était l’aspect coercitif du règlement, et le fait qu’il exerçait une pression sur les élèves afin qu’ils se conforment aux pratiques religieuses de la majorité, qui était source de préoccupations.
Dans Freitag c. Penetanguishene, la Cour d’appel de l’Ontario a déterminé que la récitation de la prière du Seigneur au début des assemblées municipales avait pour objectifs d’imposer « un ton de morale chrétienne aux délibérations du conseil », et contrevenait aux droits des non-Chrétiens. Plus tard, un résident du comté de Renfrew qui se qualifiait d’« humaniste non confessionnel » et ne croyait pas en Dieu ni à la participation à la prière a contesté le recours à une prière non confessionnelle par le conseil du comté. Dans Allen c. Renfrew (Corp. of the County)[93], une cour supérieure de l’Ontario a déterminé qu’une prière non confessionnelle et largement inclusive, même si elle fait référence à Dieu, ne constituait pas une atteinte aux droits religieux, et ce, même si elle n’était pas conforme aux croyances de certains « groupes minoritaires ». Le tribunal judiciaire a rejeté l’argument selon lequel le fait de mentionner Dieu dans une prière lors d’une réunion gouvernementale pouvait être perçu comme une tentative de coercition en vue de favoriser l’observance de la religion. Il a aussi laissé entendre que toute ingérence relative aux croyances de M. Allen constituait un « affront mineur » qui n’atteignait pas le niveau d’atteinte à la liberté de religion :
Dans sa forme actuelle, la prière n’est pas en soi une observance religieuse, coercitive ou autre, et n’impose pas de fardeau sur l’appelant ou de restriction sur l’exercice de ses propres croyances. À la différence de Freitag, la récitation de cette prière ne contraint pas l’appelant à participer à une forme de culte chrétien ou autrement confessionnel. La simple mention de Dieu dans la prière en question n’a pas, de l’avis de cette Cour, d’incidence suffisante sur l’appelant pour constituer une ingérence matérielle dans ses croyances religieuses.
Un groupe de parents dont les enfants fréquentaient des écoles religieuses privées a contesté la pratique du gouvernement de l’Ontario consistant à financer les écoles catholiques romaines mais pas les autres écoles confessionnelles. Dans Adler c. Ontario[94], la Cour suprême du Canada a rejeté l’argument selon lequel ce financement préférentiel portait atteinte aux droits religieux et droits à l’égalité des appelants aux termes de l’alinéa 2(a) et de l’article 15 de la Charte. La Cour a confirmé le fait que l’Ontario est tenu de financer les écoles catholiques romaines séparées conformément à l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867. Ce statut spécial est le résultat d’un compromis historique essentiel à la Constitution.
Plusieurs décisions émanant de tribunaux des droits de la personne de l’ensemble du Canada ont traité des plaintes relatives aux discussions sur la religion ou au prosélytisme en milieu de travail. Cela peut être considéré comme une question de droits contradictoires quand la personne déposant la plainte relative aux droits de la personne affirme que son droit de vivre à l’abri de la discrimination ou du harcèlement fondé sur la religion a été enfreint en raison de l’affirmation par une autre personne de ses croyances religieuses. Dans Dufour c. J. Rogers Deschamp Comptable Agréé[95], les employés d’un petit cabinet comptable ont fait l’objet de pressions de la part de l’employeur sur le plan religieux. Un employé a appris durant son entrevue qu’on entretenait au bureau une atmosphère chrétienne. L’employeur a recommandé et convoqué une séance de prières pour guérir les migraines d’un autre membre du personnel. Un autre employé a reçu une bible et de nombreuses discussions sur la religion ont eu lieu, y compris la tenue de prières quotidiennes dans la salle de conférences.
La Commission d’enquête de l’Ontario a fait remarquer que le point de vue d’une personne en matière de religion est un élément central de sa personne et que le Code protège les personnes contre la pression non sollicitée sur le plan religieux. La Commission a reconnu que le Code ne pouvait pas prévenir toutes les démarches ou conversations en matière de religion, mais a rappelé qu’il interdisait à quiconque de communiquer « avec insistance » un message religieux en milieu de travail, même si la personne était convaincue de l’importance de transmettre son message. Un employeur ou même un collègue doit éviter de tirer avantage de sa relation ou du milieu de travail pour exercer une pression indue sur un employé.
Plus récemment, dans Streeter c. HR Technologies[96], le TDPO a déterminé que, pris dans leur ensemble, les questions sur la religion posées à M. Streeter par l’employeur durant son entrevue et ses 12 années d’emploi dans l’entreprise, les discussions sur la religion et la prière entretenues au cours de réunions d’affaires et les séances hebdomadaires d’étude de la bible organisées chaque semaine avaient eu pour effet d’imposer un climat religieux auquel M. Streeter avait l’impression de devoir participer dans le cadre de son emploi. Selon le TDPO, les activités et discussions religieuses allaient au-delà de ce qu’on pourrait qualifier de « normal » dans un bureau, et constituaient une tentative de persuasion de M. Streeter afin qu’il épouse avec respect une question qui n’avait rien à voir avec les affaires de l’entreprise ou son travail d’employé.
Dans l’espoir apparent de reconnaître les droits contradictoires, le TDPO a pris soin de souligner que les discussions sur la religion ou les croyances religieuses de quelqu’un en milieu de travail ne sont pas nécessairement contraires au Code. Les gens doivent pouvoir exprimer leurs croyances religieuses sincères en milieu de travail, dans le respect des protections prévues dans le Code. Cependant, les employeurs ont aussi le devoir de respecter et de protéger le droit de leurs employés de vivre à l’abri de la discrimination fondée sur les croyances religieuses.
De l’avis du TDPO, le climat religieux du bureau a créé de l’inconfort, mais n’a pas eu d’autres répercussions négatives sur l’emploi de M. Streeter. Par conséquent, un montant de 3 500 $ a été versé en dommages à l’appelant pour atteinte à son droit de vivre à l’abri de la discrimination au travail.
Depuis ce temps, le TDPO s’est penché sur une autre affaire d’allégations de coercition en milieu de travail. Le TDPO a établi entre Lapcevic c. Pablo Neruda Non-Profit Housing Corporation[97] et Streeter une distinction importante, soit que l’appelante dans l’affaire Lapcevic n’avait fait l’objet d’aucune pression religieuse non sollicitée faisant de la religion une condition de son emploi, malgré le fait que son superviseur lui avait donné une Bible et avait entamé avec elle des discussions sur la religion.
Dans une affaire devant le Human Rights Tribunal de la Colombie-Britannique[98], deux jeunes employées se qualifiant d’athées se sont plaintes de discrimination fondée sur la religion en raison de l’impact de leur exposition aux croyances de leur employeur. Leur plainte a été rejetée puisqu’il a été déterminé que les croyances de l’employeur relativement au pouvoir de la pensée positive et des mots, sa pratique du reiki et son intérêt pour un livre intitulé Le secret ne constituaient pas des pratiques religieuses. Même si les croyances de l’employeur avaient été de nature religieuse, il n’y avait là aucune discrimination parce que les appelantes n’étaient pas tenues de participer à des pratiques religieuses ou de lire Le secret, et qu’il n’existait aucune preuve à l’appui du dénigrement par l’employeur de l’absence de croyances religieuses chez les appelantes. Bien qu’il puisse avoir été agaçant de devoir écouter l’employeur, il n’y avait pas suffisamment de preuve à l’appui du fait que cela avait nui à leurs croyances athéistes au point de constituer de la discrimination.
Dans Friesen c. Fisher Bay Seafood Ltd.[99], le Human Rights Tribunal de la Colombie-Britannique s’est penché sur une plainte pour discrimination déposée par un homme qui avait été mis à pied pour avoir refusé de cesser son prosélytisme au travail. M. Friesen était un employé fiable et compétent qui travaillait de nuit dans une usine de transformation du poisson, un poste qui est difficile à combler en permanence. Cependant, M. Friesen croyait sincèrement que la religion qu’il pratiquait exigeait qu’il « prêche et enseigne l’Évangile, convertisse et baptise des personnes » . Par conséquent, il s’obstinait à prêcher l’Évangile et à tenter de convertir ses collègues durant les heures de travail. Cela a occasionné des plaintes de la part d’autres employés qui ont ensuite dû être transférés au quart de jour. Quand M. Friesen est devenu superviseur, ses activités au travail sont devenues encore plus préoccupantes en raison de sa nouvelle position d’autorité. L’employeur a averti M. Friesen à plusieurs reprises de respecter les croyances de ses collègues et de cesser de prêcher l’Évangile et de tenter de convertir les employés durant les heures de travail. Il a été mis à pied après avoir refusé d’acquiescer.
Il est clair que M. Friesen a perdu son emploi uniquement en raison de sa pratique religieuse. Il a donc été établi qu’à première vue, il y avait eu discrimination. Il revenait par conséquent à l’employeur de prouver que l’obligation de ne pas prêcher l’Évangile durant les heures de travail constituait une exigence professionnelle justifiée. Le tribunal de la C.-B. a eu peu de difficulté à déterminer qu’il s’agissait bel et bien d’une exigence professionnelle justifiée compte tenu des droits contradictoires des autres employés.
L’employeur devait assurer le maintien d’un environnement dans lequel tous les employés, quels que soient leurs antécédents religieux, se sentaient à l’aise et respectés. L’employeur a correctement reconnu que les autres employés avaient le droit de croire aussi profondément que M. Friesen en leur propre religion ou athéisme, ainsi que le droit de ne pas être soumis aux croyances religieuses de leur superviseur. La réaction de l’employeur, qui a fait tout ce qu’il pouvait jusqu’au point de préjudice injustifié, n’était pas excessive. La plainte a été rejetée.
Autres droits et intérêts
La tension entre les droits à l’égalité et les droits de propriété s’est manifestée dans le contexte de la vente de biens-fonds et de l’utilisation de biens-fonds en copropriété. Dans une affaire survenue en Ontario, une commission d’enquête sur les droits de la personne n’a pas accepté qu’un propriétaire de chalet ait le « droit » de choisir à qui vendre son bien-fonds si cette décision était fondée sur la race, l’ascendance ou la couleur de l’acheteur intéressé. Dans Syndicat Northcrest c. Amselem[100], la Cour suprême du Canada s’est penchée sur le droit de résidents juifs d’installer des « souccahs » sur leurs balcons pour se conformer à une exigence religieuse durant un festival religieux annuel de neuf jours. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble soutenait que l’installation de ces structures temporaires sur certains balcons réduirait la valeur économique et esthétique de leur propriété et nuirait indûment à leur droit de propriété aux termes de la Charte des droits et liberté de la personne du Québec. Selon la Cour suprême, les prétendues atteintes aux droits et intérêts des copropriétaires ne correspondaient pas à la preuve et étaient, au mieux, minimaux. Compte tenu de la situation, la Cour a déterminé que les droits et libertés des résidents juifs en matière de religion, auxquels une interdiction des souccahs porterait une atteinte substantielle, « l’emporterait clairement » sur les inquiétudes non étayées des autres copropriétaires concernant la perte de valeur de leur propriété.
Dans plusieurs causes difficiles, la Cour suprême a dû se prononcer sur la relation entre l’intérêt de la société à l’égard de la protection de l’enfance contre les préjudices, les droits religieux protégés aux termes de l’alinéa 2(a) de la Charte et les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne prévus à l’article 7. Bien que le meilleur intérêt de l’enfant ne soit pas clairement inclus aux « droits » protégés par les lois sur les droits de la personne ou la Charte canadienne des droits et libertés, la Cour a fait remarquer que l’objectif de protection de l’enfance est conforme aux valeurs véhiculées dans la Charte.
Dans Young c. Young[101], la Cour suprême s’est penchée sur la rupture d’un mariage qui avait des répercussions sur le plan religieux. À la suite d’une séparation difficile, la mère a obtenu la garde des trois enfants du couple. Le père a obtenu un droit d’accès, mais en raison de préoccupations quant aux répercussions de ses activités religieuses sur les enfants, un juge lui a ordonné de s'abstenir de discuter de la religion des Témoins de Jéhovah avec les enfants, de les amener à des offices religieux ou à des réunions, ou de les mêler à des débats religieux avec des tierces personnes sans le consentement préalable de la mère. La Cour suprême a dû déterminer si les dispositions de la Loi sur le divorce qui exigeaient que les juges tiennent compte du « meilleur intérêt de l’enfant » au moment d’établir la garde et le droit d’accès contrevenaient à la liberté d’expression, à la liberté de religion et au droit à l’égalité du père. Malgré leur rejet de la restriction au motif que le meilleur intérêt des enfants dans cette affaire n’avait pas été démontré, la majorité des juges de la Cour suprême ont déterminé que le droit à la liberté de religion ne protégeait pas l’accès à des activités religieuses qui ne seraient pas dans le meilleur intérêt des enfants. Si une pratique religieuse cause un préjudice à l’enfant, les droits du parent doivent céder au meilleur intérêt de l’enfant.
À l’opposé, la majorité des juges de la Cour suprême ont déterminé dans B. (R.) c. Children’s Aid Society[102] que la liberté de religion protégeait la décision des parents de refuser qu’on fasse subir à leur nourrisson une transfusion sanguine qui pourrait potentiellement lui sauver la vie. Grâce à un processus prévu par la Child Welfare Act, la tutelle de l’enfant avait été confiée temporairement à la société d’aide à l’enfance, qui avait consenti à la transfusion sanguine. L’article 1 de la Charte justifiait l’atteinte grave aux droits des parents prévus à l’article 2(a). La Cour a opposé l’intérêt de l’État envers la protection des enfants à risque aux droits des parents, et jugé que l’intérêt de l’État prédominait.
Il est possible d’opposer quantité d’autres intérêts contradictoires aux droits protégés par la Charte et d’autres instruments juridiques de protection des droits de la personne. Par exemple, les décisions sur la pornographie et l’interdiction de la pornographie juvénile ont dû établir un équilibre entre la liberté d’expression, d’une part, et la moralité publique et les préjudices à l’égard des femmes et enfants, de l’autre. La limitation des droits protégés à l’article 7 de la Charte a aussi été réclamée au nom de la sécurité nationale. La portée du présent document ne s’étend cependant pas à l’étude des ces questions et d’autres questions connexes.
Défenses légales
Les lois sur les droits de la personne et la Charte prévoient des exceptions rendant la discrimination possible dans certaines situations. Dans bien des causes, les défenses légales sont une tentative d’enchâsser dans la loi la reconnaissance d’un droit contradictoire, et peuvent refléter les efforts déployés par les législateurs pour concilier différents droits contradictoires. Ces défenses traitent habituellement de questions comme l’éducation religieuse, la capacité de certains types d’organisations représentant les intérêts d’un groupe particulier de personnes de limiter l’adhésion aux personnes qui appartiennent à ce groupe, la capacité de limiter l’accès à certaines installations et types d’hébergement partagés selon le sexe, et le droit de dirigeants religieux de refuser de célébrer des mariages qui sont contraires à leurs croyances religieuses.
À l’occasion, les tribunaux judiciaires ont été appelés à interpréter et à appliquer les exemptions prévues par la loi. Bien que ces défenses limitent certains droits, ont souligné les tribunaux appelés à se prononcer, ils confèrent et protègent également d’autres droits. Par conséquent, il ne faut pas leur donner une interprétation trop restrictive. Les éléments de la défense doivent néanmoins s’appliquer aux circonstances de l’affaire.
Dans Caldwell c. Stewart[103], la Cour suprême a confirmé le droit d’une école catholique de refuser de rembaucher une enseignante catholique qui avait fait fi des règles de l’Église et contrevenu aux dogmes de la religion catholique en mariant un homme divorcé lors d’une cérémonie civile. La Cour a souligné le rôle spécial que jouent les enseignants catholiques en servant de « modèle conforme aux enseignements de l’Église » ainsi que la place fondamentale qu’occupe la formation religieuse et morale dans le programme scolaire. Par conséquent, les enseignants pouvaient être tenus de se conformer aux exigences religieuses et de montrer l’exemple en adoptant eux-mêmes des comportements qui feront en sorte que les élèves, dans le cadre de leur « éducation catholique », verront comment sont mises en pratique les exigences de l’Église. Étant donné la nature particulière de l’école, la Cour a déterminé que le fait d’accepter et d’observer les exigences de l’Église constituait une exigence réelle relative à l’emploi.
La Cour a également examiné le bien-fondé d’appliquer l’article 22 du Human Rights Code de la Colombie-Britannique, qui permettait aux organismes ou groupements charitables, philanthropiques, religieux, sociaux ou d’entraide, sans but lucratif, qui ont pour objectif principal la promotion des intérêts d’une catégorie ou d’un groupe identifiable de personnes caractérisées par la communauté de race, de religion, d’âge, de sexe ou autre, de donner la préférence aux membres de ce groupe ou de cette catégorie. Selon la Cour, cet article limite les droits de certains, mais protègent les droits d’autres personnes, particulièrement le droit d’association et de promotion de la religion. La défense reflétait l’intention de l’assemblée législative de protéger les droits des écoles confessionnelles et autres établissements du genre et, en tant que tel, ne devrait pas être interprétée de façon restrictive. La Cour a jugé que la défense s’appliquait à la situation et, par conséquent, que le congédiement de Mme Caldwell ne contrevenait pas au Code. La Cour suprême a conclu que le conflit opposant les deux droits légaux visés dans cette affaire devait être résolu au bénéfice de l’école.
Plus tard, la Cour suprême a émis une conclusion similaire dans l’affaire Brossard (ville) c. Québec (Commission des droits de la personne)[104], une cause relative à l’application de la Charte des droits et liberté de la personne du Québec dans le cadre de laquelle une plainte pour discrimination avait été déposée à l’endroit de la politique d’embauche d’une ville qui interdisait l’embauche, à titre d’employés de la ville, des membres de la famille immédiate des employés à plein temps et des conseillers municipaux. La défense en cause était la suivante (à l'époque) : « Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d'une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien- être d'un groupe ethnique est réputée non discriminatoire. » De l’avis de la Cour, l’exemption offerte aux institutions charitables, philanthropiques, religieuses, politiques et éducatives avait un double objectif. Bien qu'il limite le droit de certaines personnes de vivre à l'abri de la discrimination dans le domaine de l'emploi, l'article confère aussi des droits à certaines personnes, à savoir le droit à la liberté d'association aux fins d'exprimer des opinions particulières ou de participer à certaines activités, sans contrevenir à la Charte : « Il a pour effet d'établir la primauté des droits du groupe sur les droits de l'individu dans des circonstances précises. »[105]
La cour d’appel de la Colombie-Britannique a appliqué la décision Caldwell à l’affaire Vancouver Rape Relief Society c. Nixon[106], qui opposait les droits d’une femme transgenre à ceux d’une organisation féministe offrant des services aux femmes victimes de mauvais traitements infligés par des hommes. La Vancouver Rape Relief Society a décidé que Kimberly Nixon, décrite comme une femme transsexuelle postopératoire, ne pouvait pas suivre une formation pour devenir bénévole en accompagnement de pairs parce qu’elle n’avait pas toujours été une femme et avait vécu en tant qu’homme. La cour avait décrit l’affaire comme un litige entre, d’une part, une société sans but lucratif créée pour aider des personnes perçues par les membres comme étant marginalisées et désavantagées par les hommes et, de l’autre, une personne qui est membre d’un groupe marginalisé.
Le tribunal a déterminé que, malgré que les actions de la société remplissaient les critères de discrimination, l’exemption concédée aux organisations sans but lucratif par l’article 41 du Human Rights Code de la Colombie-Britannique s’appliquait et protégeait la société de toute responsabilité dans cette affaire. Le tribunal a souligné le fait que cette défense avait été prévue dans le Code pour régler des questions de droits contradictoires : « Si, comme j’en ai conclu ici, l’assemblée législative a déterminé que certains comportements étaient interdits et a établi les défenses permissibles, il me semble que celle-ci, en sa qualité de législatrice, a établi l’équilibre entre les droits contradictoires d’une façon dont on ne peut faire fi et que l’on doit présumer juste. » Le tribunal a rejeté une application excessivement rigoureuse de la défense qui exigeait que la société démontre que son objectif premier était de promouvoir les intérêts des femmes qui ont vécu toute leur vie en tant que femmes pour pouvoir obtenir la protection de l’article 41. Le tribunal a plutôt déterminé que la société avait le droit d’avoir une « préférence interne » en ce qui a trait au groupe qu’elle dessert et d’admettre uniquement des femmes qui ont vécu toute leur vie en tant que femme à leur formation en accompagnement bénévole de pairs.
En Ontario, Commission ontarienne des droits de la personne c. Christian Horizons[107], une cause importante récente, traitait de la faculté d’une organisation religieuse qui exploitait des foyers résidentiels et des colonies de vacances pour personnes ayant une déficience intellectuelle de se prévaloir de la défense spéciale en matière d’emploi prévue à l’alinéa 24(1)(a)[108] du Code des droits de la personne de l’Ontario dans le cadre d’une plainte relative à de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle déposée contre elle. Connie Heintz, une préposée aux services de soutien dans l’un des foyers exploités par Christian Horizons avait signé la déclaration de style de vie et de bonnes mœurs exigée par son employeur. La déclaration incluait les « rapports homosexuels » au nombre des comportements inappropriés rejetés par Christian Horizons.
Plusieurs années après son embauche, Mme Heintz en est venue à mieux comprendre son orientation sexuelle et a entrepris une relation entre personnes de même sexe. Quand son employeur a pris connaissance de cela, il lui a offert du counseling pour l’aider à se conformer à la déclaration de style de vie et de bonnes mœurs interdisant l’« homosexualité ». Par la suite, Mme Heintz allègue qu’elle a fait l’objet de mesures disciplinaires injustes concernant son attitude et son rendement, et été exposée à un climat de travail empoisonné.
Christian Horizons a reconnu que son organisation faisait de la discrimination à l’endroit de Mme Heintz à moins de pouvoir se prévaloir de la défense prévue à l’alinéa 24(1)(a). Mais pour pouvoir se prévaloir de cette défense, Christian Horizons devait démontrer : (1) qu’il s’agit d’un « organisme religieux » (2) « dont le principal objectif est de servir les intérêts de personnes identifiées par » la croyance et qui n’emploie que des personnes ainsi identifiées et (3) que cette qualité requise est exigée de façon raisonnable et de bonne foi compte tenu de la nature de l’emploi.
Le premier critère était facilement satisfait. En ce qui a trait au second, le TDPO a déterminé que Christian Horizons ne servait par principalement des personnes identifiées par la croyance étant donné que sa mission principale consistait à procurer des soins et du soutien aux personnes ayant une déficience intellectuelle, sans égard à la croyance. La Cour divisionnaire a cependant renversé cette conclusion, en s’appuyant sur les décisions Caldwell et Brossard de la Cour suprême du Canada. Selon la Cour divisionnaire, l’alinéa 24(1)(a) ne devrait pas être interprété de façon restrictive parce que, bien qu’il limite certains droits, il confère également le droit d’association à certains groupes afin qu’ils puissent se réunir pour exprimer leurs points de vue et mené des activités conjointes. En interprétant l’article, qui cherchait selon le tribunal à établir un équilibre entre les droits de certains groupes et les droits à l’égalité, le TDPO devrait avoir pris en considération la garantie de liberté de religion accordée aux membres d’organisations religieuses : « Une application de l’alinéa 24(1)(a) qui tient compte, au moment de déterminer l’activité première d’une organisations religieuse, du point de vue de l’objectif de l’organisation est conforme à la garantie de liberté de religion. »[109]
En mettant en application l’interprétation appropriée, la Cour divisionnaire a établi que le travail de bienfaisance de Christian Horizons constituait une activité religieuse au moyen de laquelle les membres exprimaient leur foi chrétienne et exerçaient leur ministère chrétien. Par conséquent, sa mission principale était de desservir les intérêts de ses membres. Les clients atteints de déficience intellectuelle profitaient indirectement de cette mission.
Cependant, en ce qui a trait à la troisième exigence de l’alinéa 24(1)(a), c’est-à-dire que la qualité requise soit exigée de façon raisonnable et de bonne foi, la Cour divisionnaire s’est rangée du côté du TDPO en indiquant que Christian Horizons n’avait pas démontré que le respect de la déclaration de style de vie et de bonnes mœurs, y compris son interdiction des relations entre personnes de même sexe, était nécessaire à l’exécution des tâches essentielles du travail de préposé aux services de soutien. Ces préposés ne participaient pas activement à la promotion d’un mode de vie évangélique. D’ailleurs, il n’était pas nécessaire que les résidents soient des chrétiens évangéliques. De plus, l’interdiction des relations entre personnes de même sexe n’était pas essentielle à la bonne exécution des responsabilités des préposés aux services de soutien, qui comprennent la cuisine, le nettoyage et l’aide aux patients pour les repas. Par conséquent, contrairement à Caldwell, où le rôle de l’enseignant incluait la transmission des croyances catholiques au moyen de l’enseignement et de l’adoption de comportements appropriés, aucun aspect de la nature de l’emploi de préposé ne faisait de l’absence de relations entre personnes de même sexe une qualité requise. Par conséquent, Christian Horizons n’a pas été en mesure d’établir la troisième exigence d’une défense fondée sur l’alinéa 24(1)(a), et la Cour a conclu qu’il y avait eu discrimination.
De façon similaire, dans l’affaire Knights of Columbus présentée en détail à la section Liberté de religion et droits de la personne/à l’égalité, le Human Rights Tribunal de la Colombie-Britannique a rejeté l’argument des Knights of Columbus selon lequel ils étaient en droit de louer de préférence leur salle à des membres de leur propre groupe religieux aux termes de l’article 41 du Code de la C.-B., soit l’article même qui a fourni à l’école catholique sa défense dans Caldwell et à l’organisation féministe la sienne dans Nixon. Après examen de la preuve, le tribunal a établi que la salle était mise à la disposition du public et non seulement à la disposition des membres de la communauté catholique. Aucune préférence n’était donnée aux Catholiques. L’accès avait été refusé aux plaignantes parce qu’elles souhaitaient y célébrer un mariage entre personnes de même sexe, et non parce que l’organisme accordait la préférence à un autre groupe qui partageait ses croyances religieuses.
L’examen des défenses en matière de discrimination prévues dans les lois sur les droits de la personne fait clairement ressortir plusieurs éléments importants. Premièrement, contrairement aux défenses en matière de droits de la personne qui limitent les droits d’une personne en fonction des intérêts en jeu (comme des intérêts pécuniaires), les défenses qui reconnaissent les droits contradictoires d’autres groupes de la société et en font la promotion ne doivent pas être interprétées de façon trop restrictives. Deuxièmement, malgré cette approche interprétative, il doit être démontré que la défense invoquée s’applique au cas présenté. Enfin, ce dernier point exige la pleine considération du contexte de l’affaire, en fonction de la preuve. En particulier, une organisation cherchant à se prévaloir d’une défense particulière doit être en mesure de démontrer, au moyen d’éléments de preuve objectifs, qu’il y a un lien entre les gestes discriminatoires envers autrui et la jouissance des droits de son propre groupe.
Conclusion
Ce document a présenté une analyse des plus importantes décisions judiciaires traitant des droits contradictoires, ainsi que les grands thèmes et tendances de l’approche juridique en matière de conflits de droits. Il a aussi décrit bon nombre de circonstances où des décideurs ont été appelés à résoudre des différends sur le plan des droits. Nous espérons bien qu’il portera assistance à ceux et celles qui ont la difficile tâche de déterminer comment résoudre une situation opposant des droits contradictoires.
Bien que ces décisions ne concernent pas toutes directement des questions de discrimination, un grand nombre de valeurs à la base des protections des droits de la personne, dont le respect pour la dignité humaine, l’engagement envers la justice sociale et l’égalité, la prise en compte de diverses croyances et circonstances, ainsi que la protection des personnes vulnérables et des groupes minoritaires, sont des principes dont il faut systématiquement tenir compte pour concilier ou limiter de façon appropriée des droits. C’est ce que la Cour suprême du Canada a soutenu dans plusieurs décisions, dont sa décision de principe dans R. c. Oakes, qui énonce les critères à appliquer pour déterminer si une atteinte aux droits protégés par la Charte peut être justifiée dans une société libre et démocratique :
[L]es tribunaux doivent être guidés par des valeurs et des principes essentiels à une société libre et démocratique, lesquels comprennent, selon moi, le respect de la dignité inhérente de l’être humain, la promotion de la justice et de l’égalité sociales, l’acceptation d’une grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de chaque groupe et la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société.
Les valeurs et les principes sous-jacents d’une société libre et démocratique sont à l’origine des droits et libertés garantis par la Charte et constituent la norme fondamentale en fonction de laquelle on doit établir qu’une restriction d’un droit ou d’une liberté constitue, malgré son effet, une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer[110]
Il est intéressant de constater que ces mots font écho aux valeurs et principes de protection des droits de la personne énoncés dans le préambule du Code des droits de la personne de l’Ontario et les diverses lois du pays en matière de droits de la personne.
[1] (2002), 20 S.C.L.R. (2d) 137, 140.
[2] R. v. N.S., 2010 ONCA 670, par. 47 [ci-après la « décision sur le niqab »].
[3] Idem, par. 97.
[4] Exemples de ce qu'il ne faut pas faire dans une situation de droits contradictoires : (1) traiter le droit comme absolu; (2) traiter un droit comme intrinsèquement supérieur à un autre; (3) accepter une hiérarchie des droits; et (4) examiner les droits d'une façon abstraite sans tenir compte des faits.
[5] La Cour suprême du Canada a récemment accordé le droit de faire appel d'une décision de la Cour d'appel de la Saskatchewan qui traitait d'un conflit entre la liberté d'expression et de religion et une disposition du Code des droits de la personne de la Saskatchewan interdisant une publication qui expose des personnes à la haine et au ridicule, dénigre ou porte atteinte à la dignité en vertu d'un motif de discrimination interdit. Il semble donc probable que la Cour suprême énoncera d'autres principes dans son jugement dans ce domaine après l'audition de l'appel. Voir Whatcott v. Saskatchewan (Tribunal des droits de la personne), 2010 SKCA 26 (CanLII), droit d'interjeter appel à la CSS octroyé le 28 octobre 2010.
[6] Trinity Western University c. British Columbia College of Teachers, [2001] 1 R.C.S. 772, par. 29, P. (D.) v. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141, par. 182, B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315, par. 226.
[7] Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835.
[8] Commission canadienne des droits de la personne c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697.
[9] Ross c. New Brunswick School District No. 15, [1996] 1 R.C.S. 825.
[10] Il peut y avoir une hiérarchie entre des droits protégés par la Charte et des droits non protégés par la Charte, et entre des droits protégés par le Code et des droits non protégés par le Code. La Charte l'emporte sur toutes les lois du Canada. Par ailleurs, les droits quasi-constitutionnels contenus dans les lois sur les droits de la personne l'emportent généralement sur les droits juridiques non-constitutionnels (voir par exemple le paragraphe 47 (2) du Code des droits de la personne de l'Ontario).
[11] Dagenais, supra note 7; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668, par. 61.
[12] Trinity Western, supra note 6, par. 31; Dagenais, supra note 7, p. 877.
[13] Décision sur le niqab, supra note 2, par. 49 et 65.
[14] Par exemple, une réclamation invoquant une ingérence dans la liberté de religion peut ne pas être légitime si, selon les faits de l'espèce et le contexte pertinent, la croyance religieuse invoquée n'est pas sincère. Dans l'arrêt Bothwell v. Ontario (Minister of Transportation), 2005 CanLII 1066 (C. S. OND.C.), le tribunal a examiné tous les éléments de preuve concernant l'objection du demandeur à la prise d'une photo pour le permis de conduire pour des motifs religieux, et conclu que le demandeur n'avait pas réussi à établir une croyance religieuse sincère comme expliqué dans la décision de la Cour suprême du Canada, à l'arrêt Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 SCC 47 (CanLII), [2004] 2 R.C.S. 551. Le tribunal a tenu compte, en partie, du fait que le demandeur avait soulevé plusieurs points relatifs à la protection de la vie privée, plutôt que d'ordre religieux, et que ses actions étaient contraires aux croyances religieuses qu'il avait fait valoir. Autre exemple d'omission de prouver le droit : si le droit à la liberté d'expression concerne une activité qui (1) ne transmet pas ni ne tente de transmettre une signification et qui est donc une expression sans contenu, ou (2) qui transmet une signification par une forme d'expression violente, il ne relève pas du champ des activités protégées; voir Irwin Toy Ltd. c. Procureur général du Québec, [1989] 1 R.C.S. 927.
[15] Voir par exemple : Giguere v. Popeye Restaurant, 2008 HRTO 2 (CanLII) qui cite plusieurs décisions en matière de droits de la personne. Dans l'arrêt Giguere, le Tribunal a affirmé ceci : « Les droits et intérêts économiques ne priment pas sur les droits de la personne, à moins qu'il existe une exemption spécifique dans la loi. » (par. 77).
[16] Grant v. Willcock (1990), 13 C.H.R.R. D/22 (Ont. Bd. of Inquiry).
[17] Dans la décision sur le niqab, le tribunal a souligné que contrairement au droit de l'accusé de présenter une défense pleine et entière dans un procès équitable, le droit d'un témoin à la liberté de religion ne découle pas intrinsèquement de sa participation à une instance criminelle. Le témoin qui veut exercer une pratique religieuse tout en témoignant doit établir que la pratique relève du droit à la liberté de religion. À cette fin, il est presque inévitable d'appeler ce témoin à démontrer le lien entre la pratique et ses croyances religieuses, bien que dans la plupart des cas l'interrogatoire soit relativement simple; décision sur le niqab, supra note 2, par. 65-66. Dans une décision du Human Rights Tribunal de la C.-B., le tribunal a estimé qu'il n'était pas possible de « conclure à un lien » entre le traitement préjudiciable que la partie aurait reçu et ses croyances religieuses, sur la base des faits allégués. En conséquence, il n'existait pas suffisamment de preuves pour établir qu'un droit religieux était invocable; Chiang v. Vancouver Board of Education, 2009 B.C.H.R.T. 319, par. 115.
[18] [2008] 2 R.C.S. 483.
[19] Comme établi dans des décisions telles que R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075.
[20] Mills, supra note 11; Trinity Western, supra note 6.
[21] Danson c. Ontario (Procureur général), 1990 CanLII 93 (S.C.C.), [1990] 2 R.C.S. 1086, à 1099-1101; MacKay v. Manitoba, 1989 CanLII 26 (S.C.C.), [1989] 2 R.C.S. 357, à 362-363, 366; Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 1992 CanLII 116 (S.C.C.), [1992]
1 R.C.S. 236 at 253-255.
[22] Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 R.C.S. 698, par. 46. Donner des autocollants en forme d'arc-en-ciel à un enseignant (qui démontre son soutien pour les gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres), en lui laissant le choix d'exposer les autocollants, a été considéré comme ne créant pas de désavantage pour les droits religieux; Chiang, supra note 17, par. 36.
[23] Trinity Western, supra note 6.
[24] B. (R.) v. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, supra note 6.
[25] Dans Amselem, supra note 14, la Cour suprême s'est refusée à opposer la liberté de religion et le droit à la jouissance paisible et à la libre disposition des biens, puisque les incidences sur ce dernier étaient jugées « tout au plus minimes » et ne pouvaient pas être considérées comme limitant véritablement la liberté de religion (par. 57 et 60).
[26] Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, supra note 22.
[27] Dans Brockie v. Brillinger (No. 2), (2002), 43 C.H.R.R. D/90 (Ont. Sup.Ct.), la Cour divisionnaire a fait observer que l'exercice, par M. Brockie, de son droit à la liberté de religion sur le marché commercial est, au mieux, aux confins du droit. C'est pourquoi les limites imposées à son droit à la liberté de religion ont été jugées justifiées si l'exercice de ce droit portait atteinte aux droits d'autrui, à savoir le droit d'autres personnes en vertu du Code à vivre à l'abri de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Le tribunal a laissé ouverte la possibilité d'atteindre une conclusion différente si les documents à imprimer avaient un contenu « qui pourrait raisonnablement être considéré comme contraire aux éléments fondamentaux des croyances religieuses de M. Brockie » (par. 56).
[28] Ross, supra note 9.
[29] Chamberlain c. Surrey School District No. 36, [2002] 4 R.C.S. 710, par. 19-21 et 33.
[30] Décision sur le niqab, supra note 2, par. 88-89; Mills, supra note 11, par. 89.
[31] Décision sur le niqab, supra note 2, par. 84.
[32] [1995] 4 R.C.S. 411.
[33] [1984] 2 R.C.S. 603.
[34] p. 626.
[35] Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), [1988] 2 R.C.S. 279. La disposition en cause était la suivante (à l'époque) : « Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d'une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien- être d'un groupe ethnique est réputée non discriminatoire. »
[36] Ontario Human Rights Commission v. Christian Horizons, 2010 ONSC 2105 (CanLII).
[37] Martinie v. Italian Society of Port Arthur (1995), 24 C.H.R.R. D/169 (Ont. Bd. of Inquiry).
[38] Supra note 7.
[39] Idem, p. 877.
[40] [2001] 4 R.C.S. 411.
[41] Idem, par. 28.
[42] Idem, par. 37.
[43] [2002] 2 R.C.S.522.
[44] August v. Richland Marketing Inc., 2003 HRTO 25 (CanLII); Nourhaghighi v. Toronto Catholic District School Board, 2009 HRTO 1519 (CanLII); Steele v. Ontario (Minister of Community Safety and Correctional Services), 2010 HRTO 1019 (CanLII); XY v. Ontario (Government and Consumer Services), 2010 HRTO 1906 (CanLII).
[45] Voir, par exemple, Marakkaparambil v. Ontario (Health and long term care), 2007 HRTO 24 (CanLII).
[46] XY, supra note 44, au par. 12.
[47] Supra note 32.
[48] La procédure établie dans O’Connor crée un mécanisme général en common law pour ordonner la production de tout dossier qui n’est pas en la possession du poursuivant ou sous son contrôle et ne s’impose pas que dans les cas où les dossiers en la possession de tiers ouvrent droit à une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée; R. c. McNeil, [2009] 1 R.C.S. 66.
[49] Supra note 11, au par. 61.
[50] Idem
[51]Le tribunal judiciaire admet une certaine hiérarchie des droits lorsqu’il conclut que le droit à une défense pleine et entière doit l’emporter sur le droit à la vie privée advenant le cas où l’on déterminerait, après établissement de la pleine portée des droits que fait intervenir le contexte factuel d’une affaire, que le droit à une défense pleine et entière d’un l’accusé est compromis. Voir aussi la décision sur le niqab.
[52] Supra note 48.
[53] [1997] 1 R.C.S. 157, au par. 36.
[54] Voir McEwan v. Commercial Bakeries Corporation, 2004 HRTO 13 (CanLII); Washington v. Toronto Police Services Board, 2009 HRTO 217 (CanLII); et King v. Toronto Police Services Board, 2009 HRTO 64 (CanLII).
[55] Une interdiction de publication a été ordonnée dans cette affaire et seules les initiales de la victime et des accusés présumés ne peuvent être rapportées.
[56] Supra note 2, au par. 45.
[57] Idem, au par. 97.
[58] Idem, au par. 83.
[59] Il est à noter que dans certaines circonstances, des éléments de preuve pertinents peuvent être entendus par les tribunaux judiciaires sous forme de transcriptions, et certains témoins (p. ex. des enfants) peuvent avoir le droit de témoigner derrière un écran. Voir le Code criminel, articles 709 à 713 et R. c. Levogiannis, [1993] 4 R.C.S. 475.
[60] Voir Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR Inc., 2011 SCC 9, au par. 17. Cette affaire traitait d’une plainte pour diffamation déposée par un groupe de chauffeurs de taxi de Montréal à la suite de propos racistes formulés par un animateur de radio-provocation à l’endroit des chauffeurs dont la langue maternelle était l’arabe ou le créole. D’avis que des personnes n’ont pas droit à des dommages pour leur simple appartenance à un groupe qui a fait l’objet de commentaires choquants, la Cour a rejeté le recours collectif. La majorité des juges ont déterminé que, puisque le droit de la diffamation est un outil de protection de la réputation personnelle, un membre du groupe devrait être en mesure de prouver qu’un citoyen ordinaire aurait cru qu’il avait personnellement subi un préjudice à sa réputation. Selon la majorité des juges, ce n’était pas le cas ici. Dans cette affaire, le groupe de chauffeurs de taxi était grand (1 100 personnes) et diversifié et les propos formulés constituaient une « généralisation extrême, irrationnelle et sensationnaliste ». Par conséquent, la Cour a déterminé que les remarques de l’animateur n’avaient pas causé de préjudice à la réputation de chaque chauffeur de taxi arabe et créole, et a rejeté l’appel.
[61] Idem
[62] [1990] 3 R.C.S. 892.
[63] Supra note 8.
[64] À l’opposé, dans R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731, la Cour suprême a jugé que l’infraction consistant à diffuser de fausses nouvelles était inconstitutionnelle et l’a abolie.
[65] Supra note 7.
[66] Plus précisément, la commission a ordonné au conseil scolaire de prendre les mesures suivantes : a) mettre M. Ross en congé sans solde pour une période de 18 mois, b) l'affecter à un poste de non-enseignant si un tel poste s'ouvre pendant cette période, c) mettre fin à son emploi à la fin de cette période si, dans l'intervalle, on ne lui a pas offert et il n'a pas accepté un poste de non-enseignant, et d) mettre fin à son emploi auprès du conseil scolaire immédiatement s'il publie, produit ou vend des écrits antisémites. La Cour suprême a conclu que le remède violait les alinéas 2a) et b) de la Charte canadienne des droits et libertés, mais que les parties a), b) et c) de l’ordonnance étaient justifiées en vertu de l'article 1 de la Charte. Selon la Cour, la partie d) n’était pas justifiée en ce qu’elle empiétait davantage sur les droits de M. Ross qu’il ne l’était nécessaire pour prévenir la création d’un climat scolaire empoisonné (étant donné que M. Ross n’occuperait plus un poste d’enseignant).
[67] Idem, au par. 72
[68] [1986] 1 R.C.S. 103.
[69] Saskatchewan (Human Rights Commission) v. Bell (c.o.b. Chop Shop Motorcycle Parts), 1994 CanLII 4699, 21 C.H.R.R. D/147 (SK CA). L’intimé a distribué des autocollants illustrant des caricatures de certains groupes racialisés. Un cercle rouge traversé d’une barre rouge était placé sur les personnages, pour indiquer que leur présence était « interdite ». Cela violait la disposition pertinente du Code de la Saskatchewan étant donné que les autocollants (1) ont été mis à l’étalage et vendus dans un magasin ouvert au public, (2) avaient tendance à exposer des groupes particuliers à de la haine et au ridicule en raison de leur race et religion et (3) encourageaient d’autres personnes à adopter des pratiques discriminatoires contre ces groupes. Dans une cause traitant de la discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle dans le contexte de services (par opposition à une disposition sur les droits de la personne dans le contexte de l’expression directe), un tribunal a déterminé que le droit à la liberté d’expression d’un comédien n’englobait pas celui d’agresser physiquement et verbalement une cliente lesbienne d’un restaurant. Sa conduite n’a pas été jugée « comique » et n’était pas raisonnablement liée à des efforts en vue de résoudre un cas de perturbation de son spectacle; Pardy v. Earle and others (No. 4), 2011 BCHRT 101 (CanLII).
[70] Par exemple, des membres de la communauté musulmane ont déposé des plaintes auprès de l’Alberta Human Rights Commission alléguant que des dessins publiés dans le magazine Western Standard étaient « anti-islam et racistes », et qu’ils « avaient été reproduits dans le but d’inciter à la haine contre le Prophète et l’Islam ». La Commission de l’Alberta a rejeté la plainte en indiquant qu’à la lumière du plein contexte entourant la reproduction des dessins, du langage puissant de la jurisprudence concernant ce qui constitue de la haine et du mépris, et du besoin d’établir un équilibre entre la liberté d’expression et les droits de la personne, il n’existait pas de justification raisonnable pour tenir une audience. En 2008, la Commission ontarienne des droits de la personne a conclu qu’elle n’avait pas la compétence requise aux termes du Code de l’Ontario pour entendre des plaintes sur un article paru dans le magazine Macleans.
[71] Par exemple, dans Owens v. Saskatchewan (Human Rights Commission), 2006 SKCA 41 (CanLII), la Cour d’appel de la Saskatchewan a conclu que les annonces de journaux reflétant le point de vue de M. Owen sur « l’homosexualité » n’avaient pas contrevenu au Code de la Saskatchewan.
Par exemple, Elmasry v. Rogers Publishing Ltd. (No. 4) (2008), 64 C.H.R.R. D/509, 2008 BCHRT 378 a rejeté des plaintes déposées au nom de citoyens musulmans de la Colombie-Britannique concernant un article publié dans le magazine Macleans. Les plaignants n’ont pas pu démontrer que l’article était susceptible de les exposer à de la haine ou du mépris fondé sur leur religion.
[72] 2010 HRTO 2152.
[73] Supra note 4.
[74] Supra note 6.
[75] Supra note 22.
[76] 2011 SKCA 3 (CanLII).
[77] Supra note 27.
[78] En particulier dans R. c. Big M Drug Mart, [1985] 1 R.C.S. 295, Ross, supra note 9 et Trinity Western, précité, note 6.
[79] La Cour a modifié en conséquence l’ordonnance de la Commission selon laquelle M. Brockie doit fournir des services d’impression aux personnes gaies et lesbiennes, et à leurs organisations, en y ajoutant que cela s’applique pourvu que « cette ordonnance n’exige pas de M. Brockie ou de Imaging Excellence qu’ils impriment des documents d’une nature que l’on pourrait raisonnablement considérer comme étant en conflit direct avec les éléments de base de ses croyances religieuses ».
[80] (2005), 55 C.H.R.R. D/10, 2005 BCHRT 544.
[81] Supra note 29.
[82] 2002 CanLII 49475 (ON SC).
[83] Le critère en trois étapes à appliquer est le suivant : (1) Le litige concerne-t-il une question sérieuse? C’est-à-dire est-ce une affaire dont le fond juridique est suffisant pour justifier l'intervention extraordinaire de la cour sans aucun procès? (2) Le demandeur subira-t-il un préjudice irréparable si l’injonction interlocutoire n’est pas allouée? (3) Le remède est-il justifié selon la prépondérance des inconvénients? I.e. Quelle partie subira le plus grand préjudice si l’injonction est refusée ou allouée d’ici à ce que le litige soit résolu? Voir Hall, Idem, au par. 11.
[84] L’article 93 avait pour but de préserver et de protéger les écoles confessionnelles et constituait un élément fondamental du « compromis de la Confédération ».
[85] Voir la section Conflits liés à des droits religieux différents pour obtenir d’autres renseignements sur les droits protégés aux termes de l’article 93.
[86] Supra note 17.
[87] Dallaire v. Les Chevaliers de Colomb, 2011 HRTO 639 (CanLII).
[88] 2011 HRTO 775 (CanLII).
[89] Supra note 78.
[90] [1986] 2 R.C.S. 713.
[91] La juge Wilson était en désaccord dans une certaine mesure. La loi accordait une exemption aux détaillants qui n’ouvraient pas le samedi, mais seuls les petits magasins pouvaient en profiter en raison de restrictions sur le plan de la taille. La juge aurait aboli les restrictions relatives à la taille pour leur permettre de s’appliquer à tous les détaillants qui observaient le sabbat le samedi, quelle qu’en soit la taille. Plus tard, l’Assemblée législative de l’Ontario a modifié la loi en retirant les restrictions relatives à la taille.
[92] Zylberberg v. Sudbury Board of Education, 1988 CanLII 189 (ON C. A.).
[93] 2004 CanLII 13978 (ON S.C.).
[94] [1996], 3 R.C.S. 609.
[95] (1989), 10 C.H.R.R. D/6153 (Ont. Bd. of Inquiry).
[96] 2009 HRTO 841 (CanLII).
[97] 2010 HRTO 927 (CanLII)
[98] Young and Young on behalf of Young v. Petres, 2011 BCHRT 38 (CanLII). L’affaire traitait aussi des attouchements non sollicités de l’employeur, qui constituaient du harcèlement sexuel selon la décision du tribunal.
[99] (2008), 65 C.H.R.R. D/400, 2009 BCHRT 1.
[100] Supra note 14.
[101] [1993], 4 R.C.S. 3. Dans une autre affaire jugée au même moment, le tribunal a maintenu l’interdit d’endoctrinement « continuel » de l’enfant à la religion des Témoins de Jéhovah par le parent ayant droit d’accès, la majorité des juges ayant accepté le point de vue du juge de première instance selon lequel cela était nécessaire pour protéger le meilleur intérêt de l’enfant.
[102] [1995] 1 R.C.S. 315.
[103] Supra note 33.
[104] [1988] 2 R.C.S. 279.
[105] Idem, au par. 100.
[106] 2005 BCCA 601; 55 C.H.R.R. D/67.
[107] 2010 ONSC 2105 (CanLII).
[108] Alinéa 24(1)(a) : Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi le fait : (a) qu’un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les intérêts de personnes identifiées par la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la croyance, le sexe, l’âge, l’état matrimonial ou un handicap n’emploie que des personnes ainsi identifiées ou leur accorde la préférence si cette qualité requise est exigée de façon raisonnable et de bonne foi compte tenu de la nature de l’emploi.
[109] Christian Horizons, supra note 107, au par. 71.
[110] Supra note 66, au par. 64.