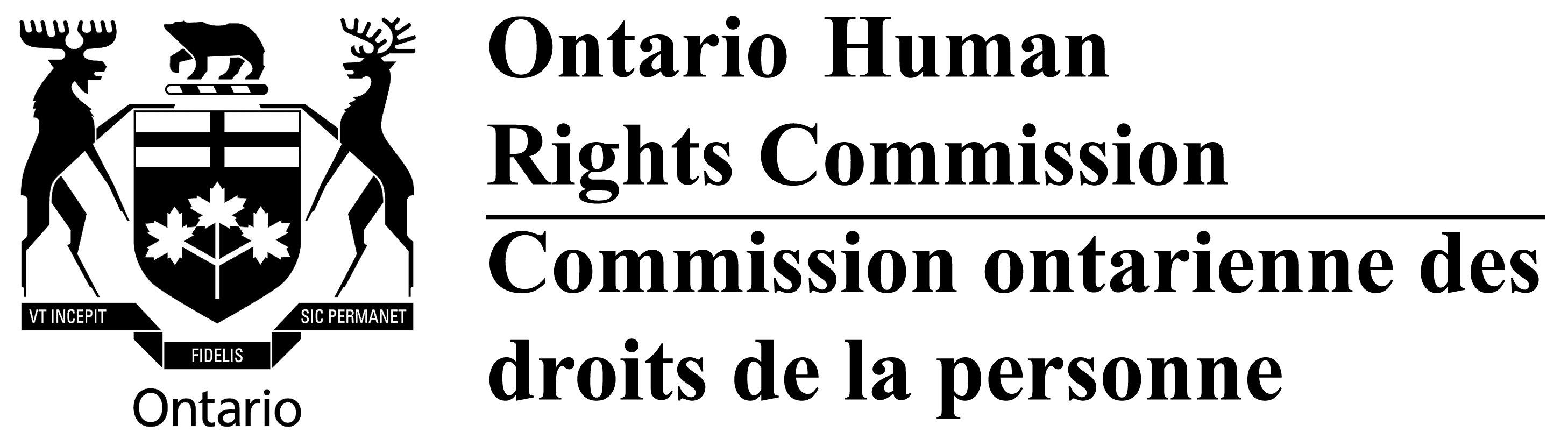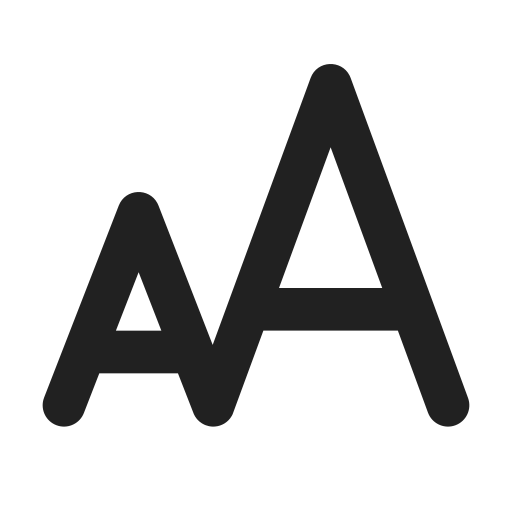Table des matières
3. Code des droits de la personne de l’Ontario
4. Discrimination dans les commerces de détail
Annexe I : Que pouvez-vous faire si vous pensez avoir été victime de discrimination?
Ressources supplémentaires
À titre de supplément pratique, deux fiches d’information qui résument certains éléments clés du guide sont disponibles :
Avertissement : Le présent guide traite de sujets susceptibles d’être traumatisants pour certains lecteurs. Le guide mentionne les mauvais traitements et la discrimination raciale que subissent les membres des Premières Nations, les Inuit, les Métis et les Autochtones vivant en milieu urbain. Veuillez prendre soin de vous-même en lisant ce document. De nombreuses ressources sont à la disposition des lecteurs qui auraient besoin de soutien, dont certaines sont affichées sur le site Web de la Commission ontarienne des droits de la personne, à : https://www.ohrc.on.ca/fr/liste-des-supports.
1. Introduction
De nombreux Autochtones* se trouvent confrontés à des actes de discrimination lorsqu’ils fréquentent des magasins, parfois à cause de la pratique du profilage racial. C’est notamment le cas lorsque des propriétaires de commerce ou des employés se livrent à de la surveillance ciblée, font des commentaires dérogatoires envers des clients autochtones en raison de leur ascendance, de leur race ou de leur culture, ou refusent sans raison de servir des clients autochtones. Une personne autochtone peut aussi être victime de discrimination lorsqu’elle veut utiliser sa carte de statut pour s’identifier ou demander une exemption fiscale ou qu’elle présente un autre document délivré aux Autochtones comme pièce d’identité (p. ex., le numéro de client du Programme des services de santé non assurés (Programme des SSNA)).
Consciente de cette réalité, la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP)[1] et le Programme des droits de la personne des peuples autochtones (un partenariat entre Étudiant(e)s pro bono du Canada (EPBC)[2] et la Fédération des centres d’amitié autochtones de l’Ontario (Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres, OFIFC))[3] ont rédigé ensemble le présent guide afin d’informer le public au sujet de la discrimination envers les Autochtones qui sévit dans les commerces de détail.
Ce guide décrit les protections offertes par le Code des droits de la personne de l'Ontario (le « Code »)[4] et explique les différentes formes que prennent la discrimination et le harcèlement anti-Autochtones dans les commerces de détail . Le guide s'adresse aux Autochtones eux-mêmes afin de les aider à exercer leur droit à un traitement égal sans discrimination, ainsi qu’aux détenteurs d’obligations du secteur (p. ex., propriétaires d'entreprise, employés, fournisseurs tiers, etc.) afin de les aider à comprendre leurs responsabilités et les actions qu’ils peuvent entreprendre pour prévenir la discrimination envers des clients autochtones.
À titre de supplément pratique, deux fiches d’information qui résument le contenu du guide ont également été préparées. L’une est destinée aux titulaires de droits (Fiche d’information : Reconnaître la discrimination et le harcèlement envers les Autochtones dans les commerces de détail) et l’autre, aux détenteurs d’obligations (Fiche d’information : Comment prévenir la discrimination et le harcèlement envers les Autochtones dans les commerces de détail).
*Le terme « autochtone » est utilisé pour désigner collectivement les peuples des Premières Nations, les Inuit et les Métis ainsi que les communautés autochtones vivant en milieu urbain. Le terme « Autochtone » réfère à un individu issu de ces communautés. Cette désignation est conforme à l’approche suivie dans des enquêtes et rapports, dont l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Les Autochtones représentent 2,9 % de la population ontarienne (soit 406 585 personnes)[5], dont la plupart vivent hors des réserves, dans des centres urbains ou à proximité[6]. EPBC, la OFIFC et la CODP soutiennent l’appel à l’action 92 (iii) de la Commission de vérité et réconciliation, qui recommande au secteur des entreprises du Canada de « donner aux cadres supérieurs et aux employés de l'information sur l'histoire des peuples autochtones, y compris en ce qui touche l'histoire et les séquelles des pensionnats, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les traités et les droits des autochtones, le droit autochtone et les relations entre l'État et les Autochtones »[7]. |
Le présent guide ne contient pas de conseils juridiques. Il contient des renseignements généraux sur les sujets, la terminologie et le droit liés à la discrimination et au harcèlement dont font l’objet les Autochtones dans les commerces de détail. Si vous avez besoin de conseils juridiques, veuillez vous adresser à un avocat. Pour un complément d’information sur le sujet, consultez l’annexe I, intitulée « Que pouvez-vous faire si vous pensez avoir été victime de discrimination? ».
2. Définitions
Les concepts ci-dessous sont essentiels à l'établissement d'une bonne compréhension de la discrimination telle qu’interdite par le Code et serviront à la reconnaître dans le milieu du commerce de détail. Sauf indication contraire, les définitions ont été adaptées du Glossaire des termes relatifs aux droits de la personne publié par la CODP[8].
La discrimination signifie le mauvais traitement d’une personne, soit en lui imposant des fardeaux, soit en l’empêchant d’avoir accès aux privilèges, bénéfices ou avantages offerts à d’autres, en raison de sa race, de sa citoyenneté, de son état familial, d’un handicap, de son sexe ou d’autres caractéristiques personnelles. La discrimination peut prendre de nombreuses formes différentes : elle peut être directe, indirecte, exercée de manière subtile ou faire suite à un effet préjudiciable[9]. Il n'est pas nécessaire de prouver l’existence d’une intention discriminatoire pour établir qu'il y a eu discrimination – démontrer que la conduite a un effet discriminatoire est suffisant.
Le stéréotypage réfère à l’attribution des mêmes caractéristiques à tous les membres d’un groupe, en gommant leurs traits individuels. Ce procédé se fonde souvent sur des idées erronées, une information incomplète et/ou de fausses généralisations.
Le racisme est un terme ayant une portée plus vaste que la discrimination raciale. Le racisme est la conviction qu’un groupe racialisé est supérieur à d’autres groupes. Le racisme peut se manifester ouvertement lors de plaisanteries à caractère racial, d’insultes ou de crimes motivés par la haine. Il peut aussi être enraciné plus profondément dans les attitudes, les valeurs ou les idées reçues. Dans certains cas, les personnes ne se rendent même pas compte qu’elles ont ces convictions. Ces idées sont, en fait, des préjugés qui ont évolué au fil du temps et sont devenus partie intégrante des systèmes et des institutions associés au pouvoir et aux privilèges du groupe dominant.
La discrimination raciale est un comportement interdit par le Code, qui inclut toute action, intentionnelle ou non, ayant pour effet de cibler des personnes à cause de leur race et de leur imposer des fardeaux qui ne sont pas imposés à d'autres. Elle inclut aussi le refus ou la restriction d’avantages offerts à d’autres membres de la société, dans des domaines sociaux protégés par le Code. Il suffit que la race ne constitue qu’un facteur dans une situation donnée pour qu'il y ait discrimination raciale.
Le profilage racial inclut toute action fondée sur des stéréotypes liés à la race, la couleur, l’origine ethnique, l’ascendance, la religion ou le lieu d’origine, ou une combinaison de ces facteurs, sans motif réel ou soupçon raisonnable, plutôt que sur un soupçon raisonnable dans le but d’isoler une personne à des fins d’examen ou de traitement particulier. Le profilage racial en soi peut ne pas enfreindre le Code, mais il peut entraîner la discrimination raciale, qui elle constituera uneviolation du Code.
Le profilage racial des consommateurs constitue un traitement différentiel dans les milieux de vente au détail en fonction d'une perception de la race ou de l'origine ethnique du consommateur[10]. Ce type de profilage se produit dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
- Une personne racialisée reçoit un mauvais service dans un commerce de détail ou n'est pas servie du tout, en raison de sa race ou de son origine ethnique perçue;
- Une personne racialisée est profilée comme étant un voleur à l'étalage présumé et fait l'objet d'un traitement discriminatoire.
La discrimination intersectionnelle est un type dediscrimination qui se fonde sur au moins deux motifs protégés par le Code. La discrimination intersectionnelle est issue de la combinaison de diverses formes d’oppression qui, ensemble, produisent des effets uniques, différents de toute forme de discrimination individuelle[11]. Les catégories de discrimination peuvent se chevaucher, et certaines personnes peuvent être depuis toujours victimes d'exclusion fondé à la fois sur la race et le sexe, l'âge et un handicap, ou toute autre combinaison de motifs[12].
Le harcèlement réfère aux remarques ou gestes vexatoires dont on sait ou devrait raisonnablement savoir qu’ils sont importuns[13]. Plusieurs incidents ou un comportement répété sont généralement nécessaires pour constituer du harcèlement[14]. Il peut s’agir de paroles ou de gestes dont on sait ou devrait savoir qu’ils sont offensants, embarrassants, humiliants, dégradants ou déplacés[15].
Un milieu empoisonné est créé par des commentaires ou des actions qui ridiculisent ou insultent une personne ou un groupe protégé par le Code, et lui font sentir que l'environnement est hostile ou peu accueillant. La création d’un milieu empoisonné enfreint le droit de la personne ou du groupe ciblé à l'égalité de traitement en matière de services, de biens et d'installations, de logement et d'emploi. Il n'est pas nécessaire que les actions ou les commentaires visent des individus spécifiques. Par exemple, des blagues insultantes, des insultes ou des caricatures sur les personnes LGBT2SQ+ ou les groupes raciaux ou des photos de pin-up qui dénigrent les femmes sont tous des actes qui contribuent à la création d’un environnement empoisonné pour les membres de ces groupes[16].
3. Code des droits de la personne de l’Ontario
Le Code est une loi provinciale qui confère à tout le monde le droit d'être à l'abri de la discrimination qui se fonde sur un ou plusieurs attributs personnels, appelés motifs protégés, dans cinq secteurs de la société, appelés domaines sociaux.
Le Code protège les personnes contre la discrimination lorsqu'elles obtiennent des services publics et privés, ce qui englobe le droit de ne pas faire l’objet de discrimination ou de harcèlement dans un magasin. Les Autochtones en Ontario sont inclus dans ces protections[17].
Les cinq domaines sociaux sont les suivants :
- L’emploi
- Le logement
- Les biens, services et installations (tels que l’éducation, les soins de santé, les services policiers, le gouvernement, les magasins ou les restaurants)
- L'adhésion à un syndicat ou à une association commerciale ou professionnelle
- Les contrats
Le Code interdit la discrimination et le harcèlement fondés sur 17 motifs protégés :
- L’âge
- L’ascendance
- La citoyenneté
- La couleur
- La croyance
- Un handicap
- L’origine ethnique
- L’état familial
- L’état matrimonial
- L’identité sexuelle
- L’expression de l’identité sexuelle
- Le lieu d’origine
- La race
- L’assistance sociale (en matière de logement seulement)
- Le casier judiciaire (en matière d’emploi seulement)
- Le sexe
- L’orientation sexuelle[18].
Pour établir la discrimination sous le régime du Code, le plaignant doit démontrer ce qui suit :
- Il présente un attribut personnel protégé par le Code (p. ex., race, ascendance, lieu d’origine);
- Il a subi un traitement ou une conséquence néfaste dans un domaine social (p. ex., on lui a refusé un service, un logement ou un emploi);
- Le motif protégé était un facteur dans le traitement ou la conséquence néfaste qu’il a subi (p. ex., il n’a pas reçu le service, le logement ou l’emploi à cause de sa race).
Quand les Autochtones sont victimes de discrimination lorsqu’ils fréquentent un magasin, les motifs protégés pertinents seront probablement la race et d’autres motifs connexes, dont l’ascendance, l’origine ethnique, le lieu d’origine, la couleur et la croyance (ce qui inclut la spiritualité autochtone).
Il y a lieu de préciser que la race peut englober une combinaison d'attributs physiques et culturels, alors que l’ascendance renvoie à un lieu géographique ou aux origines des ancêtres de la personne. Ces motifs, ainsi que la couleur, l'origine ethnique, le lieu d'origine et la croyance, sont tous interdépendants.
L'expérience d'une personne peut être encore plus compliquée lorsqu'elle est confrontée à la discrimination intersectionnelle (telle que définie au section 2). Par exemple, si un jeune autochtone était présumé plus susceptible de voler à l'étalage et que ce jugement menait à une surveillance ciblée, l'âge ainsi que la race et les motifs connexes pourraient entrer en jeu. De plus, les incidents vécus par les femmes autochtones doivent être analysés en fonction du prisme du racisme et du sexisme intersectionnels, auxquels elles sont confrontées en tant qu'Autochtones et en tant que femmes. Si une femme autochtone fait l'objet d'une surveillance accrue, la race ainsi que le sexe, l'expression sexuelle ou l'identité sexuelle peuvent être en jeu.
4. Discrimination dans les commerces de détail
Les Autochtones sont souvent victimes de racisme et de profilage racial dans différents contextes commerciaux comme les grands magasins, les supermarchés, les pharmacies, les dépanneurs et les centres commerciaux. Ces situations peuvent constituer de la discrimination raciale (qui comprend également le harcèlement) et pourraient enfreindre le Code.
Ces expériences négatives peuvent être différentes pour chacun. Certains consommateurs autochtones rapportent qu’ils ont fait l’objet de remarques ou d’attitudes désobligeantes ou qu’ils ont été ignorés, alors que d’autres mentionnent des exemples plus extrêmes de discrimination, comme une surveillance ciblée par le personnel ou les gardiens de sécurité[19]. Ces situations sont courantes, mais il semble qu’elles aient été plus fréquentes pendant la pandémie de COVID-19[20].
Expérience vécue : Refus de service pendant la pandémie de COVID-19[21]. Pendant la pandémie de COVID-19, les réseaux sociaux ont été utilisés pour diffuser des remarques racistes et de la désinformation au sujet des membres autochtones des Nations autonomes de Wabaseemoong. Cela a conduit des commerces et organisations à Kenora, une ville du Nord de l'Ontario, à refuser de servir des Autochtones, alors que la communauté autochtone voisine faisait face à une éclosion de COVID-19. De nombreux membres des Nations autonomes de Wabaseemoong vivent et travaillent à Kenora ou dépendent de cette ville pour obtenir des services médicaux et sociaux. Ce traitement différentiel a eu des répercussions qui ont non seulement porté atteinte à la dignité des Autochtones locaux, mais également créé des obstacles à l’accès aux biens et services. |
Les sections suivantes contiennent des exemples de discrimination raciale subie par des clients autochtones dans le but d’aider les lecteurs autochtones à comprendre quand leurs droits protégés par le Code auraient été enfreints. Ces exemples sont aussi destinés à aider les détenteurs d’obligations à comprendre quand ils sont tenus d’agir.
4.1 Profilage racial
Le profilage racial dans les commerces de détail peut entraîner la discrimination raciale, qui constitue une violation du Code et a des répercussions néfastes sur les Autochtones et les personnes racialisées. Le profilage racial perpétue le sentiment d'infériorité et le sentiment d’être indésirable ou invisible. Les clients racialisés expliquent que lorsqu’ils sont victimes de profilage racial dans un magasin, il leur est communiqué qu’ils ne sont pas aussi désirables ou bienvenus que les clients blancs[22]. Empêcher ou décourager des clients d’atteindre des rayons ou un secteur dans le magasin, par exemple, constitue un comportement discriminatoire[23].
Le profilage racial à l'égard de consommateurs autochtones est principalement lié à deux stéréotypes connexes :
- la perception d’un lien entre l’identité autochtone et la pauvreté;
- l'association des Autochtones avec la criminalité, en particulier la perception que tous les Autochtones sont des voleurs à l'étalage potentiels[24].
Résultat : les fournisseurs de services refusent parfois de servir un consommateur autochtone ou le sert plus lentement parce qu’il croit que le consommateur n’a pas les moyens de payer les marchandises, par exemple. Les fournisseurs de services peuvent aussi exercer une surveillance accrue à l’égard des consommateurs autochtones s’ils ont l’impression que les Autochtones sont plus susceptibles de se livrer à des activités criminelles.
Les magasins peuvent être tenus responsables en vertu du Code de leurs actes de profilage racial s'ils surveillent ou fouillent des clients autochtones d'une manière qu'ils ne feraient pas avec d'autres consommateurs, en raison en partie de leur identité autochtone perçue[25]. Des intuitions (qu’elles reposent sur l’expérience ou autre) ou la nervosité perçue ne suffisent pas à établir des soupçons raisonnables à l'égard d'un client. Le comportement d’un client doit être observé objectivement, sans influence de stéréotypes. Le fait de prendre en compte l’identité autochtone perçue d’un client d’un magasin pour évaluer la sécurité du magasin peut constituer du profilage racial et servir de base à une plainte pour violation des droits de la personne.
Expérience vécue : Profilage racial[26] Un Autochtone fréquentait un magasin à Thunder Bay lorsqu’il a été accusé d'avoir volé le chemise qu'il portait dans le magasin. Pendant qu'il faisait la queue pour acheter un article, il a reçu un appel de sa mère. Comme elle lui a demandé de venir l’aider, il a décidé de remettre l’article sur l’étagère et de quitter le magasin. Alors qu’il se préparait à quitter le magasin, un employé l’a abordé en laissant entendre qu’il l’accusait d’avoir volé le chemise qu’il portait. Le client autochtone a décrit l’interaction en ces mots : « Un homme qui se trouvait dans le magasin s’est approché de moi et m’a lancé : “ La chemise, mon gars! ”. J’ai regardé ma chemise et j’ai répondu “ oui? ”. Il m’a alors dit : “ C’est la nôtre. ”. J’ai répondu : “ non, ce n’est pas vrai. ” Il a continué : “ Tu es sûr? ”, ce à quoi j’ai répondu : “ 100 pour cent ”. Il m’a regardé pendant quelques instants puis a laissé tomber en disant : “ ok. ” Et il a fait demi-tour. » La chemise qu'il portait n'était pas vendue dans le magasin en question, ni sur son site Web. Après que le client autochtone ait parlé de son expérience en ligne, la société mère du magasin a nié tout acte répréhensible, invoquant plutôt un malentendu. La société a proposé au client de participer à une réunion en ligne avec le gérant du magasin pour que ce dernier lui présente ses excuses, mais la réunion a été annulée plus tard par la société lorsque le client autochtone a insisté pour se faire accompagner par un activiste à titre de personne de soutien pendant la réunion. |
4.2 Surveillance
La surveillance ciblée des Autochtones est une des formes de discrimination qui existent dans les commerces de détail. Les employés ou le personnel de sécurité peuvent cibler les clients autochtones de manières inapproprié par les actions qui suivent :
- Observer ou suivre les clients autochtones sans motifs raisonnables (p. ex., en considérant sans raison un client autochtone comme étant « suspect »)[27];
- Arrêter, interroger ou fouiller les clients autochtones sans autorité légale suffisante[28];
- Surveiller les clients autochtones lorsqu'ils utilisent les cabines d’essayage ou les caisses libre-service, ou vérifier leurs reçus à la sortie du magasin en raison de soupçons infondés de vol à l'étalage;
- Retirer physiquement les clients autochtones d'un magasin ou d'un centre commercial, leur demander de partir ou refuser de les servir en raison de soupçons infondés de vol à l'étalage ou en raison de stéréotypes ou d'attitudes négatives à l'égard des Autochtones[29];
- Inspecter excessivement les étiquettes des marchandises amenées à la caisse pour vérifier si le client autochtone n’a pas échangé les étiquettes pour payer moins cher[30].
Il arrive aussi que les détaillants prennent des mesures de surveillance discriminatoires qui vont au-delà de la surveillance physique, par exemple :
- Accuser des clients autochtones de voler ou de ne pas scanner tous leurs articles à la caisse libre-service[31].
- Demander au personnel d'être à l'affût des acheteurs autochtones parce qu'ils sont présumés voleurs.
- Interroger les clients autochtones sur le prix de leurs achats ou les retours possibles (p. ex., « Pouvez-vous vous permettre cet article? »).
- Refuser de reprendre un article en invoquant une fausse accusation (p. ex., accuser faussement l’acheteur autochtone d’avoir endommagé l’article ou d’avoir modifié l’étiquette de prix d’une certaine façon) ou ridiculiser le client lorsqu’il tente d’effectuer un retour[32].
- Demander aux clients autochtones de laisser leurs sacs ou leurs chariots de marchandises pas encore payées à l’entrée pendant qu’ils font le tour du magasin sur la base d’un soupçon infondé qu’ils vont voler quelque chose à l’étalage[33].
4.3 Autres formes de discrimination dans les commerces de détail
Les Autochtones subissent souvent d'autres formes de discrimination dans les commerces de détail. Par exemple, un membre du personnel ou le propriétaire du magasin peut :
- s’adresser à un client autochtone ou lui poser une question sur un ton hostile, agressif, condescendant ou soupçonneux;
- faire des remarques racistes ou proférer des insultes raciales à l'égard des clients autochtones;
- ignorer les clients autochtones, leur refuser un service ou leur fournir un service très lentement;
- accuser les clients autochtones d'être en état d'ébriété[34];
- devenir physiquement violent envers un client autochtone[35].
4.4 Inventaire discriminatoire
L’un des objets du Code est de « créer un climat de compréhension et de respect mutuel de la dignité et de la valeur de toute personne de façon que chacun se sente partie intégrante de la collectivité »[36]. Cela signifie que les fournisseurs de services, y compris les commerces de détail, ont le devoir d'offrir aux clients un environnement exempt de discrimination, d'être conscients de l'existence de milieux empoisonnés et de prendre des mesures pour aborder ou éliminer un milieu empoisonné.
Des images et des mots, comme ceux sur les panneaux, peuvent créer des milieux empoisonnés. Par exemple, certaines entreprises vendent des marchandises qui contiennent des termes désobligeants liés aux peuples autochtones[37], des images offensantes, y compris des noms et logos d'équipes sportives,[38] ou des costumes d’Halloween à référence autochtone (qui sont souvent fondés sur des stéréotypes inexacts et préjudiciables des Autochtones et hypersexualisés).
Par ailleurs, l’affichage discriminatoire de noms, de mots et d’images est interdite en vertu du Code si ces noms, mots ou images indiquent l’intention ou encourage de porter atteinte aux droits d’autrui[39].
Entreposer des marchandises à référence autochtone est une pratique susceptible d’éroder la dignité des Autochtones et d’enfreindre le Code. Les entreprises ont l’obligation de veiller à ne pas créer un milieu empoisonné pour leurs clients autochtones (et pour leurs autres clients protégés par le Code) en évitant de vendre des marchandises inappropriées.
4.5 Discrimination liée aux cartes de statut d’Indien
Le statut d’Indien (le statut) est la qualité juridique d’une personne qui est inscrite au régime de la Loi sur les Indiens[40]. Une carte de statut est une carte d’identité délivrée par le gouvernement qui identifie son titulaire comme une personne inscrite au régime de la Loi sur les Indiens. Les Inuit et les Métis ne peuvent pas obtenir une carte de statut. Par ailleurs, de nombreux membres de Premières Nations qui ne satisfont pas aux critères d’identité énoncés dans la Loi sur les Indiens par le gouvernement du Canada n’y ont pas non plus droit.
Les cartes de statut confèrent des avantages et des droits précis, et ouvrent des programmes et services spécifiques aux membres de Premières Nations inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens[41], y compris, mais sans s'y limiter, une remise de la taxe de vente harmonisée (TVH) correspondant à la partie provinciale (8 %) de la taxe sur les produits admissibles. Les exemptions fiscales découlent généralement d’ententes fondées sur les traités ou tout autre accord semblable conclus entre la Couronne et les Premières Nations, selon lesquels la Couronne a offert certains services, avantages ou droits en échange de terres. Les membres de Premières Nations peuvent aussi utiliser leur carte de statut comme pièce d’identité avec photo.
Il est important de noter que le statut d’Indien d'une personne n'expire pas. Une carte de statut est suffisante pour donner à une personne inscrite admissible accès aux avantages, droits, programmes et services auxquels elle a droit (dont la remise de la TVH accordée sur les produits admissibles), que sa carte comporte ou non une date d’expiration.
La remise de la TVH correspondant à la partie provinciale de 8 % de la taxe s’applique aux biens et services admissibles achetés hors réserve. La remise peut être demandée au moment de l'achat (appelé « point de vente ») ou au moyen d'une demande envoyée par la poste[42] au ministère des Finances de l’Ontario après la vente, ou après l’achat de marchandises admissibles en ligne où la remise ne peut pas être octroyée au point de vente. Les biens ou services admissibles doivent être achetés par la personne titulaire de la carte de statut pour son usage personnel et pas celui d’une autre personne, à moins qu’il ne s’agisse d’un cadeau.
Même si les vendeurs peuvent accorder la remise de la taxe correspondant à la partie provinciale (8 %) à un acheteur titulaire d’une carte de statut au point de vente pour des marchandises admissibles (pour autant que certaines procédures prévues par le Règl. de l’Ont. 317/10 pris en vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail[43], comme les exigences de tenue des dossiers, soient suivies)[44], ils n’ont pas l’obligation légale d’accorder la remise au point de vente conformément au paragraphe 8 (1) du Règl. de l’Ont. 317/10[45]. Le fait de ne pas offrir aux clients des Premières Nations l’option d’obtenir la remise de la TVH correspondant à la partie provinciale au point de vente ne constitue probablement pas en soi une discrimination en vertu du Code. |
Le racisme, la discrimination, les stéréotypes et le harcèlement liés à l'utilisation des cartes de statut sont répandus et découlent de l’ignorance du public[46]. Beaucoup de gens, y compris les propriétaires d'entreprise et les employés de l'industrie du commerce de détail, ne connaissent pas :
- l'histoire des cartes de statut d'Indien;
- les procédures à suivre pour octroyer une remise de taxe au point de vente;
- les renseignements à recueillir pour octroyer une remise de taxe;
- le fait que les cartes de statut constituent une forme valide de pièce d’identité.
Par conséquent, les membres des Premières Nations peuvent être victimes de discrimination en vertu du Code lorsqu'ils tentent d'utiliser une carte de statut pour obtenir une remise au point de vente ou lorsqu’ils utilisent leur carte comme pièce d’identité. Dans certains cas, les non Autochtones perpétuent également des comportements et des remarques racistes envers les membres des Premières Nations[47] lorsque ces derniers présentent ou mentionnent leur carte de statut.
4.5.1 Remises de taxe
Comme mentionné ci-dessus, si un détaillant refuse d'offrir la remise de taxe au point de vente, il ne s'agit probablement pas d'une discrimination en vertu du Code, car il n'y a pas d'obligation légale pour les vendeurs de l’offrir. Toutefois, une discrimination pour un motif protégé par le Code peut tout de même se produire lorsqu’une personne titulaire d’une carte de statut essaie de bénéficier de la remise au point de vente, que la remise soit octroyée ou non.
Un membre des Premières Nations peut être victime de discrimination après avoir présenté sa carte de statut si les propriétaires ou un employé du magasin adopte l’un ou l’autre des comportements suivants :
- Faire des remarques liées à la race (p. ex., dire qu’un client a l’air autochtone ou non, demander à une personne titulaire d’une carte de statut quelle est sa proportion de sang autochtone).
- Faire des commentaires négatifs sur le statut d’Indien (p. ex., dire que les titulaires d’une carte de statut bénéficient d’avantages injustes ou que les Autochtones reçoivent des choses gratuitement).
- Se comporter comme si octroyer la remise de taxe est un problème alors que les politiques de l’entreprise autorisent son octroi au point de vente.
- Agir grossièrement envers un client membre des Premières Nations après une demande de remise de taxe ou la mention de son statut d’Indien (p. ex., lui rendre sa carte de statut en la jetant sur le comptoir).
- Manifester une attitude négative envers le statut d’Indien ou le client par son langage corporel (p. ex., lever les yeux au ciel, se moquer ou prendre une expression exaspérée).[48]
Les personnes titulaires d’une carte de statut font souvent l’objet de comportements et commentaires de ce genre lorsqu’ils demandent si la remise de taxe est offerte au point de vente, que la remise soit ou non offerte. Dans ce genre de situations, ce qui constitue une violation du Code est souvent la conduite ou les commentaires portant atteinte à un motif protégé par le Code (p. ex., la race ou un motif connexe), plutôt que le fait de ne pas octroyer la remise de taxe.
Expérience vécue : Discrimination après présentation de la carte de statut
La femme autochtone qui a subi cette discrimination a écrit : « Je me suis éloignée, bouleversée, tremblante, au bord des larmes…C’est peut-être sympa d’être “exonéré de taxe ”, mais ce ne l’est pas quand je suis mal à l’aise et dénigrée par certains caissiers ou magasins qui me font des histoires pour quelque chose qui est un droit… Cela me rappelle que certains commerces ne “nous” aiment pas à cause de la démarche qu’ils doivent suivre. Cela me rappelle que quelques clics de plus, quelques minutes de plus vont me rendre exaspérante. Cela me rappelle que je ne serai jamais traitée de la même manière, même si je ne suis qu'une cliente. »[49]
« Parfois ce n’est que lever les yeux au ciel et d’autres fois un haussement d’épaules. Il arrive aussi qu’après avoir vu la photo sur la carte, la personne me regarde et me dit : “Vous êtes Autochtone? Pur-sang?” ou“Vous n’avez pas l’air Autochtone à 100 %, je me trompe? ” Des fois, pour éviter ces échanges, je ne sors pas ma carte et je paie le prix entier … Si je montre ma carte ce n’est pas tant pour économiser de l’argent que par principe, pour exercer un droit qui me revient. »[50] |
Les comportements suivants peuvent également enfreindre le Code :
- Une entreprise offre la remise de taxe, mais un caissier ou un autre employé refuse de l'accorder, sans raison, à une personne titulaire d’une carte de statut.
- Un propriétaire d'entreprise déclare qu'il n'offre pas la remise de taxe parce qu’il a des opinions négatives sur les Autochtones et/ou leurs droits.
Dans ces cas, les mesures ou les commentaires de la personne constituerait de la discrimination envers le client autochtone, plutôt que le fait que la remise de taxe n’est pas offerte.
Expérience vécue : Refus d’octroyer la remise de taxe
D'autres clients présents dans le magasin ont tenté de défendre la famille, ce qui a aggravé la situation. L’un des caissiers a fini par mettre la main dans la caisse et jeter un billet de cinq dollars à la famille avant d’appeler la sécurité. En se remémorant l'événement, la mère a confié : « Parce que nous sommes des personnes de couleur, les gens se croient permis de nous chasser de n’importe où en appelant la sécurité à notre égard. »[51]
« Il a immédiatement arraché l’article [que la cliente voulait acheter] de ma main en m’ordonnant de quitter le magasin et répétant que je n’y étais pas la bienvenue. J’ai répondu : “ Vous ne pouvez pas me chasser de votre magasin. Je n’ai rien fait de mal. Tout ce que j’essaye de faire est d’exercer mon droit. ” En entendant ces mots, il est sorti de derrière le comptoir, a ouvert la porte du magasin et m’a intimé de sortir. Je l’ai alors averti que je n’allais pas en rester là, parce que je n’aimais pas la façon dont j’avais été traitée dans son magasin et que je n’avais encore jamais été chassée d’un magasin. Il m’a juste répété de sortir. »[52] Le propriétaire du magasin s'est ensuite excusé et a modifié la politique du magasin pour offrir la remise de taxe au point de vente. La femme autochtone a ensuite accepté de renoncer à son intention de déposer une plainte en matière de droits de la personne[53]. |
4.5.2 Autres clients
Lorsque d'autres clients réagissent négativement à la mention du statut d'Indien ou lorsqu'ils harcèlent des clients autochtones, cela peut également constituer de la discrimination ou du harcèlement en vertu du Code.
Par exemple : Lorsqu’une personne titulaire d’une carte de statut présente sa carte à la caisse pour recevoir leur remise de taxe, d'autres clients peuvent faire des commentaires irrespectueux ou manifester une attitude négative par leur langage corporel (lever les yeux au ciel, secouer la tête en signe de désapprobation) envers le client autochtone. Les clients non autochtones peuvent se montrer agacés de devoir attendre plus longtemps dans la queue pendant que la caissière recueille les renseignements requis auprès du client, parce qu’ils pensent que les Autochtones bénéficient d’avantages injustes. Ce genre de comportements ou de commentaires peuvent créer un milieu empoisonné.
Comme déjà mentionné au section 4.4., les entreprises doivent veiller à ne pas créer de milieu empoisonné pour les clients autochtones (et les autres personnes protégées par le Code). Par conséquent, en cas de besoin, les détaillants doivent remédier à tout acte de discrimination et de harcèlement que commet un client non autochtone envers un client autochtone[54].
4.5.3 Identification
De nombreux membres des Premières Nations utilisent la carte de statut comme principale pièce d'identité avec photo. Par exemple, les cartes de statut peuvent être utilisées comme pièce d'identité pour demander une licence de mariage, immatriculer un véhicule ou fournir une preuve de nom ou d'âge (notamment pour confirmer une réservation d’hôtel ou acheter des biens vendus seulement à des personnes d’un certain âge).
Il existe deux types de cartes de statut [55] et les deux sont des pièces d’identité avec photo valides :
- le certificat sécurisé de statut d’Indien : une carte plus récente, introduite en 2009;
- le certificat de statut d’Indien : une carte de statut laminée, délivrée avant 2009, qu’un grand nombre de membres des Premières Nations utilisent encore.
De nombreuses entreprises et employés ne savent pas que les cartes de statut sont des pièces d'identité avec photo valides et refusent de les accepter. Cela pourrait constituer de la discrimination en vertu du Code si le refus (ou même l'acceptation) de la carte de statut comme pièce d'identité s'accompagne de commentaires ou de comportements racistes, ou si des attitudes négatives à l'égard du statut se manifestent par le langage corporel.
Des renseignements à jour sur les différentes versions des cartes de statut et leur historique sont consultables sur le site Web de Services aux Autochtones Canada[56]. Les personnes qui souhaitent utiliser leur carte de statut pour obtenir un permis ou une licence réglementée par le gouvernement devraient se renseigner sur les exigences applicables en consultant les sites Web pertinents du gouvernement. Pour certains permis du gouvernement, des documents supplémentaires pourraient être exigés pour prouver l’identité[57]. Les deux types de cartes de statut suffisent pour prouver l’admissibilité à la remise de la TVH.
Il est également important de noter que d'autres formes valides de pièce d’identité peuvent parfois être utilisées par des Autochtones pour obtenir des services. Par exemple, une personne membre d’une Première Nation ou inuite peut présenter son numéro du Programme des SSNA pour payer des médicaments sur ordonnance à la pharmacie. Les mêmes obligations décrites ci-dessus de fournir des services de manière non discriminatoire s'appliqueraient dans ces cas[58].
5. Conseils pour créer des commerces de détail accueillants pour les Autochtones et prévenir la discrimination
Les commerces de détail doivent veiller au maintien d’espaces sécuritaires pour les acheteurs et le personnel autochtones. Un espace sécuritaire est un lieu où une personne sait qu’elle ne subira ni discrimination, ni harcèlement, ni critiques. En créant des espaces sécuritaires au sein de leurs locaux, les détaillants établissent un lien de confiance avec leurs clients autochtones[59].
5.1 Considérations d’ordre administratif
Pour favoriser la création d’un environnement inclusif, il faut établir des liens de confiance entre le personnel et les clients. En vertu du Code, les fournisseurs de services, dont les commerces de détail, doivent répondre aux allégations de discrimination, mener une enquête à leur égard et les résoudre.
Les entreprises peuvent prendre les mesures suivantes pour établir un environnement inclusif :
- Élaborer des procédures transparentes de dépôt des plaintes pour le personnel et les clients, conformément à leurs obligations énoncées dans le Code.
- Créer un forum permettant aux employés de discuter de diverses questions (liées aux politiques et procédures) et de signaler des incidents.
- Examiner les politiques et procédures internes pour s'assurer qu'elles ne produisent pas d'effets négatifs involontaires sur les clients autochtones, car ces effets pourraient constituer de la discrimination en vertu du Code[60].
5.2 Recrutement et formation du personnel
Les entreprises peuvent transformer l'expérience des clients autochtones en mettant l'accent sur la qualité du service offert par leur personnel et en prenant les mesures suivantes :
- S'assurer que les employés sont pleinement conscients de leurs devoirs et responsabilités en matière de respect du Code et de ses principes dans le lieu de travail.
- Offrir aux employés une formation sur la diversité, l'égalité réelle, la lutte contre la discrimination, les techniques de désamorçage et la sécurité culturelle pour les Autochtones.
- Veiller à ce que des procédures existent pour intervenir dans des situations où des clients non autochtones harcèlent des clients autochtones et à ce que le personnel reçoive des instructions sur ces procédures.
- Engager du personnel autochtone tout en assurant un environnement de travail accueillant et exempt de discrimination.
- Promouvoir la réconciliation ainsi que les programmes favorisant la diversité et l'inclusion (p. ex., dans le cadre d’événements internes marquant la Journée nationale des peuples autochtones, le Mois de l'histoire autochtone et la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, ou en distribuant au personnel des ressources à lire dans le lieu de travail).
- Exiger du personnel qu'il lise les politiques et les ressources de la CODP[61]
- ainsi que d'autres modules de formation sur la lutte contre le racisme, et des rapports sur le racisme envers les Autochtones et la compétence/sensibilité culturelle, en particulier des documents préparés par des organismes autochtones.
- Offrir des directives en réponse à l’appel à l’action no 92 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.
- Demander au personnel de ne pas se livrer à une surveillance ciblant en particulier les clients autochtones (p. ex., dire au personnel de ne pas suivre les clients autochtones, examiner leurs reçus de caisse ou vérifier les étiquettes des marchandises qu’ils ont achetées pour s’assurer qu’elles n’ont pas été falsifiées, sans soupçons raisonnables).[62]
- Intégrer des indicateurs liés à la lutte contre la discrimination dans les évaluations du rendement.
5.3 Cartes de statut d’Indien
Les entreprises peuvent adopter des pratiques judicieuses pour se renseigner et renseigner leur personnel sur les cartes de statut. Par exemple :
- Octroyer la remise de taxe au point de vente.
- Placer des affiches à un endroit bien en vue des clients qui déclarent clairement que l’établissement accepte les cartes de statut comme pièces d'identité et invite les clients titulaires d’une carte de statut à se renseigner sur la remise de la TVH.
- Former le personnel au sujet du statut d'Indien et de la possibilité d’octroyer une remise de taxe au point de vente, dans le lieu de travail, en insistant sur le fait que le statut d’Indien n’expire pas.
- Former le personnel à se comporter avec respect et sensibilité envers les clients autochtones qui invoquent leur statut.
- Expliquer au personnel comment s’adresser respectueusement aux personnes qui demandent une remise de taxe au point de vente.
- Expliquer au personnel comment désamorcer la situation lorsque d'autres clients manquent de respect aux Autochtones qui invoquent leur statut.
- Former le personnel sur la procédure à suivre pour octroyer la remise de taxe au point de vente, ce qui inclut de s’abstenir de demander des renseignements que n’exige pas le ministère des Finances de l’Ontario.[63]
- Apprendre au personnel d’orienter les clients membres des Premières Nations vers le site Web du ministère des Finances de l’Ontario (qui explique l’option de demander la remise de taxe par la poste) si l’établissement n’offre pas la remise au point de vente.[64]
- De nombreux membres des Premières Nations ne savent pas qu'ils ont une autre option si un vendeur ne peut pas leur octroyer la remise de la TVH au point de vente.
- Élaborer une politique qui enjoint au personnel d’accepter les cartes de statut comme pièce d’identité et fournir des directives au personnel à ce sujet.
5.4 Fournisseurs de services tiers
Les fournisseurs de services tiers peuvent également faire preuve de discrimination à l'égard des Autochtones. Lorsqu'elles embauchent des tiers, comme des acheteurs personnels ou des agents de sécurité, les entreprises devraient :
- Intégrer aux contrats des dispositions en langage simple sur les compétences requises pour combattre le racisme envers les Autochtones.
- Choisir de travailler avec des fournisseurs de services qui recrutent des candidats autochtones et qui suivent des normes élevées en matière de formation sur les compétences culturelles autochtones, y compris sur les préjugés inconscients.
- Exiger des fournisseurs tiers qu'ils traitent les clients autochtones avec respect et qu'ils s'abstiennent de les soumettre à une surveillance excessive, de leur faire des commentaires inappropriés, de leur fournir un service désagréable ou lent, ou de leur refuser un service en raison d'opinions négatives ou de stéréotypes personnels à l'égard des Autochtones.
- Élaborer et mettre en œuvre des politiques et des procédures claires qui prévoient des mesures réparatrices efficaces en cas de discrimination de la part d'un fournisseur tiers.
5.5 Inventaire
Les fournisseurs de services, comme les commerces de détail, ne devraient pas stocker des marchandises à caractère autochtone qui risquent de heurter la dignité des Autochtones et de créer un milieu empoisonné qui découragerait ou empêcherait les Autochtones d’obtenir un service équitable.
Les entreprises peuvent éviter des situations de ce genre en prenant les mesures suivantes :
- Éviter de vendre de la marchandise contenant des termes désobligeants liés à l’identité autochtone, des images offensantes, comme des noms et des logos d'équipes sportives, et des costumes d'Halloween sur un thème autochtone.
- Veiller à ce que les politiques relatives aux stocks et/ou aux types de marchandises vendues reconnaissent la responsabilité des fournisseurs de services, prévue par le Code, de maintenir un environnement exempt de discrimination.
- Se renseigner sur les facteurs historiques et culturels qui sous-tendent des actes ou propos désobligeants ou offensants afin de mieux comprendre leurs effets néfastes sur les peuples autochtones.[65]
5.6 Appropriation culturelle
Au-delà de leurs obligations légales et dans le souci de promouvoir la réconciliation et la création d’espaces sécuritaires et accueillants pour les Autochtones, les commerces de détail devraient garder à l’esprit le risque d’appropriation culturelle[66].
Les entreprises vendent souvent des produits que de nombreux Autochtones estiment avoir été appropriés de leur culture. C’est notamment le cas des remèdes sacrés (p. ex., sauge, foin d’odeur) fabriqués par des entités non autochtones et vendus dans des commerces non autochtones, ou d’œuvres d’art qui imitent l’art autochtone (p. ex., art créé avec des techniques mixtes, des vêtements à thèmes inspirés de l’art autochtone, le perlage), qui ne sont ni créées ni vendues par des artistes autochtones. Bien que le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (TDPO) n'ait pas encore statué pleinement sur la question de l'appropriation culturelle des pratiques et des images culturelles autochtones[67], cette question est importante car l’appropriation culturelle dénote un manque de respect envers l’autorité des Autochtones sur l’expression de leur culture, ce qui risque de perpétuer les stéréotypes[68] susceptibles d’entraîner des remarques dérogatoires, l’exclusion et la discrimination[69].
Des biens autochtones (produits faits par des particuliers ou des entreprises autochtones) peuvent être vendus dans des magasins appartenant à des non Autochtones. Toutefois, les entreprises non autochtones devraient veiller à instaurer des milieux respectueux et accueillants des Autochtones. À cette fin, il est important que les entreprises s’interrogent sur l’effet qu’ont les articles pouvant être considérés comme culturellement appropriés qu’elles entreposent et vendent sur les clients autochtones. Si elles concluent que ces articles donnent l’impression aux clients autochtones qu’ils ne sont ni respectés, ni les bienvenus, les entreprises devraient cesser de les vendre.
Annexe I : Que pouvez-vous faire si vous pensez avoir été victime de discrimination?
1. Protégez-vous
Si vous vous trouvez dans une situation où vous pensez être victime de discrimination, faites ce qu’il faut pour vous mettre en sécurité. Dans certains cas, cela peut impliquer de quitter un endroit et de contacter un organisme autochtone local (p. ex., un centre d’amitié). Une fois en sécurité, consignez les faits de l’incident de la façon qui convient le mieux à vos besoins (p. ex., par écrit, par enregistrement audio).
2. Contactez le Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne (CAJDP)
Le CAJDP aide les gens à comprendre leurs droits et les faire respecter. Il fournit des conseils par téléphone, aide à remplir des requêtes pour atteintes aux droits de la personne et représente des requérants à des séances de médiation et à des audiences devant le TDPO.
Si vous pensez avoir été victime de discrimination, vous pouvez commencer par utiliser l’outil en ligne qu’a créé le CAJDP pour établir si les faits en cause constituent ou non une discrimination en vertu du Code : https://hrlsc.on.ca/fr/pouvons-nous-vous-aider-2/.
Les coordonnées du CAJDP sont :
- Téléphone sans frais : 1 866 625-5179
- ATS sans frais : 1 866 612-8627
- Site Web : www.hrlsc.on.ca
Le CAJDP est dotée d’une équipe spécialisée dans les services aux Autochtones qui peut offrir des services culturellement adaptés, en cri, oji-cri, mohawk et ojibwé, aux personnes qui s’auto-identifient comme étant autochtones. Pour joindre cette équipe, il faut appuyer sur le « 4 » après avoir composé le numéro général du CAJDP indiqué ci-dessus. Par ailleurs, le site Web du CAJDP contient des renseignements sur les services aux Autochtones, dont une brochure, à l’adresse : https://hrlsc.on.ca/fr/les-services-aux-autochtones/.
3. Faites valoir vos droits en vertu du Code
Si vous pensez que vous avez été victime de discrimination, vous pouvez déposer une requête directement au TDPO, à la page Web : https://tribunalsontario.ca/hrto/forms-filing/
Vous pouvez aussi contacter le TDPO pour obtenir davantage de renseignements sur leurs services :
- Téléphone sans frais : 1 866 598-0322
- ATS sans frais : 1 866 607-1240
- Site Web : https://tribunalsontario.ca/tdpo/
- Services aux Autochtones : https://tribunalsontario.ca/fr/soutiens-et-services/services-aux-autochtones/
4. Renseignez-vous
Pour vous renseigner sur vos droits protégés par le Code, vous pouvez :
- Lire les politiques, lignes directrices, brochures et autres ressources de la CODP liées aux peuples autochtones et aux droits de la personne : https://www.ohrc.on.ca/fr/questions_cl%C3%A9s/r%C3%A9conciliation_avec_les_peuples_autochtones
- Lire les guides pratiques du CAJDP : https://hrlsc.on.ca/fr/guides-pratiques/;
- Trouver les réponses à des questions fréquemment posées sur le Code : https://hrlsc.on.ca/fr/foire-aux-questions/
- Regarder une vidéo créée par le CAJDP et l’OFIFC, intitulée « Defending your human rights in Ontario – what you need to know » (en anglais seulement) : https://www.youtube.com/watch?v=S4JD7b7Uce0
- Trouver des renseignements sur le Programme des droits de la personne des peuples autochtones offert par EPBC en partenariat avec l’OFIFC : https://www.etudiantsprobono.ca/personnes-autochtones
Notes de fin
[1] La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) est un organisme autonome du gouvernement créé en 1961 afin de prévenir la discrimination et de promouvoir et faire progresser les droits de la personne en Ontario. La CODP est un pilier du système des droits de la personne de l’Ontario, au même titre que le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) et le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne (CAJDP). Consultez le site Web de la CODP pour de plus amples renseignements : https://www3.ohrc.on.ca/fr/au-sujet-de-la-commission
[2] Étudiant(e)s pro bono du Canada (EPBC) est un programme national d’étudiants en droit dont la mission est de fournir une assistance juridique gratuite à des particuliers et des communautés qui se heurtent à des obstacles à la justice. Pour en savoir plus, consultez le site Web du programme : https://www.etudiantsprobono.ca/a-propos
[3] La Fédération des centres d’amitié autochtones de l’Ontario (Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres, OFIFC) représente les intérêts collectifs de 31 centres d’amitié répartis dans diverses villes de l’Ontario. Les centres d’amitié offrent aux Autochtones vivant en milieu urbain et aux habitants locaux des lieux où se rencontrer, nouer des liens et recevoir des services culturels. Pour en savoir plus, voir le site Web de l’OFIFC : https://ofifc.org/about/ (en anglais seulement)
[4] Code des droits de la personne (Ontario), L.R.O. 1990, ch. H.19 [le Code]; en ligne : https://www.ontario.ca/lois/loi/90h19#BK33.
[5] Statistique Canada, « La population autochtone continue de croître et est beaucoup plus jeune que la population non autochtone, malgré un ralentissement de son rythme de croissance », (2022), The Daily; en ligne : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220921/dq220921a-fra.htm
[6] Statistique Canada, Ontario [Province] (tableau). Profil de la population autochtone, Recensement de la population de 2021, produit nº 98-510-X2021001 au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 21 juin 2023; en ligne : https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-pd/ipp-ppa/details/page.cfm?Lang=F&DGUID=2021A000235&SearchText=Ontario&HP=0&HH=0&GENDER=1&AGE=1&RESIDENCE=3
[7] Commission de vérité et réconciliation du Canada [CVRC], Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir. Sommaire du rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, (2015), à la page 334; en ligne : https://ehprnh2mwo3.exactdn.com/wp-content/uploads/2021/04/1-Honorer_la_verite_reconcilier_pour_lavenir-Sommaire.pdf.
[8] Commission ontarienne des droits de la personne [CODP], L’enseignement des droits de la personne en Ontario : Guide pour les écoles de l’Ontario (2013), à l’annexe 1; en ligne : https://www.ohrc.on.ca/fr/teaching-human-rights-ontario-guide-ontario-schools/annexe-1-glossaire-des-termes-relatifs-aux
[9] CODP, Les droits de la personne au travail – Troisième édition, (2008), para. III.2; en ligne : https://www3.ohrc.on.ca/fr/iii-principles-and-concepts/2-que-faut-il-entendre-par-discrimination
[10] Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse, Working Better to Serve All Nova Scotians, (2013), au para. 10; en ligne : https://humanrights.novascotia.ca/sites/default/files/crp-report.pdf (en anglais seulement)
[12] Madame la juge L’Heureux-Dubé, pour la minorité, dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Mossop [1993] 1 RCS, au para 645.
[13] Code, supra note 4, par. 10 (1).
[14] CODP, Guide concernant vos droits et responsabilités en vertu du Code des droits de la personne, (2013), à la page 12; en ligne : https://www3.ohrc.on.ca/fr/guide-concernant-vos-droits-et-responsabilites-en-vertu-du-code-des-droits-de-la-personne
[15] OHRC, supra note 8, « Harcèlement »
[16] Ibid., Feuilles de travail des élèves – Fiche de données no 4
[17] Les Autochtones sont aussi protégés contre la discrimination dans des domaines relevant de la compétence fédérale par la Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C., 1985, ch. H-6; en ligne : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/h-6/). Les organismes visés par la loi fédérale sont notamment les banques à charte, les compagnies aériennes, les ministères et organismes du gouvernement fédéral, et les gouvernements et conseils de bande des Premières Nations. Décider quelles affaires seront traitées par le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario et lesquelles seront traitées par le Tribunal canadien des droits de la personne est une question complexe, en particulier en ce qui concerne des allégations de discrimination dans des réserves.
[18] Pour plus de renseignements, voir : CODP, Guide concernant vos droits et responsabilités en vertu du Code des droits de la personne, (2013); en ligne : https://www3.ohrc.on.ca/fr/guide-concernant-vos-droits-et-responsabilites-en-vertu-du-code-des-droits-de-la-personne
[19] CODP, Pris à partie : Questions soulevées par les peuples autochtones, page Web. Texte extrait le 21 novembre 2024 du site : https://www.ohrc.on.ca/fr/pris-partie-questions-soulevees-par-les-peuples-autochtones
[20] CODP, « Déclaration de la CODP concernant les allégations de refus de service aux populations autochtones de Kenora », déclaration de la commissaire en chef, 24 février 2014; en ligne : https://www.ohrc.on.ca/fr/centre-des-nouvelles/declaration-de-la-codp-concernant-les-allegations-de-refus-de-service-aux
[21] Logan Turner, « Baseless Facebook posts about Wabaseemoong COVID-19 outbreak a symptom of wider racism, say community members », CBC News, 24 février 2021 : https://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/kenora-racist-social-media-posts-1.5925748 (en anglais seulement)
[23] Ibid.
[24] Ibid. à la page 6
[25] Johnson v. Halifax Regional Police Service, 2003 CanLII 89397 (NS HRC) au para. 57, cité dans Pieters v. Toronto Police Services Board, 2014 HRTO 1729 (CanLII) au para. 93; en ligne : https://www.canlii.org/en/on/onhrt/doc/2014/2014hrto1729/2014hrto1729.html (en anglais seulement).
[26] Jon Thompson, « Ojibway man takes to Tiktok over treatment at Urban Planet in Thunder Bay », APTN News, 14 juillet 2022; en ligne : https://www.aptnnews.ca/national-news/ojibway-man-takes-to-tiktok-over-treatment-at-urban-planet-in-thunder-bay/ (en anglais seulement)
[27] Radek v. Henderson Development (Canada) and Securiguard Services (No. 3) [Radek], 2005 BCHRT 302; en ligne : https://www.canlii.org/en/bc/bchrt/doc/2005/2005bchrt302/2005bchrt302.html?autocompleteStr=2005%20bchrt%20302&autocompletePos=1 (en anglais seulement)
[28] Les gardiens de sécurité ne sont pas des agents des forces de l’ordre. Ils sont des personnes privées qui ne peuvent arrêter des particuliers qu’en vertu de pouvoirs d’arrestation conférés à de simples citoyens. Leurs pouvoirs découlent de l’art. 494 du Code criminel (Code criminel, L.R.C., 1985, ch. C-46; en ligne : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/ ) et de lois comme la Loi sur l’entrée sans autorisation (Loi sur l’entrée sans autorisation, L.R.O. 1990, ch. T.21; en ligne : https://www.ontario.ca/lois/loi/90t21). Pour de plus amples renseignements, voir : Gouvernement du Canada, ministère de la Justice, Ce qu'il faut savoir au sujet de l'arrestation par de simples citoyens, page Web, texte extrait le 17 décembre 2024 de la page : https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/wyntk.html; et Justice for Children and Youth, Sujets brûlants – Agents de sécurité, page Web, texte extrait le 17 décembre 2024 du site : https://jfcy.org/fr/vos-droits-legaux/sujets-brulants-agents-de-securite/ .
[29] Radek, supra note 27
[30] CODP, supra note 19
[31] Samantha Beattie, « Indigenous man a longtime Giant Tiger customer – until he says he was falsely accused of stealing », CBC News, 21 février 2022; en ligne : https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/indigenous-customer-giant-tiger-falsely-accused-1.6356810 (en anglais seulement)
[32] Smallboy v. Grafton Apparel, 2021 BCHRT 15; en ligne : https://www.canlii.org/en/bc/bchrt/doc/2021/2021bchrt15/2021bchrt15.html (en anglais seulement)
[33] CODP, supra note 19
[34] Radek, supra note 27, aux paras 262 et 485-487 : la requérante était une femme autochtone handicapée et le Tribunal a déclaré qu’il était possible que « le gardien ait cru que son handicap était des signes d’intoxication » et que cela constituait un facteur dans la discrimination subie par Mme Radek.
[35] Pamela Cowan, “Man claims he was accused of stealing because he is Indigenous; police investigating altercation at Canadian Tire,” Regina Leader-Post, 27 juillet 2017; en ligne : https://leaderpost.com/news/local-news/man-claims-he-was-accused-of-stealing-because-he-is-indigenous-police-investigating-altercation-at-canadian-tire (en anglais seulement)
[36] Code, supra note 4, dans le préambule
[37] “This is our N-word’: Indigenous teacher asks Urban Planet to drop racial slur,” CBC News, 7 octobre 2019; en ligne : https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/offensive-term-remove-urban-planet-1.5305540 (en anglais seulement)
[38] CODP, « Règlement de la CODP visant à contrer les conséquences néfastes des stéréotypes sur les jeunes autochtones », communiqué, 13 décembre 2018; en ligne : https://www.ohrc.on.ca/fr/centre-des-nouvelles/reglement-de-la-codp-visant-contrer-les-consequences-nefastes-des-stereotypes; et CODP, « Lettre aux municipalités sur les conséquences néfastes des logos d'équipe sportive à référence autochtone », lettre de la commissaire en chef, 13 mai 2019; en ligne : https://www.ohrc.on.ca/fr/centre-des-nouvelles/lettre-aux-municipalites-sur-les-consequences-nefastes-des-logos-dequipe; et CODP, « Deuxième lettre aux municipalités sur les conséquences néfastes des logos d'équipe sportive à référence autochtone », lettre de la commissaire en chef, 13 juillet 2021; en ligne : https://www.ohrc.on.ca/fr/centre-des-nouvelles/deuxieme-lettre-aux-municipalites-sur-les-consequences-nefastes-des-logos.
[39] Code, supra note 4, au par. 13 (1)
[40] Gouvernement du Canada, Services aux Autochtones Canada, Au sujet du statut d’Indien, page Web. Texte extrait le 21 novembre 2024 de la page : https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100032463/1572459644986
[41] Ibid.
[42] Gouvernement de l’Ontario, ministère des Finances, TVH : Remises à l’intention des Premières Nations de l’Ontario, page Web. Texte extrait le 11 novembre 2024 de la page : hhttps://www.ontario.ca/fr/document/taxe-de-vente-harmonisee-tvh/tvh-remises-lintention-des-premieres-nations-de-lontario#section-5
[43] Loi sur la taxe de vente au détail, L.R.O. 1990, chap. R. 31, Règl. de l’Ont. 317/10; en ligne : https://www.ontario.ca/lois/reglement/100317
[44] Ibid. à l’article 9
[45] Ibid. à l’article 8
[46] Union of BC Indian Chiefs, They Sigh or Give You the Look: Discrimination and Status Card Usage, (2022), aux pages 21 et 73-75; en ligne : https://drive.google.com/file/d/1jPTLpjcFLj-ld6gFW-HiYmWmyVXZRYXq/view (en anglais seulement)
[47] Ibid. à la page 75
[48] Ibid. à la page 50
[49] Naomi Sayers, “Tax Exemption,” Kwetoday, 9 janvier 2011; en ligne : https://kwetoday.com/2011/01/09/tax-exemption/ (en anglais seulement)
[50] Christopher Curtis, “Mohawks are getting tired of explaining to cashiers why they don't have to pay QST,” Montreal Gazette, 9 septembre 2015; en ligne : https://montrealgazette.com/news/mohawks-are-getting-tired-of-explaining-to-cashiers-why-they-dont-have-to-pay-qst(en anglais seulement)
[51] Kate Rutherford, “Whitefish River First Nation family wants apology after security called to remove them from Sudbury store,” CBC News, 5 janvier 2024; en ligne : https://www.cbc.ca/news/canada/sudbury/whitefish-river-first-nation-family-wants-apology-after-security-called-to-remove-them-from-sudbury-store-1.7074843 (en anglais seulement)
[52] “Morris Home Hardware facing human rights complaint,” CBC News, 12 septembre 2014; en ligne : https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/morris-home-hardware-facing-human-rights-complaint-1.2765005 (en anglais seulement)
[53] “Morris Home Hardware owner sorry for not honouring tax exemption,” CBC News, 29 septembre 2014; en ligne : https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/morris-home-hardware-owner-sorry-for-not-honouring-tax-exemption-1.2781745 (en anglais seulement)
[54] Josephs v. Toronto (City), 2016 HRTO 885; en ligne : https://www.canlii.org/en/on/onhrt/doc/2016/2016hrto885/2016hrto885.html (en anglais seulement)
[55] Si un particulier perd sa carte de statut, ou si elle est volée ou détruite, Services aux Autochtones Canada peut délivrer un document de confirmation temporaire de l’inscription qui est valide pendant un an. Ce document confirme l’inscription de la personne en vertu de la Loi sur les Indiens et son admissibilité à certains droits, avantages et services, mais il se peut que le fournisseur de services exige la présentation d’une pièce d’identité avec photo, valide et acceptable, pour confirmer la validité du document de confirmation temporaire. Pour plus de renseignements, voir Gouvernement de l’Ontario, supra note 42.
[56] Gouvernement du Canada, Services aux Autochtones Canada, page Web Votre carte de statut est-elle valide? Texte extrait le 21 novembre 2024 du site Web : https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100032424/1572461852643
[57] Gouvernement de l’Ontario, ServiceOntario, page Web Documents d’identité acceptables. Texte extrait le 21 novembre 2024 du site Web : https://www.ontario.ca/fr/page/documents-didentite-acceptables
[58] Harry v. Trail Apothecary Ltd., 2004 BCHRT 238; en ligne : https://canlii.ca/t/h09pt. Le tribunal des droits de la personnes de la Colombie-Brittanique (BC Human Rights Tribunal) a conclu que le fait qu’un pharmacien refuse de facturer directement le Programme des SSNA pour des supports de poignet parce que la politique de la pharmacie était de ne pas facturer du matériel médical d’une valeur inférieure à 300 $ constituait de la discrimination. La pharmacie n'a pas pu démontrer qu’en accommodant la personne, elle causerait un préjudice injustifié pour la pharmacie, en partie parce qu'elle avait déjà l'habitude de facturer directement des médicaments au Programme des SSNA.
[59] Même si le Code protège les gens contre la discrimination, il n'exige pas la création d’« espaces sécuritaires » ou de « locaux accueillants » d’une façon générale. Néanmoins, les pratiques judicieuses énumérées dans cette section contribuent à créer un espace inclusif et rassurant pour les Autochtones qui est plus en phase avec les principes de réconciliation et, dans certains cas, mieux apte à prévenir la discrimination en vertu du Code.
[60] OHRC, supra note 8, Feuilles de travail des élèves – Fiche de données no 5
[61] Des modules d’apprentissage en ligne de la CODP, comme « Dénoncez-le : racisme, discrimination raciale et droits de la personne » et « Droits de la personne 101 – 3e édition », sont consultables ici : https://www.ohrc.on.ca/fr/our-work/online-learning. En outre, des publications de la CODP sur le sujet de la race et d’autres motifs connexes, sont consultables ici : https://www.ohrc.on.ca/fr/vos_droits/motifs_du_code/race. Des publications concernant la réconciliation avec les peuples autochtones sont consultables ici : https://www.ohrc.on.ca/fr/questions_cl%C3%A9s/r%C3%A9conciliation_avec_les_peuples_autochtones.
[62] Radek, supra note 27
[63] Gouvernement de l’Ontario, supra note 42
[64] Ibid.
[65] CODP, Approche fondée sur les droits de la personne pour l’élaboration de programmes et de politiques, (2024), Annexes; en ligne : https://www3.ohrc.on.ca/fr/approche-fondee-sur-les-droits-de-la-personne-pour-lelaboration-de-programmes-et-de-politiques-le
[66] « Appropriation culturelle des peuples autochtones au Canada », L’Encyclopédie canadienne, 18 avril 2018 (dernière modification : 20 juillet 2020); en ligne : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/cultural-appropriation-of-indigenous-peoples-in-canada
[67] Lindsay v. Toronto District School Board, 2020 HRTO 496, au para. 23; en ligne : https://www.canlii.org/en/on/onhrt/doc/2020/2020hrto496/2020hrto496.html. Dans ce cas récent d'appropriation culturelle, le TDPO a reconnu les façons dont un tribunal administratif peut prendre note de la marginalisation et défavorisation des Autochtones dans la société canadienne. Cela est nécessaire pour démontrer que l'utilisation de symboles et d'images autochtones constitue une discrimination réelle.
[68] « Why Cultural Appropriation is Disrespectful », Indigenous Corporate Training Inc., 4 octobre 2020; en ligne : https://www.ictinc.ca/blog/why-cultural-appropriation-is-disrespectful (en anglais seulement)
[69] CODP, supra note 61