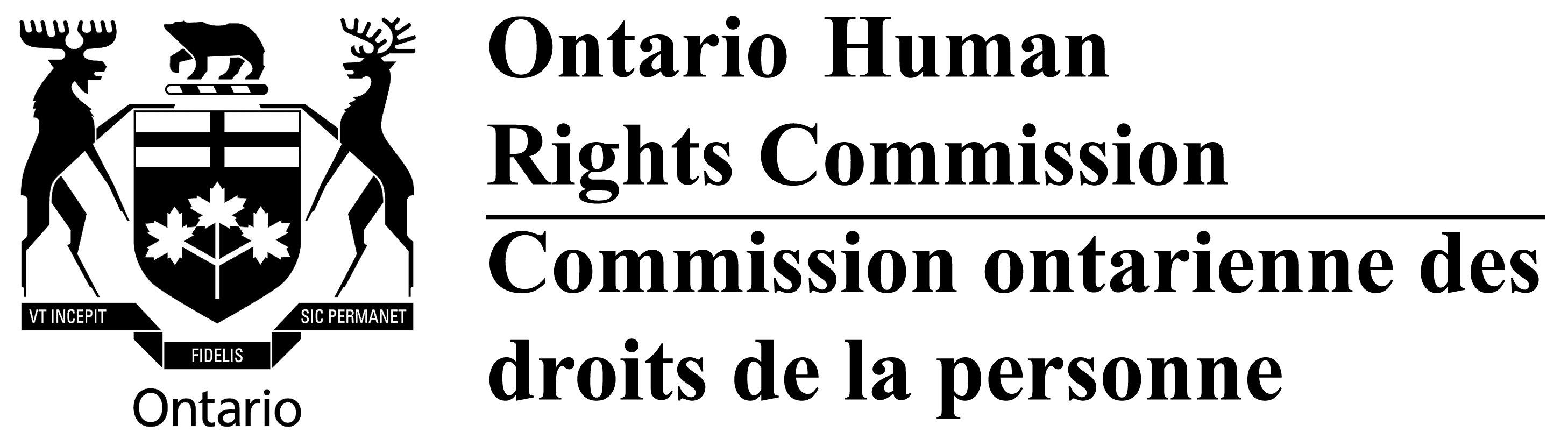Mai 2012
Introduction
Lorsque le Code des droits de la personne de l’Ontario a été proclamé en 1962, la croyance était l’un des motifs originaux de discrimination énoncés. Cette mention visait sans doute à s’attaquer à un problème important de discrimination ouverte contre les minorités religieuses. Avec le temps, la société et les lois canadiennes ont beaucoup évolué et abordent différemment le droit de croyance. Néanmoins, cette question continue d’être, sinon le premier, du moins l’un des domaines des droits de la personne les plus complexes et les plus controversés.
Peut-être plus que n’importe quel autre motif énoncé dans les codes des droits de la personne, le droit de croyance tend à soulever des opinions ardentes, même parmi ceux qui s’intéressent autrement assez peu aux droits de la personne. De nombreuses questions, par exemple ce qui constitue une croyance (et quelles convictions et pratiques sont protégées aux termes du motif de la croyance), comment prouver des plaintes relatives à la croyance, comment offrir des mesures d’adaptation et que faire lorsque le droit de croyance entre en conflit avec d’autres droits reconnus, ont été soumises à l’interprétation des tribunaux et ont suscité de grands débats publics. Au Québec, le gouvernement a nommé une Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles[1] en réponse au mécontentement de la population au sujet des mesures d’adaptation en général, et en particulier celles qui portent sur le droit de croyance.
Peut-être est-ce dû en partie au fait que la croyance est un motif unique à certains égards. Elle ne porte pas seulement sur des caractéristiques profondément personnelles, mais elle englobe des pratiques et des convictions. Les droits relatifs à la religion ne sont pas considérés simplement comme des droits à l’égalité mais comme l’une des « libertés fondamentales » de tous les Canadiens et Canadiennes, comme l’énonce l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés[2]. De plus, comme nous le verrons plus loin lorsque nous aborderons les décisions rendues au sujet des droits de la personne, la croyance plus que tout autre droit est touchée par les événements à l’échelle internationale, alors que des faits qui surviennent n’importe où dans le monde peuvent mener à l’intolérance religieuse et à la discrimination ici au Canada. Une tendance croissante en faveur de la laïcisation pourrait indiquer une tolérance réduite à l’égard des pratiques religieuses en général, même celles des religions qui ont été traditionnellement dominantes au Canada, comme les religions chrétiennes.
Malgré certains aspects particuliers des droits religieux, la Cour suprême du Canada a confirmé qu’il n’y a pas de hiérarchie de droits et que la croyance n’est pas moins digne de considération, de protection et de respect que tous les autres droits de la personne. Qui plus est, certains pensent que la façon dont une société traite ses minorités religieuses est une indication de son attitude de tolérance à l’égard de la différence et de la diversité en général[3]. Il est donc particulièrement important du point de vue de la protection des droits de la personne que l’on continue d’accorder aux droits liés à la croyance une reconnaissance égale à celle que l’on accorde aux autres droits.
Les pages qui suivent discutent les décisions juridiques d’importance qui portent sur les droits de religion et de croyance au Canada. L’accent est mis sur les décisions rendues depuis que la Commission a publié en 1996 sa Politique sur la croyance et les mesures d’adaptation relatives aux observances religieuses. La discussion n’aborde pas toutes les décisions, mais celles qui pourraient avoir de l’importance du point de vue des droits de la personne. En plus d’une description de la jurisprudence, on dégage les tendances observées ainsi que les secteurs où l’on prévoit que la jurisprudence continuera d’évoluer ou de se clarifier. L’examen formera la base de la recherche et du dialogue qui se poursuivra concernant le droit canadien et son application à cet important secteur des droits de la personne. Nombre de ces décisions seront prises en considération dans l’élaboration d’une nouvelle politique de la Commission concernant la croyance puisque les politiques de la Commission sont fondées sur la jurisprudence pertinente.
La protection du droit de croyance aux termes du Code et de la Charte
Le Code des droits de la personne (le Code) de l’Ontario interdit la discrimination et le harcèlement fondés sur le motif de la « croyance » dans cinq secteurs sociaux : 1) l’emploi; 2) les biens, services et installations; 3) le logement; 4) les contrats; 5) l’adhésion à un syndicat ou à une association commerciale ou professionnelle, ou l’inscription à l’exercice d’une profession autonome. Est interdite tout autant la discrimination directe[4] qu’indirecte, c’est-à-dire des règles ou exigences qui ne semblent pas discriminatoires à première vue mais qui ont pour effet de limiter les droits et les possibilités en raison de la croyance[5].
La « croyance » n’est pas définie dans le Code. Pas plus qu’elle n’a été clairement définie dans la jurisprudence. Cependant, le sens du mot « religion »[6] a été considéré dans de nombreuses décisions. Par le passé, la Commission a eu tendance à aborder le terme « croyance » de manière interchangeable avec « croyances religieuses » ou « religion » et cette approche a été suivie par le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario et les tribunaux judiciaires. Par conséquent, le présent examen jurisprudentiel discute des décisions juridiques portant soit sur la « croyance » soit sur la « religion ». Toutefois le fait que les termes « croyance » et « religion » existent tous deux dans les textes législatifs canadiens en matière de droits de la personne, les deux étant parfois même utilisés dans un même texte, donne à penser qu’ils ne sont pas identiques et devraient être interprétés comme ayant chacun un sens distinct[7]. De plus, la version française du Code utilise le terme « la croyance » pour la notion de « creed », un terme qui est aussi utilisé pour « belief »[8]. Comme les versions anglaise et française d’une loi doivent être prises en considération dans l’interprétation qu’on en fait, le sens du terme utilisé en français est important[9]. Par conséquent, dans le cadre des activités de recherche et d’élaboration de politiques qu’entreprendra la Commission en matière de croyance, il sera important de considérer s’il est juste de s’appuyer sur la définition de « religion » ou si on devrait plutôt donner au terme « croyance » un sens distinct, et dans ce cas, de le définir. Cet aspect est discuté plus à fond dans la section Définition de la croyance.
En plus des lois en matière de droits de la personne qui interdisent la discrimination et le harcèlement fondés sur la croyance ou la religion, l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) établit que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la religion. Le droit à la « liberté de conscience et de religion » est également protégé aux termes de l’alinéa 2 (a) de la Charte[10], lequel se lit ainsi :
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
a) liberté de conscience et de religion; …
Au contraire du Code qui s’applique au secteur public et aux entités privées, la Charte ne s’applique qu’au gouvernement, mais comprend les politiques, les programmes et les lois du gouvernement. Comme le Code et la Charte partagent des objectifs communs, on interprète souvent l’un à la lumière de l’autre[11]. Le présent document examine également des décisions portant sur les droits religieux reconnus par la Charte et considère leur pertinence dans le contexte des droits de la personne. Cependant, il une question qu’il conviendra d’approfondir est la mesure dans laquelle la façon d’aborder les libertés religieuses aux termes de l’alinéa 2 (a) de la Charte devrait influer sur le droit à l’égalité aux termes de l’article 15 de la Charte et le droit d’être à l’abri de la discrimination fondée sur la croyance aux termes du Code.
En plus des articles qui établissent le droit d’être à l’abri de la discrimination et du harcèlement fondés sur la croyance, le Code comprend un certain nombre d’autres dispositions qui ont un lien avec le droit de croyance. En particulier, un certain nombre de moyens statutaires de défense ou d’exceptions relativement à des actes qui seraient autrement considérés comme discriminatoires sont conçus pour protéger et promouvoir les droits religieux. Ces dispositions comprennent : 1) l’art. 18 qui permet à certains organismes religieux de n’accepter comme membres que des personnes identifiées par leur religion; 2) l’art. 18.1 qui permet aux autorités religieuses de refuser de célébrer un mariage ou de permettre qu’un lieu sacré soit utilisé pour la célébration d’un mariage si cela est contraire à leurs croyances religieuses; 3) l’art. 19 qui permet de préserver un droit ou un privilège dont jouissent les écoles séparées en vertu de la constitution canadienne[12] et de la Loi sur l’éducation de l’Ontario[13]; 4) l’art. 24 qui permet, en matière d’emploi, à certain organismes religieux d’accorder la préférence à une personne identifiée par cette religion si cette qualité requise est exigée de façon raisonnable et de bonne foi compte tenu de la nature de l’emploi.
Les décisions des tribunaux interprétant ces dispositions sont discutées en détail plus loin dans le présent document.
Définition de la croyance
Avant d’évaluer ce qui est protégé dans le cadre du motif de la croyance, il faut d’abord examiner ce que signifie la croyance et ce qui a été considéré comme constituant une croyance aux fins des textes législatifs concernant les droits de la personne et de la Charte.
Dans sa Politique sur la croyance et les mesures d’adaptation relatives aux observances religieuses publiée en 1996, la Commission définissait ainsi la croyance :
On entend par croyance une « croyance religieuse » ou une « religion », ce qui est défini par un système reconnu et une confession de foi, comprenant à la fois des convictions et des observances ou un culte. La foi en Dieu ou en des dieux, ou en un être suprême ou une divinité n'est pas une condition essentielle de la définition de croyance.
La CODP accepte le terme religion dans son sens le plus large, par exemple des groupes confessionnels sans divinité, comme les principes et pratiques spirituelles des peuples autochtones, ainsi que les nouvelles religions de bonne foi (chacune étant évaluée individuellement).
La Politique souligne également que le terme « croyance » est défini de façon subjective et que le Code protège les convictions, pratiques et observances religieuses personnelles, même si elles ne sont pas un élément essentiel de la croyance, pourvu que la personne y croie sincèrement.
L’interprétation large et subjective qu’a adoptée la Commission a été confirmée dans une large mesure par les arrêts ultérieurs de la Cour suprême du Canada portant sur les droits religieux. Elle a également été suivie dans les décisions du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario[14].
L’arrêt de principe de la Cour suprême du Canada interprétant ce qu’entend le terme « religion » est l’arrêt pris dans l’affaire Syndicat Northcrest c. Amselem[15] (« Amselem »). La Cour a adopté une définition générale, énonçant au par. 39 :
Une religion s’entend typiquement d’un système particulier et complet de dogmes et de pratiques. En outre, une religion comporte généralement une croyance dans l’existence d’une puissance divine, surhumaine ou dominante. Essentiellement, la religion s’entend de profondes croyances ou convictions volontaires, qui se rattachent à la foi spirituelle de l’individu et qui sont intégralement liées à la façon dont celui-ci se définit et s’épanouit spirituellement, et les pratiques de cette religion permettent à l’individu de communiquer avec l’être divin ou avec le sujet ou l’objet de cette foi spirituelle.
La Cour a également souligné que la teneur du droit de liberté de religion reconnu à toute personne en vertu de la Charte est également extensive et repose sur les notions de choix personnel, d’autonomie et de liberté de l’individu.
Les tribunaux judiciaires et administratifs n’ont pas eu de difficulté à conclure qu’un certain nombre de religions les plus couramment pratiquées à l’échelle mondiale, comme le christianisme, l’islam et le judaïsme, constituent des croyances au sens du Code. En fait, ce sont vraisemblablement ces religions qui étaient considérées lorsque le motif de la croyance a été ajouté au Code en 1962. Dans d’autres affaires, les tribunaux ont conclu que d’autres groupes confessionnels étaient protégés par le motif de la croyance : les témoins de Jéhovah; les adventistes du septième jour[16]; les membres de l’Église pentecôtiste[17]; les sikhs; les huttérites[18]; les raëliens[19]; les pratiquants du Falun Gong[20]; les membres de l’Église universelle de Dieu (Worldwide Church of God)[21], de l’Église du Dieu vivant (Christian Living Church of God)[22] et des Églises chrétiennes de Dieu (Christian Churches of God)[23]. Les tribunaux ont également conclu que les pratiques spirituelles des Autochtones étaient protégées[24].
Dans certains cas, les tribunaux ont tenté d’éviter de trancher sur la question de savoir si des systèmes de convictions non traditionnelles peuvent être assimilés à une croyance. Par exemple, dans Sauve v. Ontario (Training, Colleges and Universities), le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) a conclu qu’il n’avait pas à décider si l’Église métaphysique et la lecture du tarot sont assimilables à une croyance : « je conclus que même si le tarot pouvait être juridiquement compris dans la définition de croyance aux termes du Code, la décision de refuser les prestations pour travailleurs autonomes n’était pas fondée sur la lecture des cartes de tarot, par conséquent, il n’est pas nécessaire que je détermine si le tarot dans le contexte de cette cause constitue une croyance selon la jurisprudence pertinente… » [notre traduction][25]. Dans d’autres affaires, les décisionnaires ont accepté, sans discussion ou analyse poussée, qu’un système de convictions ou de croyances constituait bel et bien une croyance et se sont plutôt concentrés sur la question de savoir quelles pratiques étaient protégées. Par exemple, dans une décision arbitrale au sujet d’un grief, l’arbitre du travail n’a pas approfondi pourquoi la participation à la Rocky Mountain Mystery School, un « organisme qui enseigne les pratiques et connaissances anciennes de la lumière et de l’œuvre de la lumière dans le monde » [notre traduction] était une croyance, mais il s’est plutôt concentré sur la question de savoir si l’employeur était tenu de prendre des mesures d’adaptation pour accorder à l’employée un congé afin qu’elle participe à un pèlerinage[26]. En concluant que l’employeur aurait dû prendre de telles mesures d’adaptation, l’arbitre a implicitement admis que le motif de la croyance était en jeu.
La croyance n’est pas limitée à une confession religieuse et n’a pas à être fondée sur les décrets d’une « Église » établie[27]. Les « religions non traditionnelles » et les « systèmes de croyances » ont été considérés comme constituant une croyance. Dans Huang v. 1233065 Ontario, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a rejeté l’argument selon lequel Falun Gong est assimilable à un « culte » et ne devrait pas être accepté comme une croyance parce qu’en tant que système de croyances, il n’est pas raisonnable, ne peut résister au moindre examen scientifique, ou qu’il épouse des valeurs qui sont incompatibles avec les valeurs de la Charte. La requérante, dans son témoignage, assimilait Falun Gong à une « pratique » et non à une « religion ». Cependant, le TDPO a accepté la preuve d’experts indiquant que la notion de « religion » en Chine est bien différente de celle qui prévaut en Occident et qu’en termes occidentaux, Falun Gong serait considéré comme une croyance. Le TDPO a conclu que Falun Gong constitue un système de croyances, d’observances et de pratiques cultuelles et qu’il correspond à la notion de « croyance » aux fins du Code.
Dans Re O.P.S.E.U. and Forer, une décision arbitrale en matière de travail rendue en 1987, le tribunal, après avoir examiné les éléments de preuve, y compris des avis d’experts, au sujet de l’histoire, des pratiques et des croyances, a conclu que la wicca correspondait à la notion de « religion » au sens de la convention collective. Le tribunal a abordé la question de l’observance religieuse d’une perspective « large, libérale et essentiellement subjective » établie dans une décision antérieure de la Cour d’appel de l’Ontario[28]. Dans cette affaire, la Cour d’appel avait souligné la diversité des religions et des pratiques religieuses au Canada et avait insisté sur le fait que ce qui constitue un article de foi ou une pratique religieuse pour certains peut être considéré comme profane par d’autres. La notion de religion ne doit pas être déterminée du point de vue de la « majorité » ou du « courant dominant » d’une société.
Un tribunal de la Colombie-Britannique a rendu une décision dans laquelle étaient considérées les croyances d’un employeur dans le contexte d’une plainte de discrimination déposée par deux de ses employés, qui s’identifiaient comme athées et qui alléguaient que leur employeur essayait de les convertir. L’employeur soutenait que sa pratique de reiki n’était pas une pratique spirituelle[29], que ses convictions concernant l’importance des pensées et des propos positifs n’étaient pas de nature religieuse et que le livre dont il avait discuté avec les plaignants, The Secret, n’était pas un texte religieux. Le tribunal a conclu que les plaignants n’avaient pas réussi à prouver que les croyances de leur employeur constituaient une religion de sorte que le tribunal puisse conclure qu’il commettait un acte de discrimination à leur endroit en tentant de leur imposer sa religion. Le tribunal a observé que le livre The Secret parlait essentiellement de la « loi de l’attraction », c.-à-d. que toute personne avait le pouvoir de contrôler ses propres pensées, et que des pensées positives attiraient des résultats positifs. Le tribunal a conclu en ces termes : « à mon avis, cette théorie ne constitue pas un système de foi et de culte particulier et exhaustif, et par conséquent, il ne satisfait pas à la définition large de religion établie dans Amselem » [notre traduction]. Il importe cependant de noter que la décision reposait sur la conclusion que le système de croyance ne constituait pas une religion et que le fait que l’employeur en discute avec ses employés ne contrevenait pas au Code. Les conclusions sur la question de savoir si le système de croyances satisfaisait ou non à la définition de religion auraient pu être différentes si le tribunal avait considéré une situation dans laquelle des personnes avaient allégué subir des mauvais traitements en raison de ces mêmes pratiques et croyances.
Les tribunaux ont conclu que les opinions politiques seules ne sont pas considérées comme faisant partie du motif de « la croyance » dans le Code de l’Ontario. Dans Jazairi v. Ontario (Human Rights Commission)[30], la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé que les opinions du plaignant concernant la seule question des relations entre les Palestiniens et Israël ne constituait pas une croyance. Cependant, la Cour a confirmé l’importance d’évaluer chaque affaire relative à la croyance sur les faits qui lui sont propres et a souligné que la question de savoir si certaines perspectives politiques ou autres fondées sur un système cohérent de convictions pouvaient ou non constituer une « croyance » n’était pas une question sur laquelle elle devait trancher en l’instance. Le tribunal a observé que ce serait une erreur de traiter de questions aussi importantes dans l’abstrait.
Bien que la notion de « croyance » puisse ne pas se prêter à une définition précise, il est néanmoins évident qu’il existe quelques lignes directrices dans la jurisprudence pour aider à déterminer ce qui peut constituer une croyance aux fins du Code[31]. Bien que la pratique de sa propre croyance soit définie subjectivement, lorsqu’il s’agit de déterminer si un système de croyances récent ou non traditionnel constitue une croyance, les causes entendues jusqu’à présent donnent à penser qu’il est nécessaire qu’il y ait également un élément objectif, par exemple, la preuve de l’existence d’un système de croyances, d’observances et de pratiques cultuelles distinct et exhaustif. Pour les croyances plus récentes et moins connues, l’existence d’un tel système est souvent démontrée au moyen d’une preuve d’experts; voir par exemple les affaires Huang et Forer. Jusqu’à présent, il semble que les tribunaux n’ont pas conclu qu’une opinion politique en fasse partie. Bien que des croyances profanes, ainsi que des croyances morales ou éthiques fondées sur un sens social ou sur la conscience semblent ne pas être comprises dans le terme « religion » aux fins de la protection de la liberté de religion garantie par la Charte[32], la question de savoir si elles peuvent être comprises dans la notion de « croyance » aux termes du Code de l’Ontario semble être encore ouverte à un examen plus approfondi[33]. Par exemple, un décisionnaire a fait l’observation suivante :
Le terme « croyance » au sens du Code a un sens large et peut être interprété comme comprenant presque tout système de croyances qui englobe un ensemble particulier de croyances religieuses, mais également nombre d’autres croyances philosophiques, profanes et personnelles – les « ismes » (dans la terminaison des mots comme « environnementalisme », « conservatisme », « libéralisme » ou« socialisme »). Malgré le fait que le mot « croyance » puisse avoir un sens plus large, on constate que la plupart des causes portant sur la protection du Code contre la discrimination ont traité de questions de religion ou d’une forme quelconque d’observance religieuse[34]. [notre traduction]
Les décisionnaires ont insisté sur la prudence requise afin d’éviter de déterminer si un système de croyances constitue « une croyance » en se fondant sur une perspective occidentale ou « dominante » sur la religion puisque cela pourrait mener à l’exclusion de nombreuses religions valables, comme celles qui ne sont pas « monothéistes » ou qui sont considérées comme des religions « païennes ». Il n’appartient pas à un tribunal d’évaluer la qualité d’un système de croyances, c.-à-d. de déterminer s’il pourrait résister à un examen scientifique ou s’il épouse des valeurs qui sont incompatibles avec celles de la Charte[35].
Ce qu’englobent les termes « croyance » et « religion » n’est pas nécessairement la même chose que ce qui est protégé en vertu de la liberté de religion ou du droit d’être à l’abri de la discrimination fondée sur la croyance. Comme on le verra dans les pages qui suivent, les décisionnaires ont conclu que la Charte ou les lois en matière de droits de la personne ne protègent pas absolument tout ce qui est relié à la croyance.
Étendue de la protection relative à la religion et à la croyance
La Cour suprême du Canada a dit ceci dans l’affaire R. c. Big M Drug Mart Ltd.[36] :
Le concept de la liberté de religion se définit essentiellement comme le droit de croire ce que l'on veut en matière religieuse, le droit de professer ouvertement des croyances religieuses sans crainte d'empêchement ou de représailles et le droit de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte ou par leur enseignement et leur propagation. Toutefois, ce concept signifie beaucoup plus que cela.
. . . La liberté signifie que … nul ne peut être forcé d'agir contrairement à ses croyances ou à sa conscience.
Par conséquent la liberté de religion comprend à la fois la liberté de croire, de s’adonner au culte et de pratiquer sa religion à son gré, ainsi que la liberté de ne pas être contraint, directement ou indirectement, d’accepter ou d’adopter toute conviction, pratique ou forme de culte.
La Cour suprême a confirmé que la perception subjective et personnelle de tout demandeur à l’égard de sa religion est ce qui importe, non les obligations réelles de la foi ni les croyances et les pratiques des autres membres de la même confession. Les tribunaux doivent s’abstenir d’entrer dans des débats théologiques[37]. Par conséquent, pour revendiquer ses droits religieux, une personne doit démontrer l’existence des éléments suivants : 1) des croyances et des pratiques sincères; 2) qui ont un lien avec une religion; 3) que la personne croit et pratique avec sincérité, ce qu’elle peut démontrer; 4) pour communier avec le divin ou pour manifester sa foi spirituelle; 5) sans égard au fait que cette pratique ou conviction est exigée par un dogme religieux ou par les autorités religieuses ou que les autres membres de la même confession y adhèrent.
Pour évaluer la sincérité des croyances religieuses d’une personne, le rôle des tribunaux est de s’assurer « que la croyance religieuse invoquée est avancée de bonne foi, qu’elle n’est ni fictive ni arbitraire et qu’elle ne constitue pas un artifice[38] ». Dans bien des causes, ces éléments seront relativement faciles à établir. Cependant, dans d’autres causes, il faudra des preuves, habituellement de la part de la personne revendiquant le droit, pour établir que sa revendication est sincère. Le tribunal peut examiner la crédibilité de la preuve du demandeur et déterminer si cette croyance est compatible avec ses autres pratiques courantes[39]. Cependant, pour mesurer la sincérité d’une croyance religieuse affirmée, il n’est pas approprié de conclure que les croyances actuellement professées par une personne ne sont pas valides ou sincères du seul fait qu’elle les aurait rejetées ou ne les aurait pas suivies par le passé. Comme l’a déclaré la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. N.S.[40] : « La perfection passée n’est pas une condition préalable de l’exercice du droit à la liberté de religion que la Constitution garantit à toute personne. » [notre traduction]
Bien que la sincérité des croyances et des pratiques religieuses d’une personne soit la seule condition pertinente pour établir si ses droits religieux sont en cause, la Cour suprême du Canada a récemment confirmé qu’il faut des preuves objectives pour établir qu’il y a eu atteinte à des droits religieux; S.L. c. Commission scolaire des Chênes[41]. La Cour a dit que pour démontrer que les droits religieux ont été enfreints, une preuve objective est requise. Il ne suffit pas qu’une personne déclare qu’elle croit sincèrement que ses droits ont été enfreints. Comme pour tout autre droit, prouver l’atteinte exige une analyse objective des règles, faits ou actes en jeu pour déterminer s’ils portent véritablement atteinte à l’exercice du droit à la liberté de religion et, le cas échéant, dans quelle mesure. La personne doit prouver l’atteinte à ses droits suivant la prépondérance des probabilités. Cette preuve peut prendre toutes les formes reconnues par la loi, mais elle doit reposer sur des faits objectivement démontrables[42].
Même avant cet arrêt de la Cour suprême confirmant la nécessité d’établir la preuve objective d’une atteinte aux droits de croyance, certaines décisions des tribunaux ont conclu que les demandeurs n’avaient pas réussi à prouver suffisamment qu’un droit était en jeu ou avait été enfreint. Dans certaines affaires, la personne invoquait un droit de croyance en termes généraux ou abstraits sans expliquer de manière satisfaisante la nature de ce qui avait été touché par les actes de l’intimé ni la manière dont ces actes y avaient porté atteinte. Dans d’autres affaires, les décisionnaires avaient conclu que la croyance était en fait un prétexte pour une conduite motivée par d’autres considérations.
Par exemple, dans Chiang v. Vancouver Board of Education, une enseignante a soutenu, entre autres choses, que sa décision de ne pas afficher un autocollant en forme d’arc-en-ciel (pour montrer son appui aux élèves gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres) sur la porte de sa classe pouvait être perçue comme étant liée à ses croyances religieuses. Cependant le tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a conclu qu’elle n’avait pas présenté de faits qui établissaient un lien entre ses croyances religieuses, véritables ou perçues, et la conduite discriminatoire reprochée à son employeur :
D’abord, Mme Chiang n’a pas présenté de faits qui permettraient d’établir un lien entre ses croyances religieuses, réelles ou perçues, et la conduite qu’elle prétend discriminatoire. En aucun cas Mme Chiang présente des faits qui permettraient de conclure que sa conduite découle de ses croyances religieuses ou qu’elle a subi des conséquences néfastes en matière d’emploi parce qu’elle avait agi conformément à ses croyances religieuses. En fait, dans toutes ses communications avec les intimés ainsi que dans sa plainte et ses observations, Mme Chiang a pris le plus grand soin de ne pas révéler quelles sont ses croyances religieuses[43]. [notre traduction]
Dans l’affaire Kempling v. British Columbia College of Teachers[44], la cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté la requête d’un enseignant relativement à l’alinéa 2 (a) de la Charte parce qu’elle n’avait pas de fondement probatoire approprié. Le tribunal a souligné que les décisions relatives à la Charte ne sont pas rendues hors de tout contexte factuel, en particulier lorsque la liberté de religion est invoquée, puisqu’il s’agit d’un droit individuel, non généralisé. La preuve des obligations religieuses d’une personne et l’évaluation de sa sincérité peut comporter des éléments de crédibilité. Dans cette affaire, il n’y avait aucune preuve pour identifier la religion ou les préceptes de foi de M. Kempling et aucune preuve pour établir que sa capacité de pratiquer sa religion serait compromise de quelque façon que ce soit par l’interdiction imposée par le College of Teachers de faire des déclarations publiques discriminatoires au sujet des « homosexuels ». Il n’y avait donc pas de preuve suffisante pour conclure que ses droits découlant de l’alinéa 2 (a) étaient en jeu ou qu’ils avaient été enfreints.
De telles décisions montrent que des affirmations faites dans l’abstrait sur le droit de croyance ne suffisent pas à prouver une allégation de discrimination ou d’une atteinte à la liberté de religion.
Il existe également des situations dans lesquelles les décisionnaires n’ont tout simplement pas cru les affirmations des requérants voulant que leur conduite soit fondée sur des croyances, et ont conclu au contraire qu’elle était motivée par d’autres facteurs. Dans l’affaire Bothwell v. Ontario (Minister of Transportation)[45], le tribunal a conclu que le requérant n’avait pas réussi à prouver qu’il refusait de faire faire une photo numérique pour son permis de conduire pour des raisons liées à ses croyances religieuses. Le tribunal a constaté de nombreuses incohérences dans ces actions qui jetaient un doute sur sa sincérité. Ces actions comprenaient le fait que le requérant avait un site Web sur lequel sa photo numérique était affichée et qu’il avait été photographié par caméra numérique dans de nombreux autres contextes. De plus, dans plusieurs lettres envoyées au ministère et à d’autres correspondants, il avait soulevé des inquiétudes concernant la protection de la vie privée, et non des objections de nature religieuse, du fait que la photo numérique du permis de conduire était conservée dans la base de données du gouvernement.
Dans l’affaire Bauer v. Toronto (City)[46], le TDPO a considéré une requête déposée par un ambulancier qui alléguait qu’il avait fait l’objet de harcèlement et de représailles de la part de ses collègues de travail parce qu’il avait traversé les piquets de grève et fait un quart de travail durant une grève. Il a affirmé que sa décision de traverser les piquets était reliée à sa foi chrétienne qui l’empêchait de refuser des soins de santé pour des raisons de gain financier. En examinant la preuve, le tribunal a conclu que l’allégation de M. Bauer selon laquelle il avait traversé les piquets de grève en raison de sa foi n’était pas crédible mais constituait « une relation révisionniste des faits ». M. Bauer était en fait opposé à la grève en raison de tensions au sein de son syndicat. Par conséquent, le tribunal a conclu que le motif de la croyance ne s’appliquait pas aux faits de la cause.
Tout ce qui est relié à la croyance d’une personne n’est pas nécessairement protégé. Par exemple, une femme n’a pas réussi à établir que ses activités bénévoles dans sa paroisse relevaient du motif de la croyance aux termes du Code[47]. Le fait de gérer un camp de jour organisé par son église en tant qu’activité de financement n’était pas de nature religieuse et n’a pas été considéré comme une obligation selon les préceptes de sa foi. Le fait que ces activités se déroulent à l’église ne suffisait pas à conclure qu’elles étaient liées à sa croyance. Dans une décision semblable, une commission d’arbitrage de l’Ontario a conclu que les activités sociales et communautaires liées à la religion ne sont pas couvertes[48]. Une commission d’enquête de la Nouvelle-Écosse a rejeté la requête voulant qu’un condominium soit tenu de prendre des mesures pour satisfaire à une demande d’installation d’une soucoupe, à l’encontre de ses propres règlements internes, pour permettre au requérant de capter des émissions religieuses et culturelles musulmanes de sources internationales. La commission a déclaré que pour pouvoir établir qu’il y a eu discrimination, il faut faire plus que montrer un lien quelconque avec la religion. Au contraire de l’affaire Amselem, rien n’indiquait que l’accès au service par satellite constituait une pratique, une croyance, une obligation, une coutume religieuse ou qu’il faisait partie des préceptes de la foi ou de la culture de la famille. Bien que le requérant ait voulu l’accès à une technologie qui permettrait à sa famille d’être davantage exposée à sa culture, sa langue et sa religion, rien n’indiquait que son absence compromettrait de quelque façon que ce soit l’observance de leur foi[49].
De la même façon, une commission d’arbitrage du Yukon n’a pas admis qu’un homme des Premières nations avait droit à un congé spécial pour assister à une réunion de sélection relative aux revendications territoriales en raison de ses devoirs ancestraux et religieux[50].
Même lorsque des droits religieux sont en jeu, ce n’est pas tout ce qui entrave ces droits qui constitue de la discrimination ou qui contrevient à la Charte. Comme on l’a vu dans l’affaire Amselem et plus récemment dans l’affaire S.L., aucun droit, y compris la liberté de religion, n’est absolu. Qui plus est, la Charte n’exige pas que les gouvernements s’abstiennent d’imposer un fardeau quelconque à la pratique d’une religion. En ce qui concerne les requêtes relatives à l’alinéa 2 (a) de la Charte, les tribunaux ont conclu qu’une atteinte aux droits religieux doit aller au-delà du « du négligeable ou de l’insignifiant » pour être considérée contraire à la Charte. Une atteinte « négligeable ou insignifiante » est une atteinte qui ne menace pas véritablement une croyance ou un comportement religieux[51].
Dans sa récente décision dans l’affaire R. v. Badesha, la Cour de justice de l’Ontario a observé que le degré d’ingérence qui doit être démontré avant que l’on considère que les effets sur les droits religieux comme plus que « négligeables » ou « insignifiants » peut varier selon les circonstances particulières. L’affaire portait sur une contestation d’une loi ontarienne qui oblige le port du casque de protection pour conduire une motocyclette. M. Badesha a soutenu qu’il ne pouvait pas porter de casque en raison de ses profondes croyances religieuses concernant la nécessité pour lui de porter un turban. Le tribunal a conclu que l’atteinte aux droits religieux de M. Badesha découlant du fait qu’il ne pouvait pas conduire une motocyclette était négligeable et insignifiante et que, par conséquent, l’alinéa 2 (a) de la Charte n’était pas enfreint[52]. Le tribunal a souligné que la limite imposée avait un effet sur sa capacité de conduire une motocyclette de la façon dont il voulait, non sur son droit de s’adonner au culte ou de mettre en pratique les croyances liées à sa religion. Conduire tout type de véhicule est un privilège et non un droit[53]. Le tribunal a fait la distinction avec l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Hutterian Bretheren dans laquelle la majorité des juges a conclu que le fait d’exiger que tous les détenteurs d’un permis de conduire de l’Alberta consentent à la prise d’une photo numérique constituait une atteinte importante aux croyances religieuses de la colonie huttérite déclarant que les coûts ou le fardeau dans ce cas a été démontré comme étant d’une ampleur bien différente.
La décision Badesha semble limiter considérablement l’étendue de ce qui est protégé en vertu de la liberté de religion. Elle semble indiquer qu’une atteinte aux droits d’une personne ne sera considérée comme importante que dans la mesure où celle-ci se trouvait obligée de choisir entre l’exercice d’une activité particulière, dans ce cas enlever son turban pour pouvoir conduire une moto en portant le casque protecteur, et l’observance de ses croyances religieuses. Reste à savoir si cette approche restrictive sera suivie par d’autres décisionnaires.
Quand il s’agit de déterminer ce qui est protégé en vertu de la croyance, les tribunaux ont également soutenu que la protection des croyances religieuses pourrait être plus large que celle qui s’applique à la conduite découlant de ces croyances, affirmant que « la liberté de croyance est plus large que la liberté d’agir sur la foi d’une croyance[54] ». Ceci est particulièrement vrai lorsque la conduite découlant des croyances pourrait avoir une incidence néfaste ou préjudiciable sur les droits d’autrui[55]. Nous reviendrons sur la façon dont les tribunaux ont traité de situations dans lesquelles le droit de croyance entrait en conflit avec d’autres droits dans la section intitulée Conciliation du droit de croyance et d'autres droits.
Enfin, le droit de vivre à l’abri de la discrimination fondée sur la croyance comprend le droit de ne pas être soumis à « l’imposition obligatoire d’une observance religieuse » c.-à-d. l’imposition des croyances ou pratiques religieuses d’autrui. Par conséquent, quiconque choisit de ne pas s’identifier comme adepte d’une religion ou d’une croyance peut néanmoins revendiquer la protection du Code aux termes du motif de la croyance dans certaines situations. Des exemples en seront donnés à la section Imposition d’observances et de messages religieux.
Pour résumer, les tribunaux ont établi plusieurs principes importants permettant de déterminer ce qui est protégé aux termes des lois :
- C’est l’interprétation personnelle ou subjective que fait le requérant de sa croyance ou religion qui compte, et non les obligations réelles de sa foi ni ce que les autres adeptes de cette foi croient ou pratiquent.
- C’est la sincérité ou l’honnêteté de la croyance ou de la pratique qu’il faut prouver.
- La protection ne porte pas sur tout ce qui est lié à la religion ou à la croyance. La croyance ou la pratique visée doit avoir un lien avec une religion « en ce qu’elle est objectivement prescrite par la religion, ou que (l’intéressé) croit subjectivement que la religion le prescrit, ou qu’il croit sincèrement que la pratique crée un lien personnel subjectif avec l’ordre divin ou avec le sujet ou l’objet de sa foi spirituelle[56]. » Les activités sociales ou culturelles ne satisfont généralement pas à ce critère.
- Pour établir qu’il y a eu atteinte à un droit, il faut une preuve objective d’une entrave à des droits religieux.
- Pour ce qui est des allégations d’atteinte à la liberté de religion aux termes de l’alinéa 2 (a) de la Charte, l’entrave aux droits religieux doit dépasser le négligeable et l’insignifiant. Bien que cet aspect n’ait pas été pleinement élaboré dans la loi, on peut dégager certains facteurs pertinents, comme le fait de savoir si la loi, la politique ou l’acte contesté empêche absolument la pratique ou la croyance ou s’il ne fait que toucher indirectement une question de foi, et la nature de son incidence sur la religion (p. ex., économique, sociale, etc.).
- La protection des croyances religieuses est plus large que celle qui s’applique à la capacité d’agir en fonction de ces croyances.
Discrimination et harcèlement fondés sur la croyance
Au cours des dix dernières années, plusieurs décisions intéressantes ont été rendues en matière de droits de la personne au sujet de la discrimination et du harcèlement fondés sur la croyance. Il se dégage de la jurisprudence que les attitudes discriminatoires à l’égard des religions minoritaires (lesquelles sont souvent liées à d’autres motifs énoncés dans le Code, comme la race, la couleur, l’origine ethnique, le lieu d’origine et l’ascendance) continuent d’exister et de se traduire par un traitement inégal fondé sur la croyance[57]. D’autres décisions donnent à penser que des tensions religieuses pouvant découler de certains événements internationaux peuvent donner lieu à des actes de discrimination religieuse ici en Ontario. D’autres décisions semblent faire état d’un malaise croissant à l’égard des personnes qui s’identifient ouvertement comme religieuses, quelle que soit la religion pratiquée.
Dans l’affaire Loomba v. Home Depot Canada[58], le TDPO a conclu que l’obligation de porter le casque protecteur à une succursale de la chaîne Home Depot qui était en construction avait été appliquée de manière sélective et inégale. Une approche plus stricte avait été adoptée à l’égard de M. Loomba, un agent de sécurité de religion sikhe, parce qu’il portait le turban, coutume étroitement liée à sa croyance. Cette situation portait atteinte à son droit d’être à l’abri de toute discrimination fondée sur la religion. Le Tribunal a également conclu que le particulier intimé dans l’affaire avait fait subir à M. Loomba un traitement discriminatoire sous forme de conduite et de propos grossiers et insultants. Le tribunal a conclu que le particulier intimé avait tourmenté M. Loomba pour le forcer à enlever son turban pour pouvoir continuer à travailler et qu’il l’avait menacé de mettre fin à son emploi. Sa conduite et ses propos dénigraient la croyance du requérant[59]. Fait intéressant, même si les motifs de la discrimination alléguée comprenaient également la race, la couleur et l’origine ethnique, le tribunal a décidé de ne considérer l’affaire que comme une affaire portant sur le droit de croyance. Le tribunal n’a pas encore rendu sa décision en ce qui concerne un deuxième aspect de l’affaire : la relation entre le devoir de prendre des mesures d’adaptation en vertu du Code et les exigences relatives à la sécurité énoncées dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail[60].
Un tribunal de droits de la personne en Alberta a conclu que le fait que le Tequila Bar and Grill refuse l’admission à un sikh portant le turban constituait un cas de discrimination intersectionnelle fondée sur des motifs de race, de religion et d’ascendance; Randhawa v. Tequila Bar & Grill Ltd[61]. Le tribunal a accepté la preuve que le bar utilisait une caméra vidéo de surveillance pour repérer les personnes dans la file d’attente qu’on ne voulait pas faire entrer, en se fondant sur leur apparence. Le tribunal a accepté le témoignage de M. Randhawa selon lequel le portier lui a dit que la file était surveillée par la direction qui ne voulait pas le laisser entrer parce que le bar avait « une image à maintenir » durant la semaine du Stampede et ne voulait pas « trop de gens de peau brune ». M. Randhawa a reçu des dommages-intérêts de 5 000 $ et le bar a reçu l’ordre de mettre en œuvre une politique pour prévenir la discrimination raciale et de participer à des séminaires de sensibilisation menés par l’Alberta Human Rights Commission.
Dans Yousufi v. Toronto Police Services Board[62], le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a examiné une plainte de discrimination fondée sur l’origine ethnique, le lieu d’origine et la croyance perçue (musulmane) déposée par un employé civil du service de police de Toronto. Le 12 septembre 2001, un détective du service de police de Toronto (SPT) a laissé un message dans la messagerie vocale d’un autre détective disant qu’il avait des informations selon lesquelles le requérant, un homme qui s’identifiait comme non-Blanc d’ascendance afghane, avait été impliqué dans les événements du 11 septembre. Plus précisément, en déguisant sa voix et en adoptant un accent censé être celui d’une personne du Moyen-Orient, le détective a déclaré qu’Abdullah Yousufi avait suivi des leçons de pilotage à l’aéroport de Buttonville. Il a également suggéré que l’on fouille le casier de Yousufi pour y trouver un manuel de pilotage en arabe et il a affirmé que Yousufi était un « infâme militant islamique ».
Le message a été envoyé à la division des affaires internes du SPT pour une enquête, au cours de laquelle le message a été porté à la connaissance du requérant. Bien que le tribunal ait admis que le message avait été laissé dans l’intention de faire « une farce », le requérant en avait été bouleversé à juste titre et estimait que son employeur n’avait pas fait d’enquête suffisante ni pris des mesures adéquates en réponse à cet incident. De plus, l’incident a rapidement été connu dans toute la division et M. Yousufi est devenu la cible de racontars et de soupçons au sujet de sa participation aux événements du 11 septembre.
Le tribunal a conclu que le message était plein de stéréotypes répréhensibles et que « le fait d’adopter un ton de voix et un accent qui prétend imiter une personne du Moyen-Orient en parlant avec un fort accent et un mauvais anglais, et le fait de semer des soupçons sur le requérant en laissant entendre qu’il était impliqué dans les événements du 11 septembre constituent un acte de discrimination fondée sur l’origine ethnique, le lieu d’origine et la croyance » [notre traduction]. Pour ce qui est de l’intervention de l’employeur suite au message, le tribunal a conclu que l’employeur avait procédé à une enquête appropriée et pris des mesures disciplinaires à l’égard de l’employé qui avait laissé ce message, mais qu’il n’était pas intervenu de manière suffisante pour traiter de la question des racontars et des soupçons concernant M. Yousufi découlant de l’incident. Le tribunal a conclu que cela avait empoisonné le milieu de travail de M. Yousufi.
Dans une cause semblable en Colombie-Britannique, Kinexus Bioinformatics Corp. v. Asad[63], un citoyen canadien de religion musulmane avait été soumis à une enquête humiliante de la GRC après qu’une de ses collègues de travail eut communiqué avec la GRC pour dire qu’elle le soupçonnait d’avoir été mêlé aux attaques du 11 septembre. Le tribunal a conclu que si M. Asad n’avait pas été un arabe musulman qui avait immigré de l’Arabie saoudite, la collègue de travail n’aurait pas agi de cette manière. Le tribunal a conclu que l’employeur de M. Asad n’était pas responsable de la fausse dénonciation à la GRC qui avait été faite hors du lieu de travail. Cependant, l’employeur était responsable du profilage racial en milieu de travail. Il avait laissé libre cours aux soupçons concernant M. Asad dans son milieu de travail et n’avait pris aucune mesure pour remédier aux effets que la situation avait sur M. Asad, le laissant se débattre seul dans un milieu de travail empoisonné[64].
Dans l’affaire Modi v. Paradise Fine Foods, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a examiné la requête d’un client, qui s’identifiait comme un Noir de religion chrétienne né au Soudan, déposée à la suite d’une altercation physique et verbale survenue dans une boucherie halal. Le tribunal a conclu que le particulier intimé, qui était le boucher de l’établissement, avait engagé une confrontation en proférant des propos incendiaires sur des questions ethniques et religieuses touchant le Soudan, et qui s’était rapidement détériorée en une altercation physique. Le tribunal a conclu que M. Modi avait subi une discrimination fondée sur les motifs concurrents de l’origine ethnique (Africain noir d’une culture non musulmane) et de la croyance (non musulman) :
En confrontant à la fois M. Modi (et incidemment M. Ayumé) avec sa perception de l’état des choses au Soudan et ce qu’il considérait approprié pour le Soudan, M. Ben Aycha a employé un langage et adopté une conduite qui manifestaient un mépris pour M. Modi en tant que personne noire non musulmane née au Soudan. Non seulement a-t-il exprimé son sens de l’infériorité des personnes d’origine soudanaise qui ne sont pas musulmanes, mais la rapidité avec laquelle ses propos se sont envenimés pour faire place à des menaces de violence et éventuellement à des actes de violence à l’aide d’un couperet à viande a fourni la preuve d’un antagonisme profondément enraciné à l’égard des personnes de l’origine ethnique de M. Modi qui n’étaient pas musulmanes et qui exprimaient une loyauté ou une fidèle adhésion à ces marques de leur identité[65]. [notre traduction]
Le tribunal a souligné que pour déterminer si M. Modi avait été victime de discrimination, il importait peu que le particulier intimé ait su ou non qu’il était chrétien. Il était suffisant que le particulier intimé ait agi comme il l’avait fait parce que M. Modi lui avait clairement révélé qu’il n’était pas musulman. Le droit à un traitement égal fondé sur la croyance comprend une protection contre la discrimination fondée sur le fait qu’une personne n’adhère pas à une certaine croyance et non seulement la discrimination fondée sur l’adhésion à une certaine croyance.
De la même façon, dans l’affaire Hadzic v. Pizza Hut[66], le tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a traité d’une affaire dans laquelle les tensions religieuses qui sévissaient à l’étranger donnaient lieu à des actes de discrimination dans cette province. L’employeur a été tenu responsable de ne pas avoir agi de manière suffisante pour traiter des propos discriminatoires proférés par un employé qui s’identifiait comme Serbe de Bosnie envers un de ses collègues de travail, M. Hadzic, qui s’identifiait comme un Bosniaque musulman. Le tribunal a conclu que l’employé serbe a menacé de tuer des musulmans à Sarajevo et de faire du mal à M. Hadzic et à sa famille. Il a également utilisé le terme « zacklan » lequel a été considéré comme particulièrement choquant pour M. Hadzic en raison de sa signification violente (décapitation) et de sa connotation historique et actuelle pour une personne d’ascendance bosniaque. Le tribunal a conclu que les propos avaient été proférés à l’endroit de M. Hadzic en raison de son patrimoine culturel et de son ascendance bosniaques, de son lieu d’origine et de sa religion. L’employeur a été jugé responsable. Les mesures prises par l’employeur en réponse à ces graves menaces n’étaient pas adéquates.
Dans l’affaire Huang[67], le tribunal a déterminé qu’une association de personnes âgées d’origine chinoise avait commis un acte de discrimination fondé sur la croyance lorsqu’elle avait révoqué le statut de membre d’une femme parce qu’elle était pratiquante du Falun Gong. Puis, lorsqu’elle a essayé de discuter de la révocation de son statut de membre avec l’association, les dirigeants ont qualifié publiquement le Falun Gong de « culte maléfique ». Le tribunal a précisé qu’une religion n’est pas à l’abri de la critique et que le seul fait de critiquer ou de réfuter les principes de son système de croyances ne constitue pas nécessairement un acte de discrimination. Cependant, dans cette affaire, le fait de qualifier le Falun Gong de « culte maléfique » constituait bel et bien de la discrimination. En accordant à cette femme des dommages-intérêts de 15 000 $ en compensation des effets de la discrimination, le tribunal a souligné que l’acte de discrimination avait été public et l’avait humilié au sein de sa communauté. Fait intéressant, le tribunal a également tenu compte du fait que la requérante était plus vulnérable parce qu’elle fait partie d’un groupe religieux qui a été persécuté. L’ordonnance obligeait également l’association à inviter la requérante à redevenir membre.
Un pub irlandais qui avait annulé un « mini-séminaire » que devait tenir à cet endroit un groupe de raëliens a été déclaré coupable d’avoir enfreint le Code; Gilbert v. 2093132 Ontario Ltd[68]. Les requérants avaient réservé le pub et distribué des dépliants pour annoncer cette activité. Lorsque le gérant a appris que les requérants avaient distribué plus de 500 dépliants, il a commencé à s’inquiéter de ce que l’activité allait nuire aux affaires un samedi soir. Il a donc dit aux requérants qu’ils ne pourraient pas tenir le séminaire tel que prévu. Le TDPO a conclu que le pub avait pris cette décision pour des raisons commerciales légitimes et non à cause de la croyance des requérants. Toutefois, dans ses discussions avec les requérants, le gérant du pub avait dit de manière agitée qu’il ne voulait pas que le pub soit associé à leur « culte ». Le TDPO a donc accordé 100 $ à chaque requérant.
Deux décisions rendues en C.-B. traitaient de l’accès aux services spirituels pour les détenus autochtones. Dans l’une des décisions, le tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a conclu que les détenus autochtones étaient en effet privés d’un accès aux services spirituels autochtones, ce qui constitue une discrimination fondée sur la religion et l’ascendance; Kelly v. British Columbia (Public Safety and Solicitor General) (No. 3)[69]. M. Kelly souhaitait avoir accès aux services spirituels autochtones offerts par un agent de liaison autochtone. Ces services comprenaient des activités de ressourcement, de conversation, de partage ou de participation à des cercles sacrés, des cérémonies de purification et de suerie, des séances individuelles et la fabrication et l’utilisation d’un sac de médecine, de capteurs de songes ou de tambours. Malgré des demandes répétées, il n’a pas reçu la visite de l’agent de liaison autochtone ni d’ouvrages spirituels autochtones. Cependant, il a reçu la visite d’un aumônier et des ouvrages chrétiens dans un délai raisonnable. Essentiellement, le tribunal a conclu que, alors même que les services chrétiens étaient raisonnablement disponibles, il n’y avait pas d’accès réel à des services spirituels autochtones. Le fait que M. Kelly était en isolement une grande partie du temps ne justifiait nullement le traitement défavorable.
Cependant, dans une décision antérieure concernant un détenu métis, Smith v. B.C. (Ministry of Public Safety and Solicitor General) and another[70], le tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique n’a pas conclu qu’il y avait eu discrimination. C’était le statut de M. Smith (il avait demandé lui-même à être en isolement protecteur parce qu’il craignait pour sa sécurité) et non sa race ou sa religion qui avait motivé le refus de l’accès aux pow-wows. Les pow-wows comprenaient un rassemblement de tous les détenus avec des membres de la collectivité extérieure, y compris des femmes et des enfants, dans le stade de baseball des terrains de la prison, et tant les Autochtones que les non-Autochtones pouvaient y participer. La preuve montrait que les détenus Autochtones et non-Autochtones étaient traités de la même façon quant à l’accès aux pow-wows, et la décision de limiter ou de refuser la participation était fondée sur la nécessité de garder les détenus en isolement protecteur séparés de la population pénitentiaire générale pour assurer leur propre sécurité.
Ce ne sont pas seulement les pratiquants de religions dites « minoritaires » qui peuvent faire l’objet de discrimination fondée sur la croyance. Dans une récente décision, une femme avait allégué qu’elle avait été traitée de manière défavorable en tant que mère d’une famille d’accueil en raison de sa foi chrétienne ou en raison de son association perçue avec un programme d’inspiration chrétienne pour les jeunes appelé Freedom Village. Dans l’affaire Williams v. Children’s Aid Society of Toronto[71], le TDPO a examiné une situation complexe portant sur les rapports contractuels existant entre M. et Mme Williams, d’une part, et chacun des deux organismes, la Children’s Aid Society of Toronto (CAST) et l’Alliance Youth Services Inc. (AYS). Les Williams avaient conclu un contrat avec AYS en vue de fournir un foyer d’accueil à des enfants. Après que les Williams eurent indiqué qu’ils espéraient mettre sur pied et diriger un camp d’inspiration chrétienne pour les jeunes en détresse dans une région rurale de l’Ontario, on leur a demandé s’ils étaient associés d’une quelconque façon à Freedom Village, un camp d’inspiration chrétienne des États-Unis dans lequel il y avait eu des problèmes relatifs aux soins des enfants. Malgré leur assurance qu’il n’y avait aucun lien, les intimés ont continué à soupçonner une possible affiliation à cet autre camp chrétien. Une autre question a été soulevée, celle de savoir si la foi ou les croyances chrétiennes de la requérante et de son conjoint pourraient poser un problème s’il advenait qu’un enfant confié à leurs soins soit gai.
Le tribunal a conclu que la question de savoir si la croyance de la requérante pourrait poser un problème s’il advenait qu’un enfant confié à ses soins soit gai n’avait pas été posée de manière inappropriée comme l’alléguait la requérante. Dans les circonstances (y compris le fait que la requérante a admis que l’AYS avait le droit de poser cette question), la question n’était pas inappropriée. Les intimés ont été satisfaits de la réponse reçue et aucune suite n’a été donnée à ce sujet. Le tribunal a conclu que le fait de poser cette question ne constituait pas un acte de discrimination.
De nombreuses autres questions portant sur la relation entre les Williams et les intimés n’avaient rien à voir avec le Code. Il existait des raisons crédibles et non discriminatoires pour lesquelles l’AYS a conclu que les Williams étaient incapables de travailler de manière efficace et dans un esprit de collaboration avec le personnel de l’AYS. Néanmoins, le tribunal a conclu que les questions soulevées par les Williams au sujet du racisme et de l’atteinte à leurs croyances religieuses avaient été un facteur dans la décision de mettre fin à leur contrat. Les soupçons persistants au sujet d’une possible affiliation entre Freedom Village et le projet de camp pour les jeunes proposé par les Williams étaient fondés en partie sur le fait que les deux programmes sont d’inspiration chrétienne. Par conséquent, le tribunal a conclu que les Williams avaient été traités de manière discriminatoire par AYS et par CAST.
Une décision semblable rendue en C.-B. portait sur la question de savoir si les convictions pro‑vie de la requérante, lesquelles découlaient de sa foi chrétienne, avaient été un facteur dans son congédiement de son emploi en tant que directrice administrative d’une clinique de médecine familiale; C. v. A[72]. Le tribunal a constaté que l’un des médecins était inquiet des convictions pro-vie de la requérante et de l’effet qu’elles pouvaient avoir sur les soins aux patients (en particulier à l’égard des renvois à des services d’avortement). Même si le médecin avait demandé à la requérante d’enlever une affiche pro-vie et une Bible qu’elle avait placées dans la salle d’attente et qu’il avait parlé à la requérante de l’effet que ses convictions pouvaient avoir sur les soins aux patientes, le tribunal a conclu que les convictions pro-vie de la requérante n’avaient pas été un facteur de son congédiement. Bien que le tribunal ne l’ait pas énoncé expressément, il semble avoir accepté qu’il était légitime pour le médecin de veiller à ce que les patientes qui demandaient un avortement soient traitées de manière appropriée par la requérante. Le tribunal a également souligné que la clinique avait pris des mesures d’adaptation pour répondre à la demande de la requérante qui ne voulait pas prendre part aux renvois à des services d’avortement en confiant cette tâche à un autre adjoint médical ou au médecin qui demandait le renvoi.
Un malaise à l’égard des messages religieux ayant entraîné un traitement défavorable a également constitué le fondement d’une allégation de discrimination. Une ville de la Nouvelle-Écosse avait pour politique administrative de ne pas permettre de spectacles ayant un message religieux ou politique sur ses scènes publiques. Lorsque le Révérend Gilliard a demandé d’utiliser la scène Marina Stage pour un spectacle intitulé « This Blood is For You », lequel comprenait une courte pièce de théâtre, des chants gospel et des sermons inspirés de l’Évangile, la demande a été refusée parce que le spectacle contenait un message religieux. Comme la religion était un facteur dans la décision de ne pas permettre au Révérend Gilliard d’utiliser la scène de la municipalité, le tribunal a conclu qu’il y avait eu discrimination; Gilliard v. Pictou (Town) (No. 2)[73]. Cette affaire soulève d’importantes questions concernant la mesure dans laquelle des institutions laïques peuvent refuser de permettre la promotion de messages religieux dans les espaces publics (par exemple, parce que l’on craint que l’autorisation de diffuser des messages religieux entraîne des plaintes de la part de personnes qui pourraient soutenir avoir le droit de ne pas être soumis à l’imposition de messages religieux).
Les tribunaux ont également considéré comme discriminatoire le fait de proférer des commentaires désobligeants au sujet de la fidélité d’une personne à l’égard de sa foi ou de l’adhésion à ses croyances, p. ex. le fait de dire qu’une personne n’agit pas comme « un vrai chrétien »[74].
Enfin, il importe de souligner que les références à la religion ne sont pas toutes jugées comme contraires au Code. Par exemple, une femme musulmane à qui son superviseur a posé des questions sur le jeûne durant le Ramadan n’a pu convaincre le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario que cela portait atteinte à ses droits de la personne[75]. Le tribunal n’a pas jugé que les commentaires avaient été désobligeants, mais a plutôt conclu qu’ils témoignaient d’un intérêt véritable pour le Ramadan et le jeûne. Le tribunal a déclaré qu’une personne raisonnable n’interpréterait pas ces propos comme humiliants et discriminatoires. Bien que, de toute évidence, toutes les discussions portant sur la religion ne posent pas un problème du point de vue des droits de la personne, la décision n’offre pas une analyse approfondie de la nature de la perspective adoptée par la « personne raisonnable »; celle du groupe majoritaire ou celle de la minorité religieuse dont les pratiques religieuses sont en question. Dans une autre décision, le tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a conclu que le fait qu’un collègue de travail ait traité le requérant de « fucking Hindu » (en réalité, ce dernier s’identifiait comme Sikh) dans le contexte d’un incident de travail isolé, ne constituait pas à lui seul une infraction au Code de la Colombie-Britannique[76].
Il y a également de nombreux exemples de causes[77] dans lesquelles la croyance n’a pas été considérée comme un facteur du traitement discriminatoire allégué. Chaque cause est jugée sur les faits qui lui sont propres et ne sont pas résumées dans le présent examen de la jurisprudence.
Imposition d’observances et de messages religieux
La liberté de religion et le droit d’être à l’abri de la discrimination fondée sur la croyance comprend également le droit de ne pas être soumis à la contrainte et à la coercition en matière de religion. Cette question a été traitée dans le cadre de diverses contestations aux lois et aux pratiques qui imposent des observances religieuses, généralement celles de la foi chrétienne, à des personnes qui ne partagent pas cette foi. Les décisionnaires ont également traité de situations dans lesquelles des employeurs ont cherché à imposer leurs idées religieuses à leurs employés.
Les tribunaux canadiens ont maintenu que le soutien d’État à une tradition religieuse constitue une discrimination à l’égard des autres[78]. L’un des arrêts de principe de la Cour suprême du Canada portant sur les droits religieux, R. c. Big M. Drug Mart[79], était une contestation en vertu de la Charte d’une loi fédérale, la Loi sur le dimanche, selon laquelle il était illégal pour les magasins de rester ouverts le dimanche, à quelques exceptions près. La Cour suprême a conclu que l’objet de la loi était d’obliger l’observance du jour de repos chrétien et que cet objet portait atteinte à la liberté de religion des non-chrétiens. La Cour a souligné qu’en imposant des prescriptions de la foi chrétienne, cette loi créait un climat hostile aux Canadiens non chrétiens et paraissait en outre discriminatoire à leur égard. La Cour a également conclu que le pouvoir d'imposer l'observance universelle du jour de repos préféré par une religion ne concordait guère avec le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. L’atteinte à l’alinéa 2 (a) de la Charte n’était pas justifiée en vertu de l’article 1.
Peu après la décision rendue dans l’affaire Big M Drug Mart, la Cour a considéré la loi ontarienne intitulée Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail. Cette loi empêchait aussi les commerces d’ouvrir le dimanche, mais l’historique législatif de cette loi révélait que l’objet n’était pas de nature religieuse, mais visait plutôt à fournir un jour de congé commun aux travailleurs du commerce de détail. Néanmoins, dans R. c. Edwards Books and Art[80], la Cour suprême a conclu que cette loi portait atteinte à la liberté de religion parce que même si elle poursuivait un objectif séculier, elle avait pour effet d’imposer un fardeau économique aux détaillants qui observaient un jour de repos autre que le dimanche. Cependant, alors que la Loi sur le dimanche ne pouvait pas être justifiée en vertu de l’art. 1 de la Charte, dans la décision Edward’s Books, la loi a été préservée en vertu de l’art. 1 de la Charte puisque le but séculier d’assurer un jour de repos commun était assez important pour justifier une limite à la liberté de religion.
La récitation du Notre père dans les écoles et dans les assemblées publiques est une autre situation considérée comme portant atteinte à la liberté de religion des non‑chrétiens. La Cour d’appel de l’Ontario[81] a examiné un règlement obligeant les écoles publiques à commencer et à terminer chaque jour par des exercices religieux comprenant la lecture des Saintes écritures ou la récitation du Notre père ou de toute autre prière appropriée. Le règlement permettait aux élèves de ne pas y prendre part. Même si le règlement prévoyait la possibilité d’exempter des élèves et était assez souple pour permettre des prières non chrétiennes, le règlement était inconstitutionnel. Une fois encore, le problème résidait dans l’élément de coercition et dans la pression exercée sur les élèves de se conformer aux pratiques religieuses de la majorité. La Cour a soutenu que l’existence de la pression ou de la contrainte devait être évaluée du « point de vue des élèves dans le contexte névralgique d’une école publique » et que « les pressions par les pairs et les normes de la classe auxquelles les enfants sont extrêmement sensibles … sont réelles et omniprésentes, et elles ont pour effet de contraindre les membres de minorités religieuses à se conformer aux pratiques religieuses de la majorité[82] ».
Dans Freitag v. Penetanguishene, la Cour d’appel de l’Ontario a jugé que le fait de commencer les réunions municipales par le Notre père avait pour objet d’imposer « un ton de moralité chrétienne aux délibérations du Conseil » et portait atteinte aux droits des non‑chrétiens. Ultérieurement, l’utilisation d’une prière non-confessionnelle par le conseil du comté de Renfrew a été contestée par un résident du comté qui s’identifiait comme « humaniste séculier » et qui ne croyait pas en Dieu et s’opposait à la participation aux prières. Dans Allen v. Renfrew (Corp. of the County)[83], la Cour supérieure de l’Ontario a conclu qu’une prière qui est largement œcuménique et qui n’est pas liée à une confession particulière, même si elle fait référence à Dieu, ne constituait pas une atteinte aux droits de religion malgré le fait qu’elle puisse être incompatible avec les croyances de certains « groupes minoritaires ». La Cour a rejeté l’argument selon lequel le seul fait de mentionner Dieu dans une prière dans le cadre d’une réunion gouvernementale pourrait être perçu comme une tentative coercitive d’imposer une observance religieuse. Elle a également laissé entendre (au par. 27) que toute entrave aux croyances de M. Allen était un « affront mineur » qui n’était pas assez grave pour constituer une atteinte à la liberté de religion.
La prière dans sa forme actuelle n’est pas, de par son essence, une observance religieuse, contraignante ou autre, et elle n’impose aucune obligation au requérant ni aucune limite à l’exercice de ses propres croyances. Au contraire de l’affaire Freitag, le fait de réciter cette prière n’oblige pas le requérant à participer à une forme de culte chrétien ou d’une autre confession. De l’avis de ce tribunal, la seule mention de Dieu dans la prière n’entraîne pas pour le requérant des conséquences assez graves qui pourraient entraver de façon importante ses croyances religieuses. [notre traduction]
Très récemment, la Cour suprême du Canada a souligné qu’on constatait dans le monde occidental un vaste mouvement de laïcisation des institutions publiques et l’adoption d’une politique de « neutralité religieuse » de l’État. Comme le faisait remarquer la Cour, la neutralité religieuse de l’État est considérée comme un moyen de créer un espace de liberté dans lequel les citoyens de diverses croyances peuvent exercer leurs droits individuels. L’arrêt pris dans l’affaire S.L. c. Commission scolaire des Chênes portait sur une contestation par un groupe de parents de Drummondville, Québec, qui s’opposait à ce qu’on enseigne un programme obligatoire intitulé Éthique et culture religieuse (ÉCR) à tous les élèves de la province. En 2008, le gouvernement du Québec a commencé à exiger que tous les élèves, que ce soit dans une école privée, publique ou affiliée à une religion, suivent chaque année un cours d’éthique et de culture religieuse. Les objectifs déclarés du cours sont d’instruire les enfants « en favorisant chez eux le développement d’attitudes de tolérance, de respect et d’ouverture [de sorte qu’] on les prépare à vivre dans une société pluraliste et démocratique ». Le programme d’enseignement porte sur toutes les grandes religions du monde ainsi que sur la spiritualité autochtone, tout en reflétant les racines et la population chrétiennes du Québec[84]. Les appelants ont soutenu que l’État ne devrait pas avoir le pouvoir d’imposer, sans exemption possible, un programme d’études de l’éthique et de la religion aux parents qui le considèrent comme une atteinte à leurs croyances religieuses et à leur conscience. La Cour supérieure du Québec[85] a conclu que même si les appelants et leurs enfants étaient des croyants sincères adhérant à foi catholique, le programme ÉCR ne portait pas atteinte à leur liberté de religion et de conscience. Elle a aussi conclu que les parents n’avaient pas pu convaincre le tribunal que leurs enfants allaient subir des préjudices de l’obligation de suivre ce programme, et que par conséquent ils ne seraient pas admissibles à une exemption. La Cour d’appel du Québec a refusé l’appel.
La Cour suprême a également rejeté la contestation présentée par les parents en vertu de la Charte. La Cour a jugé qu’une personne ne pouvait pas simplement dire que ses droits aux termes de l’alinéa 2 (a) de la Charte étaient enfreints, mais qu’il lui fallait démontrer par des preuves objectives qu’il y avait atteinte à un droit religieux. De plus, l’alinéa 2 (a) n’exige pas que les autorités législatives s’abstiennent d’imposer le moindre fardeau relativement à la pratique d’une religion, puisque aucun droit n’est absolu.
Dans cette affaire, bien que les parents croient sincèrement qu’ils sont tenus de transmettre les préceptes de leur religion à leurs enfants, ils n’ont pas démontré de manière objective que leur capacité de le faire avait été entravée. Bien que le gouvernement ne puisse établir un système d’éducation qui favorise ou défavorise une seule religion ou une vision particulière de la religion, il peut exposer les enfants à une présentation exhaustive des diverses religions sans les forcer à y adhérer.
Quant à l’argument selon lequel le fait d’exposer les enfants à diverses croyances peut créer de la confusion chez ces derniers, le tribunal a réaffirmé ses propos concernant la dissonance cognitive tenus dans l’affaire Chamberlain c. Surrey School District No. 36[86]. En particulier, même si les parents sont libres de transmettre leurs croyances personnelles à leurs enfants, l’exposition des enfants dès le plus jeune âge aux différentes réalités est un fait de la vie en société; on pourrait même dire qu’elle est nécessaire si l’on veut enseigner aux enfants ce que la tolérance signifie vraiment. En outre :
suggérer que le fait même d’exposer des enfants à différents faits religieux porte atteinte à la liberté de religion de ceux-ci ou de leurs parents revient à rejeter la réalité multiculturelle de la société canadienne et méconnaître les obligations de l’État québécois en matière d’éducation publique. Bien qu’une telle exposition puisse être source de frictions, elle ne constitue pas en soi une atteinte à l’al. 2a) de la Charte canadienne et à l’art. 3 de la Charte québécoise.
Cette affaire pourrait s’avérer importante pour bien des raisons[87]. Premièrement, elle clarifie qu’il faut une preuve objective d’une entrave aux droits religieux selon la prépondérance des probabilités; le seul fait d’affirmer un effet négatif sur un droit ne suffit pas. Elle réaffirme des décisions antérieures dans lesquelles on avait conclu que le fait d’être exposé à des opinions qui diffèrent de ses propres croyances religieuses ne constitue probablement pas une atteinte à ses droits religieux[88]. Elle semble également exprimer le point de vue de la Cour sur le rôle de l’État et des institutions publiques à l’égard de la religion.
Dans le contexte des droits de la personne, plusieurs décisions portent sur une situation dans laquelle un employeur ou un chef de service impose des messages religieux à des employés. Ces décisions semblent indiquer que le fait de discuter de questions religieuses en milieu de travail est acceptable dans une certaine mesure[89]. Toutefois, lorsqu’un employeur exerce des pressions religieuses importunes sur des employés, qu’il leur impose un traitement défavorable pour des raisons religieuses ou qu’il fait de la participation à des activités religieuses une modalité ou une condition d’emploi, les tribunaux concluront probablement qu’il y a eu violation du Code[90]. En outre, le fait d’interroger un employé sur des questions religieuses durant une entrevue pour déterminer s’il a les mêmes « valeurs » et s’il « s’inscrit » bien dans la culture de l’entreprise a été jugé contraire au paragraphe 23 (2) du Code qui interdit expressément de soumettre un candidat à une enquête orale ou écrite qui, directement ou indirectement, établit des catégories ou indique des qualités requises fondées sur un motif illicite de discrimination, dans ce cas les croyances religieuses du candidat[91].
Dans l’affaire Akiyama v. Judo B.C. (No. 2)[92], le tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a rejeté l’allégation que l’obligation de s’incliner devant quelqu’un comme condition de participation à des compétitions de judo était une imposition d’une pratique religieuse shintoïste à des personnes qui ne pratiquaient pas cette religion. Les plaignants ne s’identifiaient pas comme des personnes ayant des croyances religieuses. Cependant, ils ont soutenu que l’obligation de faire certains des saluts du judo[93] constituaient une imposition d’une pratique religieuse en raison de leur conviction sincère que cette forme de salut est d’origine shintoïste. Le tribunal a conclu que les plaignants n’avaient pas établi de lien entre les saluts du judo et une pratique shintoïste, autrement que par le fait que les prêtres shintoïstes saluent en s’inclinant (toutefois le tribunal a observé que ce type de salut est courant dans plusieurs cultures asiatiques). Le tribunal a rejeté l’argument selon lequel les plaignants devraient avoir le droit de refuser de s’adonner à une activité qu’ils croient sincèrement de nature religieuse, en affirmant plutôt qu’il leur faut prouver objectivement que l’activité est de nature religieuse :
…La conviction de Mme Akiyama selon laquelle il existe un lien entre les saluts du judo et le shintoïsme n’est pas en soi une croyance religieuse; elle n’a rien à voir avec un système cohérent de croyances en un pouvoir surhumain ou surnaturel, ni avec l’adoration d’un être divin. Son idée qu’il existe un lien entre les saluts du judo et le shintoïsme est plutôt une conviction sur leur lien historique. Par conséquent, il ne convient pas que le tribunal accorde à la conviction historique subjective de la plaignante la même importance qu’une cour accorde aux croyances religieuses d’une personne. … La plaignante ne peut invoquer le motif de la religion que si elle peut prouver, à la prépondérance des probabilités, que les saluts propres au judo sont essentiellement de nature religieuse[94]. [notre traduction]
Cependant, cette décision a été rendue avant Amselem et est fondée sur le motif de « religion » et non sur celui de « croyance ». Il serait certainement possible de soutenir que, selon une interprétation large et libérale, les lois en matière de droits de la personne devraient protéger les gens de traitements défavorables en raison de leur refus de prendre part à une activité qu’ils croient sincèrement être de nature religieuse. Une définition plus large de la croyance pourrait également offrir une protection accrue aux personnes qui ne s’identifient pas comme appartenant à une religion mais qui adhèrent à d’autres croyances.
Dans l’affaire Grant c. Canada (procureur général)[95], la Cour fédérale a rejeté l’affirmation que la décision de la Gendarmerie royale du Canada de permettre à ses agents sikhs de porter le turban portait atteinte aux droits religieux des membres du public qui ne sont pas sikhs. La Cour a souligné qu’il n’y avait pas de contenu religieux nécessaire dans les interactions entre un membre du public et un agent de police, et qu’il n’y a pas d’obligation ou de coercition imposée au membre du public d’adopter ou de partager les croyances ou pratiques religieuses de l’agent ni d’y participer. La seule conséquence de cette décision pour un membre du public, c’est qu’il voit l’affiliation religieuse de l’agent de police, ce qui ne contrevient nullement à l’alinéa 2 (a) de la Charte.
Différends fondés sur la croyance au sein d’une même confession ou communauté
Certaines plaintes relatives à la croyance portent sur des différends qui surviennent entre des membres d’un même groupe confessionnel ou entre des personnes ayant les mêmes antécédents qui s’identifient par des croyances différentes. Cette tendance semble indiquer que la nature des causes relatives à la croyance devient de plus en complexe, et qu’il existe diverses façons de comprendre la notion de croyance à l’intérieur d’un groupe de personnes qui s’identifient de la même manière.
Par exemple, dans MacDonald v. Anishnawbe Health Toronto, Mme MacDonald, qui s’identifie comme une Autochtone catholique, a allégué que lorsque le directeur général de l’organisme[96] a découvert qu’elle était catholique, il s’est mis à éprouver de l’antipathie pour elle et il a pris des mesures pour faire en sorte que son emploi prenne fin. La requérante a appelé à témoigner une ancienne collègue de travail qui avait eu une relation intime avec le directeur général pendant quatre ans, laquelle a témoigné que le directeur général « désapprouvait fortement les Autochtones qui adhéraient au christianisme, ou du moins les sectes chrétiennes qui avaient été impliquées par le passé dans les écoles résidentielles, comme les catholiques et les anglicans » [notre traduction]. La requérante a également allégué que son employeur lui avait demandé pourquoi elle enverrait son fils à une école catholique à la lumière du rôle joué par l’Église catholique dans les écoles résidentielles. En fin de compte, le tribunal n’a pas admis que l’employeur avait une perception négative des autochtones catholiques ou que la religion de la requérante avait été un facteur dans la façon dont elle avait été traitée au travail[97]. Cette affaire est toutefois un exemple intéressant de la complexité et de la nature intersectionnelle possible des différends liés à la croyance. Dans ce cas, la requérante alléguait qu’elle avait fait l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le fait qu’elle était autochtone et catholique.
Dans l’arrêt Bruker c. Marcovitz[98] (que l’on discutera davantage dans la section Conciliation du droit de croyance et d'autres droits), la Cour suprême du Canada a confirmé que le fait qu’un différend opposant deux parties ait des aspects religieux ne signifie pas que les tribunaux ne le considéreront pas. Bien que les tribunaux n’interviennent habituellement pas dans les questions de spiritualité ou de doctrine, ils interviendront dans les cas de violation des droits civils ou de propriété[99]. Ainsi, l’entente que l’époux juif avait auparavant conclu selon lequel il accorderait à son épouse un divorce religieux a été maintenue, même si l’époux soutenait que l’obligation de respecter ce contrat porterait atteinte à ses droits religieux[100]. Les juges Deschamps et Charron ont toutefois inscrit leur dissidence, concluant essentiellement qu’il ne convenait pas que la Cour tranche ce qui était un différend privé de nature religieuse.
En accord avec cette approche, le TDPO a rejeté un argument préliminaire présenté par le Diocèse selon lequel le processus de postulance (deux ans de formation et de préparation à un ministère religieux) pour devenir un prêtre anglican ne constituait pas un service aux termes du Code. Le TDPO a déterminé qu’il n’était pas du tout évident que la période de postulance ne constituait pas un service. Il a conclu qu’il pouvait entendre une requête présentée par un homme d’origine sri lankaise qui prétendait avoir subi de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique[101]. Le TDPO a souligné qu’en Ontario la définition des services au sens du Code ne se limite pas aux avantages généralement offerts au public, et qu’un rapport privé, comme une postulance, pouvait donc être compris dans cette définition[102].
Dans une autre affaire, un homme juif a allégué une discrimination fondée sur la croyance contre un organisme juif parce qu’on lui avait dit qu’il ne pourrait être certifié à titre de traiteur casher parce qu’il n’était pas un juif orthodoxe ou un shomer chabbat; Rill v. Kashruth Council of Canada[103]. L’intimé, the Kashruth Council, est une société qui certifie les produits et établissements qui observent, à son avis, les règles de la casherout (lois alimentaires juives). Le requérant, qui avait déjà été certifié, a tenté de présenter une nouvelle demande de certification pour devenir un traiteur casher en févier 2008 parce qu’il comprenait que la politique du Kashruth Council permettait à des traiteurs non orthodoxes d’obtenir la certification à la condition qu’un mashgiach orthodoxe soit présent en tout temps pour superviser le processus culinaire. Cependant, l’intimé n’a pas permis au requérant de présenter à nouveau sa demande.
Le TDPO a rejeté la requête parce que le requérant n’avait pas réussi à démontrer que le refus de l’intimé avait quoi que ce soit à voir avec la croyance. La politique de l’organisme n’exigeait pas qu’un traiteur soit orthodoxe ou shomer chabbat. En fait, le requérant avait déjà eu la certification même s’il n’était pas orthodoxe. Aucune preuve n’indiquait que la décision était liée à la croyance du requérant.
Dans une décision rendue en C.-B., le tribunal a considéré une allégation faite par une femme hindoue selon laquelle elle était victime de discrimination de la part d’un temple hindou; Krall v. Vedic Hindu Cultural Society[104]. Le tribunal a constaté que les autorités du temple avaient demandé à l’une de leurs membres, Mme Krall, de quitter la salle à une occasion et de prier à l’arrière du temple, parce que lorsqu’elle prie, elle entre en transe, crie, gesticule et saute. Le tribunal a observé que l’arrêt Amselem a confirmé que l’interprétation personnelle qu’une personne a de sa foi est protégée et que les limites imposées à Mme Krall en raison de sa façon de prier constituaient en effet une discrimination fondée sur la religion. Toutefois, le tribunal a étalement conclu que le comportement de Mme Krall perturbait les autres fidèles et effrayait les enfants. Par conséquent, les autorités du temple avaient proposé une adaptation raisonnable en demandant à Mme Krall de prier à l’arrière du temple.
La croyance et le devoir d’adaptation
Le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur la croyance comprend également le droit d’obtenir des mesures d’adaptation pour répondre aux besoins liés à la croyance, jusqu’au point de préjudice injustifié[105]. Dans certains cas, cependant, les mesures d’adaptation liées à la croyance ont prêté à controverse.
Les mesures d’adaptation liées à la croyance prennent diverses formes, il peut s’agir de modifier le code vestimentaire, de modifier les exigences de sécurité (p. ex., permettre à un enfant de porter à l’école un couteau cérémonial dans un fourreau), de fournir du temps et un lieu de prière et de donner des jours de congé pour les fêtes religieuses.
Comme c’est le cas pour les autres formes d’adaptation, l’obligation de prendre des mesures d’adaptation à l’égard du droit de croyance comporte deux aspects portant sur la procédure et sur le fond. Par conséquent, toute personne responsable qui reçoit une demande d’adaptation en rapport avec la croyance est tenue de l’étudier et d’explorer les diverses possibilités de fournir une mesure d’adaptation, faute de quoi elle pourrait être trouvée coupable de discrimination, même si le fait de fournir l’adaptation avait entraîné un préjudice injustifié.
Par exemple, dans l’affaire Qureshi v. G4S Security Services[106], le TDPO a jugé discriminatoire la décision d’un employeur de mettre fin au processus de recrutement d’un candidat dès qu’il a appris que ce dernier aurait besoin d’environ une heure chaque vendredi pour prier. M. Qureshi avait passé avec succès l’évaluation de sélection initiale et révélé qu’il aurait besoin d’une mesure d’adaptation pour pouvoir faire les prières du vendredi. Pendant sa formation, il a demandé à être libéré quelques heures pour la prière du vendredi en offrant de passer plus tard ce soir-là un examen prévu pour le vendredi après-midi. L’employeur lui a refusé ce temps et lui a demandé s’il aurait besoin de ce temps libre tous les vendredis pour la prière s’il était embauché par la société. Lorsqu’il a confirmé qu’il en aurait en effet besoin, l’employeur lui a dit qu’il ne pouvait donner suite à cette demande d’emploi.
En concluant qu’il y avait eu discrimination, le TDPO a confirmé que l’employeur avait l’obligation procédurale de prendre des mesures adéquates pour évaluer et explorer les possibilités d’adaptation. Au lieu de cela, il a immédiatement repoussé la demande sans même examiner s’il était possible de trouver une mesure d’adaptation pour y donner suite. Le défaut de l’employeur de satisfaire au premier aspect de son devoir d’adaptation suffisait à établir qu’il y avait eu discrimination; le tribunal a cependant considéré également l’argument de l’employeur selon lequel la mesure d’adaptation demandée lui causerait un préjudice injustifié. Les affirmations de l’employeur au sujet de la convention collective, des problèmes syndicaux, des difficultés d’établissement de l’horaire et des coûts des heures supplémentaires étaient vagues et hypothétiques, et aucune preuve concrète n’a été apportée.
Enfin, le tribunal a rejeté l’argument de l’employeur selon lequel M. Qureshi était tenu de divulguer ce besoin d’adaptation plus tôt dans le processus de recrutement et qu’il avait agi de manière trompeuse en ne le faisant pas. Le tribunal a fait remarquer que le paragraphe 23 (2) du Code interdit de soumettre un candidat à une enquête qui, directement ou indirectement, établit des catégories fondées sur un motif illicite de discrimination. Par conséquent, il serait contraire à la logique d’exiger que les candidats à un poste révèlent eux-mêmes à leur employeur éventuel des renseignements qui, directement ou indirectement, établissent des catégories fondées sur un motif illicite de discrimination. De plus, rien n’indique que l’employeur aurait agi de manière différente si le requérant avait révélé qu’il avait besoin d’une mesure d’adaptation plus tôt dans le processus de recrutement.
Le tribunal a ordonné à la société de payer à M. Qureshi 2 520 $ en compensation de la perte de salaires et 5 000 $ en indemnisation de l’atteinte portée à sa dignité et à sa fierté suite à la discrimination. Il a également ordonné à la société de modifier sa politique (avec l’aide d’un consultant ou d’un avocat ayant de l’expertise dans les questions relatives aux droits de la personne et à l’obligation d’adaptation) pour répondre aux besoins d’adaptation des personnes relativement aux motifs de discrimination interdits aux termes du Code, décrivant notamment le processus qu’entend suivre la société pour répondre aux demandes d’adaptation, et de diffuser cette politique à tous ses employés de l’Ontario[107].
L’obligation de prendre part au processus lié aux mesures d’adaptation s’applique également aux employés. Les décisionnaires ont conclu que les employés doivent faire connaître leurs besoins d’adaptation dans des délais raisonnables. S’ils ne le font pas, les tribunaux pourraient conclure que l’employeur n’a pas manqué à son devoir d’adaptation. Par exemple, dans l’affaire Daginawala v. SCM Supply Chain Management Inc.[108], le TDPO a conclu que le requérant n’avait pas informé son employeur qu’il avait besoin de quatre heures de congé non payé en lui donnant un préavis suffisant pour lui permettre de trouver quelqu’un pour le remplacer[109].
i. Temps de prière, sabbat et fêtes religieuses
L’une des questions les plus fréquentes que soulève le devoir d’adaptation en matière de croyance est la façon de fournir des adaptations relatives aux temps de prière, au sabbat et aux fêtes religieuses. Il incombe aux employeurs, aux fournisseurs de service, comme les écoles, et à d’autres entités de répondre à ces besoin d’adaptation, jusqu’au point de préjudice injustifié. Le défi a été de déterminer exactement à quels besoins il fallait répondre et ce qui constitue un préjudice injustifié dans les circonstances.
L’une des premières décisions en matière de droits de la personne portant sur les adaptations relatives aux congés pour les fêtes religieuses est l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire O’Malley. Les employés à temps plein était tenus de travailler le vendredi soir et le samedi à tour de rôle. Après être devenue adventiste du septième jour, Mme O’Malley ne pouvait plus travailler durant son sabbat (du soleil couchant le vendredi au soleil couchant le samedi). Elle a donc été forcée d’accepter un poste à temps partiel, ce qui entraînait une réduction de son salaire et de ses avantages sociaux. Concluant que l’intimé n’avait pas démontré qu’il aurait pu faire davantage pour offrir une mesure d’adaptation répondant mieux aux besoins de Mme O’Malley, la Cour suprême du Canada a souligné plusieurs grands principes en matière de droits de la personne qui s’appliquent sans égard au type de discrimination allégué. Premièrement, il n’est pas nécessaire de prouver que la discrimination était intentionnelle. Deuxièmement, la discrimination peut découler de règles et d’exigences neutres qui ont quand même un effet défavorable sur un groupe visé par un motif illicite énoncé dans le Code. Dans le cas de la discrimination indirecte, l’employeur a l’obligation de fournir une mesure d’adaptation, jusqu’au point de préjudice injustifié. La Cour a également observé qu’il incombe au requérant d’établir d’abord la preuve prima facie de la discrimination alléguée. Une fois que le requérant l’a fait, le fardeau de la preuve passe à l’intimé qui doit démontrer qu’il a pris les mesures d’adaptation nécessaires, jusqu’au point de préjudice injustifié[110].
Dans l’affaire Renaud, la Cour suprême du Canada a confirmé que lorsqu’une convention collective avait un effet défavorable sur des employés en raison de leur croyance, le syndicat avait une responsabilité conjointe et partagée, de concert avec l’employeur, de chercher et de fournir des mesures d’adaptation, jusqu’au point de préjudice injustifié. M. Renaud, un concierge d’école, était également un adventiste du septième jour et ne pouvait donc pas travailler le vendredi après-midi. Pour changer son horaire de travail, il aurait fallu prévoir une exception dans la convention collective, ce que le syndicat a refusé. Comme le syndicat menaçait de déposer un grief, l’employeur n’a pas fourni à M. Renaud l’adaptation demandée et ce dernier a été licencié lorsqu’il a refusé de travailler son quart de travail régulier du vendredi soir. La Cour a confirmé que les syndicats pouvaient être déclarés responsables d’un acte de discrimination dans deux situations. Premièrement, le syndicat peut causer la discrimination ou y contribuer en participant à l’élaboration de règles de travail qui ont un effet discriminatoire. Deuxièmement, un syndicat peut être jugé responsable s’il bloque les efforts raisonnables déployés par un employeur pour fournir une mesure d’adaptation. Dans cette affaire, la mesure d’adaptation proposée était raisonnable et ne constituait pas une atteinte injustifiée aux droits des collègues de travail de M. Renaud. L’employeur et le syndicat ont tout deux été jugés responsables du défaut de fournir à M. Renaud une mesure d’adaptation lui permettant de respecter le sabbat.
En revanche, en 2002 la Cour divisionnaire de l’Ontario a confirmé la décision d’une commission d’enquête en matière de droits de la personne qui avait conclu que Ford Motor Co. of Canada n’avait pas agi de manière discriminatoire à l’endroit de deux membres de l’Église universelle de Dieu en n’acceptant pas de les rayer en permanence du quart de travail du vendredi soir pour leur permettre de respecter leur sabbat[111]. L’argument selon lequel Ford aurait subi un préjudice injustifié a été accepté pour un certain nombre de raisons, y compris l’incidence sur l’ordre d’ancienneté, l’atteinte au moral du personnel, l’interchangeabilité de la main-d’œuvre et des installations, le coût et la difficulté de remplacer les requérants, la taille et la compétitivité de l’entreprise et des considérations relatives à la sécurité. La commission d’enquête a observé que l’entreprise affichait un taux élevé d’absentéisme le vendredi soir, ce qui accentuait la difficulté d’excuser les requérants de ce quart de travail. Il est toutefois important de souligner que cette décision a été rendue avant les modifications apportées au Code en Ontario, lesquelles précisent que seuls peuvent être pris en considération les facteurs de coûts, et de santé et sécurité pour déterminer le préjudice injustifié. Il y a donc lieu de se demander quelle aurait été l’issue de l’affaire si le tribunal avait rendu une décision à la lumière de la version modifiée du Code.
Toutefois, si la nécessité de fournir une adaptation relativement aux congés pour le temps de prière, le sabbat et les fêtes religieuses a été confirmée à maintes reprises, il a été plus difficile de déterminer si l’employée ou l’employé avait droit à un congé payé.
Dans l’affaire Chambly (Commission scolaire régionale) c. Bergevin, la Cour suprême du Canada a considéré la demande d’enseignants juifs voulant se prévaloir d’une disposition de la convention collective prévoyant des congés spéciaux payés qui leur aurait donné droit à un congé payé pour Yom Kippur. On leur a dit qu’ils pouvaient prendre le congé sans rémunération. La Cour a observé que les fêtes religieuses chrétiennes de Noël et du Vendredi saint sont prévues au calendrier scolaire. Les employés chrétiens pouvaient donc observer leurs fêtes religieuses avec rémunération. Comme cela n’était pas le cas pour les enseignants juifs, à moins d’une mesure d’adaptation offerte par l’employeur, l’effet serait discriminatoire. Dans cette affaire, il n’était pas possible d’offrir une adaptation en modifiant l’horaire de travail puisque les enseignants ne peuvent travailler que lorsque les écoles sont ouvertes et les élèves en classe. Par conséquent, l’employeur était tenu de permettre le recours aux congés payés.
À la suite de cet arrêt, les décisionnaires n’ont pas nécessairement accepté que l’arrêt Chambly oblige tous les employeurs à fournir le même nombre de congés payés pour des fêtes religieuses que ce que reçoivent les employés chrétiens. Dans l’affaire Ontario (Ministry of Community and Social Services) v. Grievance Settlement Board[112], la Cour d’appel de l’Ontario a considéré le grief d’un membre de l’Église universelle de Dieu qui demandait onze jours de congés payés par année pour des fêtes religieuses. La politique de l’employeur permettait deux jours de congés payés et permettait ensuite aux employés d’honorer le reste de leurs obligations religieuses en modifiant leur horaire de travail. L’employeur a offert à l’employé diverses propositions pour répondre à ses besoins en matière d’observance religieuse, mais il les a refusées en soutenant qu’il avait droit à des congés payés.
La Cour d’appel a conclu que la politique de l’employeur respectait bien l’obligation d’adaptation incombant à un employeur. Les options de réaménagement de l’horaire prévues dans la politique constituaient « une mesure d’adaptation viable pour les employés qui avaient besoin de congés supplémentaires au-delà des deux jours déjà prévus. Elles leur permettaient d’aménager leurs heures de travail de manière à leur éviter d’avoir à choisir entre la perte de salaire ou l’utilisation d’avantages déjà gagnés [soit les jours de vacances accumulés], d’une part, et l’observance de leurs fêtes religieuses, d’autre part » [notre traduction]. La Cour a souligné que dans l’affaire Chambly la Cour suprême avait trouvé important le fait qu’il était impossible pour un enseignant de reprendre un congé pris pour une fête religieuse en travaillant un autre jour. Par conséquent, la Cour a conclu que les employeurs peuvent satisfaire à leur obligation d’adaptation en offrant un réaménagement approprié de l’horaire de travail, sans devoir au préalable prouver que le fait d’accorder un congé payé entraînerait un préjudice injustifié de nature économique ou autre.
Dans l’affaire Markovic v. Autocom Manufacturing Ltd.[113], le TDPO a considéré une situation dans laquelle un employeur n’a pas offert deux jours de congés payés correspondant au nombre de congés prévus pour les fêtes religieuses chrétiennes qui sont des jours fériés. La politique de l’employeur offrait plutôt une gamme d’options d’adaptation, comprenant la possibilité de reprendre le temps, de changer de quart avec un autre employé, de travailler un jour férié laïque lorsque l’entreprise est ouverte (sous réserve de la Loi sur les normes de travail), de réaménager l’horaire des quarts, d’utiliser des jours de vacances et de prendre un congé sans solde. Selon M. Markovic le refus d’Autocom de lui accorder un congé payé pour célébrer la fête de Noël selon le rite de l’Église orthodoxe serbe était discriminatoire.
Le TDPO a conclu qu’en offrant un processus permettant aux employés de prendre des dispositions pour avoir congé afin d’observer des fêtes religieuses au moyen d’options d’aménagement de leur horaire, sans perte de salaire, l’employeur avait établi une politique appropriée et non discriminatoire. Le TDPO a fait la distinction avec l’arrêt pris par la Cour suprême dans l’affaire Chambly en indiquant que la modification de l’horaire n’était pas possible dans cette situation en raison de la nature du milieu de travail et que, même si la convention collective permettait trois jours de congés spéciaux payés, l’employeur avait pris pour position qu’ils ne pouvaient pas être utilisés à des fins d’observance religieuse. Cependant, le TDPO a observé qu’il pourrait y avoir des personnes pour lesquelles aucune des options d’aménagement de l’horaire ne pourrait convenir et que, en pareille situation, il faudrait explorer d’autres mesures d’adaptation. Le TDPO a donc laissé ouverte la possibilité que, dans certaines circonstances, l’adaptation puisse être un congé payé.
Dans l’affaire Koroll v. Automodular Corp.[114], le requérant, un membre de l’Église du Dieu vivant, a allégué que son employeur avait porté atteinte à ses droits en ne lui donnant pas un congé payé pour observer les grands jours de sabbat (High Sabbaths). Il a aussi allégué que le programme de reconnaissance de l’assiduité établi par l’employeur était discriminatoire à son endroit puisque les employés ayant une parfaite assiduité recevaient une prime, mais qu’il ne pouvait y avoir droit même si son assiduité était parfaite sauf pour les jours de sabbat où il ne pouvait travailler en raison de ses croyances religieuses.
Le TDPO a adopté la même position que dans l’affaire Markovic et a rejeté la prétention du requérant selon laquelle il avait droit à des congés payés pour les fêtes religieuses. Cependant, le tribunal a conclu que le fait que l’employeur exige qu’il soit présent tous les jours de travail prévus pour avoir une parfaite assiduité et recevoir une prime constituait une discrimination fondée sur la croyance. L’intimé n’a pas démontré qu’il ne pouvait fournir une mesure d’adaptation à l’égard des besoins religieux de l’employé sans subir de préjudice injustifié. Le TDPO a accordé 2 000 $ en dommages-intérêts pour atteinte à la dignité et à la fierté et a ordonné à l’intimé de réviser son programme de reconnaissance de l’assiduité pour enlever l’effet discriminatoire qu’il a sur les employés qui ont des croyances religieuses exigeant qu’ils s’absentent du travail.
Un arbitre en matière de travail a considéré la mise en œuvre par un employeur de dispositions portant sur les « congés confessionnels » dans une convention collective. Aux termes de la convention, les trois premiers jours de fêtes religieuses donnaient droit à un congé payé. Deux autres jours pouvaient être pris, mais ces absences étaient enlevées de la banque de congés de maladie de l’employé. S’inquiétant de la possibilité d’abus, l’employeur avait mis sur pied un système centralisé exigeant que l’employé soumette une demande par voie électronique. Si la fête ne figurait pas sur une liste pré-approuvée de fêtes confessionnelles « importantes », l’employé devait fournir des renseignements supplémentaires confirmant que ce jour était une fête confessionnelle d’importance et que sa religion exigeait qu’il s’abstienne de travailler ce jour-là. L’arbitre a jugé qu’un processus électronique centralisé contenant une liste pré‑approuvée de fêtes confessionnelles importantes pour traiter de telles demandes était un moyen acceptable et efficient de mettre en œuvre la disposition de la convention collective donnant droit à des congés à des fins religieuses. Cependant, le critère voulant que cette fête soit importante pour la confession particulière et exige que la personne s’abstienne de travailler n’était pas conforme à l’arrêt Amselem qui reconnaissait que tant les aspects volontaires qu’obligatoires de la pratique religieuse sont protégés. Cependant, l’employeur pouvait demander des renseignements supplémentaires pour s’assurer que la demande était conforme aux critères établis dans Amselem et dans la convention collective, par exemple, pour vérifier que la fête est bien de nature religieuse, et non de nature culturelle ou profane[115].
Par conséquent, il semble que les employeurs ontariens peuvent honorer leur obligation d’adaptation relative aux fêtes religieuses en cherchant des solutions qui permettent à l’employé de prendre un congé sans subir de conséquences défavorables sur le plan de l’emploi, y compris une perte de salaire. Selon les circonstances, de telles adaptations pourraient prendre diverses formes, notamment les congés payés spéciaux ou pour raisons familiales; le réaménagement de l’horaire de travail; des heures supplémentaires; l’utilisation des congés compensatoires; enfin, si l’entreprise fonctionne les jours fériés, le travail les jours fériés (sous réserve des exigences de la Loi sur les normes d’emploi). Toutefois, forcer un employé à utiliser ses jours de vacances au lieu d’explorer d’autres options serait probablement considéré comme discriminatoire[116]. Il est toujours préférable d’offrir plusieurs solutions au choix, au moyen d’une gamme d’options. De plus, lorsque la nature du milieu de travail ou les circonstances particulières de l’employé sont telles que ce dernier ne peut pas reprendre le temps pour lequel il doit s’absenter du travail pour des fêtes religieuses, comme c’était le cas dans l’affaire Chambly, lui accorder des congés payés pourrait bien être la seule mesure d’adaptation appropriée.
Il est important de noter que le devoir d’offrir des mesures d’adaptation en rapport avec le temps de prière, le sabbat et les fêtes religieuses ne s’applique pas seulement à l’emploi mais à tous les autres secteurs d’activités sociales prévus dans le Code. C’est particulièrement important dans le contexte de l’éducation, bien qu’il ne semble pas y avoir jusqu’à présent aucun précédent en jurisprudence portant sur les particularités du devoir d’adaptation à l’égard de l’observance religieuse dans les écoles et les universités. Cependant, la question a été traitée dans le contexte des contrats (aux termes de l’art. 3 du Code). Dans l’affaire Janssen v. Ontario (Milk Marketing Bd.), le requérant a allégué que son droit d’être à l’abri de la discrimination fondée sur la croyance en matière de contrat a été enfreint par la politique de la Commission ontarienne de commercialisation du lait à l’égard des agriculteurs qui, pour des motifs religieux, n’acceptait pas de livrer de lait le dimanche. La Commission de commercialisation a permis aux agriculteurs de ne pas livrer le dimanche et a organisé les livraisons pour le samedi et le lundi moyennant des frais supplémentaires pour les agriculteurs. La Commission d’enquête de l’Ontario (qui a précédé le TDPO) a conclu que cette mesure d’adaptation n’était pas suffisante pour les agriculteurs qui, pour des motifs religieux, n’acceptait pas de livrer de lait le dimanche. La Commission d’enquête a comparé cette mesure à une mesure qui obligerait les personnes en fauteuil roulant à payer pour l’installation d’une rampe d’accès. Le fait de répartir le coût de cette mesure d’adaptation sur l’ensemble des producteurs laitiers, ou pour la Commission de commercialisation du lait de trouver d’autres moyens d’assumer ce coût dans le cadre de son cadre réglementaire, ne constituerait pas un préjudice injustifié.
ii Le port de vêtements et d’accessoires religieux
Lorsque des raisons de santé et de sécurité sont invoquées, par exemple lorsqu’une personne demande à être dispensée du port du casque protecteur ou autorisée à porter un kirpan, les décisions relatives aux vêtements et accessoires religieux n’ont pas été uniformes.
Dans l’affaire Bhinder v. Canadian National Railway[117], la Cour suprême du Canada a soutenu que la règle du Canadien National relative au casque de sécurité était une exigence professionnelle normale (c.-à-d. adoptée de bonne foi). L’employeur n’était pas tenu de faire une exception pour tenir compte des besoins de M. Bhinder, un employé sikh qui porte un turban. Plus tard, la Cour suprême de Canada a déclaré que l’arrêt Bhinder est erroné dans la mesure où la Cour a considéré que l’obligation d’adaptation n’était pas une composante des critères pour définir si l’exigence était une exigence professionnelle normale. Il semble maintenant évident que même si une règle est raisonnable et adoptée de bonne foi, l’employeur a l’obligation de fournir des mesures d’adaptation, jusqu’au point de préjudice injustifié, à ceux pour qui la règle a des effets défavorables. Le préjudice injustifié comprend des considérations liées à la santé et à la sécurité. La question de la relation entre le port du casque de sécurité et la risques pour la sécurité au travail est également examinée dans l’affaire Loomba dont nous avons déjà parlé.
La question de savoir si les droits religieux comprennent le droit d’être dispensé du port du casque protecteur a été examinée dans le contexte des lois de l’Ontario et de la Colombie-Britannique obligeant les motocyclistes à porter le casque protecteur, avec différents résultats. Dans l’affaire Dhillon v. British Columbia (Ministry of Transportation and Highways)[118], le tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a conclu que le port obligatoire du casque protecteur avait un effet défavorable sur les personnes de confession sikhe. Le tribunal a admis que même s’il existe un risque accru de lésions pour les motocyclistes qui ne portent pas le casque, ce risque est assumé par le motocycliste et non par les autres membres du public. Par conséquent, le risque accru découlant d’une mesure d’adaptation qui dispenserait les hommes sikhs de porter le casque n’entraîne pas un préjudice injustifié pour la province. Le tribunal a également jugé que les coûts accrus relatifs au traitement des traumatismes crâniens ne constituaient pas un préjudice injustifié. Le tribunal a déclaré cette exigence discriminatoire et ordonné au ministère des transports d’y mettre fin et d’éviter à l’avenir toute discrimination semblable.
En Ontario, on est arrivé à la conclusion contraire dans le cadre d’une contestation des dispositions du Code de la route obligeant tous les motocyclistes à porter le casque protecteur. Dans l’affaire R. v. Badesha, un homme sikh accusé de conduire une motocyclette sans casque protecteur a soutenu que l’art. 104 du Code de la route de l’Ontario portait atteinte à ses droits religieux et à son droit à l’égalité aux termes de l’alinéa 2 (a) et de l’article 15 de la Charte. Son argument a été rejeté tant en première instance qu’en appel devant la Cour de justice de l’Ontario. Les deux juges ont conclu, quoique pour des motifs différents, que l’Ontario n’était pas tenu de prévoir une mesure d’adaptation pour les motocyclistes sikhs. Au procès, le juge avait admis qu’il y avait eu atteinte aux droits mais que celle-ci était justifiée en raison du risque accru de blessures graves et de mort. En appel, le juge n’était pas d’accord pour dire que les droits de M. Badesha avaient été enfreints (voir une discussion plus approfondie dans une section antérieure intitulée Étendue de la protection relative à la religion et à la croyance).
Dans l’affaire Pannu v. British Columbia (Worker’s Compensation Board), le tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a rejeté la requête de M. Pannu, un homme sikh qui a été retiré de son poste d’opérateur à la caustification[119] dans une usine de pâte à papier parce qu’il ne pouvait porter l’appareil respiratoire autonome (ARA) en cas d’urgence. M. Pannu portait la barbe en signe de sa foi et la pilosité faciale empêchait l’ARA de fermer de manière étanche. M. Pannu était responsable de la zone de caustification dans l’usine, et advenant une fuite de gaz toxique, il était responsable de la fermeture d’urgence de cette zone. M. Pannu a occupé ce poste plusieurs années sans avoir à se raser. Cependant, après une inspection de la commission des accidents de travail qui a déterminé que l’employeur ne respectait pas les règlements de la commission au sujet des ARA, M. Pannu a été relevé de ses fonctions d’opérateur à la caustification. Après quoi il a déposé une plainte contre la commission des accidents de travail et contre son employeur pour atteinte aux droits de la personne.
Les règlements de la commission des accidents de travail exigeaient que toute personne pouvant être exposée à des gaz toxiques portent un ARA. Ces règlements exigeaient également que toute personne ayant à porter un ARA soit rasée de près parce que la pilosité faciale empêche le masque facial de l’ARA de se sceller de manière étanche contre le visage et d’assurer qu’aucun gaz n’y pénètre. Le tribunal a jugé que les exigences de la commission des accidents de travail étaient justifiées. Le fait d’autoriser une exemption pour les personnes qui portent la barbe pour des raisons religieuses constituerait un préjudice injustifié en ce qu’il minerait la raison même d’un tel règlement, qui est de protéger les travailleurs de l’exposition à des gaz toxiques. De plus, cette situation était différente de celle qu’on voyait dans l’affaire Dhillon puisque le risque ne menaçait pas seulement M. Pannu mais aussi les autres travailleurs. S’il était frappé d’incapacité soudaine à cause de l’exposition aux gaz toxiques, ses collègues de travail devaient le secourir, ce qui les mettrait en danger. De plus, il ne pourrait pas exercer ses fonctions et procéder à la fermeture d’urgence de la zone.
L’employeur n’a pas agi de manière discriminatoire en incluant la fermeture d’urgence dans la description de poste de M. Pannu. Il n’était pas non plus tenu de dispenser M. Pannu de cette tâche. Même si une fuite de gaz n’était jamais survenue, le tribunal a jugé que le risque que cela se produise était réel. Dispenser M. Pannu de cette tâche obligerait l’employeur à former d’autres membres du personnel ayant moins d’expérience et de compétence pour exécuter cette procédure durant les quarts de travail de M. Pannu. Le manque d’expérience de ces personnes entraînerait une augmentation des risques et, ce qui importe encore davantage, signifierait que la responsabilité de ce risque passerait à quelqu’un d’autre. Cela constituerait un préjudice injustifié. Par conséquent, l’employeur n’était pas tenu de fournir une mesure d’adaptation à M. Pannu à ce poste en lui enlevant de sa description de poste la responsabilité de la fermeture d’urgence. Il importe de souligner que l’employeur avait activement cherché d’autres fonctions pour M. Pannu. La question en litige était de savoir s’il avait droit à une mesure d’adaptation dans le cadre de son poste d’opérateur en caustification.
Des questions de santé et sécurité ont également été soulevées en réponse à des demandes d’autorisation de porter le kirpan, un petit couteau cérémonial que portent les hommes sikhs, à titre de mesure d’adaptation relative à la religion. Dans une décision rendue en 1991 en Ontario dans l’affaire Peel Board of Education v. Ontario (Human Rights Comm.) and Pandori[120], la Cour divisionnaire a maintenu une décision d’une commission d’enquête en matière de droits de la personne qui avait rejeté la prétention d’un conseil scolaire selon laquelle il ne pouvait permettre le port du kirpan sans subir de préjudice injustifié. Dans un arrêt de 2006 dans l’affaire Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys[121], la Cour suprême du Canada a considéré la même question et a conclu qu’une décision interdisant à un élève de porter son kirpan à l’école, quelles que soient les circonstances, portait atteinte à sa liberté de religion d’une manière qui n’était ni négligeable ni insignifiante puisqu’elle le privait de son droit de fréquenter une école publique. L’atteinte n’a pas été considérée comme justifiée aux termes de l’art. 1 de la Charte puisqu’elle ne représentait pas une limite minime aux droits religieux. Fait intéressant, le tribunal a établi une analogie entre le critère de limite minime aux termes de l’art. 1 de la Charte et une analyse de l’obligation d’adaptation, et a déclaré que la décision d’interdire de façon absolue le port du kirpan ne se situait pas dans une gamme de mesures raisonnables. La commission scolaire pouvait en effet répondre aux besoins religieux de l’élève en lui permettant de porter le kirpan pourvu qu’il respecte certaines conditions pour assurer la sécurité.
En revanche, deux décisions des tribunaux ont conclu que le port du kirpan pouvait être interdit dans les aéroports et dans les palais de justice. Dans l’affaire Nijjar c. Lignes aériennes Canada 3000 Ltée[122], le Tribunal canadien des droits de la personne a rejeté la plainte de M. Nijjar du fait qu’on lui avait refusé le droit de porter son kirpan à bord d’un avion des Lignes aériennes Canada 3000 parce que, notamment, il n’avait pas démontré que porter le kirpan d’une manière conforme aux politiques de Canada 3000 serait contraire à ses croyances religieuses. Il se dégageait du témoignage de M. Nijjar que le port d’un type particulier de kirpan plutôt que d’un autre était affaire de préférence personnelle et non de croyance religieuse. De la même façon, dans l’affaire R. v. Hothi[123], un tribunal du Manitoba a maintenu la décision d’un juge interdisant le port du kirpan dans une salle d’audience. Le juge entendait une cause où le prévenu était accusé de voies de fait.
En considérant ces deux décisions, la Cour suprême dans l’affaire Multani a souligné que ces affaires étaient toujours étroitement liées à leur contexte. Il faut tenir compte de l’environnement dans lequel les règles relatives au kirpan sont appliquées. Un avion ou une salle d’audience est bien différent d’un milieu de travail ou un établissement d’éducation, et les questions de sécurité en jeu sont aussi très différentes.
Bien que les questions de sécurité tendent à être le principal motif invoqué relativement au port de vêtements religieux, deux affaires récentes portaient sur une opposition au port de vêtements religieux pour d’autres raisons. Ces deux affaires portaient sur des femmes musulmanes.
Dans l’affaire Saadi v. Audmax[124], le TDPO a conclu que la remise en question par l’employeur de certains aspects des vêtements et du hijab d’une employée musulmane constituait un acte de discrimination fondée sur la croyance. En particulier, le TDPO a jugé que l’employeur avait pris des mesures disciplinaires inappropriées contre Mme Saadi pour des manquements au code vestimentaire de l’entreprise lorsqu’elle aurait porté « une jupe courte et serrée et des pantalons collants », une chaîne de cheville qui « tintait », des « babouches » et une « casquette ». Le TDPO a conclu que les mesures disciplinaires relatives à la chaîne de cheville et aux babouches n’étaient pas liées à la croyance. Cependant, il a conclu que pour ce qui est de la jupe et des pantalons collants, le code vestimentaire de l’employeur était appliqué de façon arbitraire et assujetti aux opinions et préférences de la chef de service qui imposait sa perception de ce que devait être l’apparence de son personnel. Le tribunal a jugé que cette attitude constituait de la discrimination indirecte fondée sur la croyance contre la requérante, dont la tenue conforme à sa religion était parfois contraire au code vestimentaire de l’employeur. Le TDPO a également jugé que l’employeur dépassait les bornes du Code en dictant le style de hijab qu’il était prêt à accepter, suivant sa préférence personnelle. Le TDPO a affirmé que « le Code garantit non seulement le droit d’une femme de porter un couvre-chef religieux en milieu de travail, mais également son droit de choisir la forme de couvre-chef, sous réserve d’exigences professionnelles adoptées de bonne foi. » [notre traduction]
Cependant, la Cour divisionnaire de l’Ontario qui a procédé à la révision judiciaire de l’affaire a exprimé son désaccord avec la conclusion du TDPO selon laquelle la façon dont l’employeur appliquait le code vestimentaire constituait une discrimination intersectionnelle fondée à la fois sur le sexe et la croyance. La Cour a souligné un certain nombre de problèmes de procédures dans la tenue de l’audience (par exemple, le fait que Mme Saadi n’avait pas fourni de preuves concernant les vêtements qu’elle portait réellement ainsi que le refus de permettre à l’employeur de présenter une photographie illustrant le type de tenue inappropriée que Mme Saadi portait). La Cour divisionnaire a conclu que le TDPO aurait dû considérer s’il aurait été possible pour Mme Saadi de respecter le code vestimentaire sans compromettre ses croyances religieuses :
Rien dans la religion de Mme Saadi l’obligeait à porter la forme particulière de hijab qu’elle portait ce jour-là. S’il lui avait été possible de porter une forme de hijab conforme à la fois à sa religion et au code vestimentaire de l’entreprise (comme elle l’avait fait tous les jours pendant six semaines), il n’y avait pas atteinte à ses droits religieux. Tout ce qui était touché était son sens de l’esthétique, lequel était apparemment contraire à celui de son employeur. [notre traduction]
La Cour divisionnaire a déclaré que le TDPO aurait dû examiner la question de savoir si le code vestimentaire, ou l’application ou l’interprétation qu’en faisait l’employeur, était contraire à ce que l’employée était tenue de porter dans le cadre de sa religion. Par conséquent, la décision du TDPO a été annulée et l’affaire a été renvoyée au TDPO pour être entendue par un autre arbitre.
Dans une autre décision récente portant sur la tenue vestimentaire religieuse des femmes musulmanes, la Cour d’appel de l’Ontario a considéré la question de savoir si une femme musulmane qui porte le niqab (un voile recouvrant tout le visage, sauf les yeux) pour des raisons religieuses devait l’enlever lorsqu’elle témoignait au sujet d’actes allégués d’agression sexuelle subis dans son enfance; R. v. N.S[125]. L’affaire n’est pas survenue à la suite d’une requête pour atteinte aux droits de la personne ou d’une allégation de discrimination fondée sur la croyance aux termes du Code. C’est plutôt au cours de l’enquête préliminaire devant un tribunal de droit pénal que les personnes accusées, l’oncle et le cousin de N.S, ont soutenu que leur droit à un procès équitable serait compromis si le visage entier de leur accusatrice ne pouvait être vu durant sa déposition à l’enquête préliminaire et au procès. La Cour d’appel a établi quelques lignes directrices générales sur la façon de concilier les droits religieux invoqués et les droits des accusés. La Cour d’appel a confirmé la nature subjective des croyances et pratiques religieuses et a admis que l’on pourrait déterminer les droits religieux de N.S. en demandant à N.S. de fournir une preuve, par son propre témoignage, concernant la nature de ses croyances et de répondre à des questions pour savoir si ces croyances sont conformes aux pratiques actuelles. La Cour a également souligné que la « perfection passée n’est pas une condition préalable à l’exercice du droit constitutionnel à la liberté de religion »[126]. La Cour n’a toutefois pas tiré de conclusion sur le fait de savoir si N.S. devrait être tenue d’enlever son niqab durant sa déposition au cours du procès pénal, préférant plutôt laisser la décision au juge qui entendra l’affaire. N.S. a interjeté appel de cette décision à la Cour suprême du Canada, soutenant que la Cour d’appel aurait dû confirmer son droit de porter son couvre-chef religieux parce que cela n’entrave aucunement le droit des accusés à un procès équitable. La Cour suprême a entendu l’appel le 8 décembre 2011 et on attend son arrêt. Cette affaire est discutée de façon plus approfondie dans la section Conciliation du droit de croyance et d’autres droits.
Enfin, un cadet de la GRC a été autorisé à porter un pendentif religieux malgré une règle générale interdisant les bijoux durant l’entraînement physique. Toutefois, l’instructeur a annoncé l’exemption à toute la classe de sorte que le cadet a été interrogé sur sa religion par les membres de sa troupe. Le tribunal a conclu qu’en attirant ainsi l’attention sur lui, on a suscité chez le cadet le sentiment d’être étiqueté comme étant « différent » des autres, ce qui constitue un traitement défavorable fondé sur la religion[127].
iii Photos et biométrie
Les croyances religieuses qui ne permettent pas de se faire photographier ont présenté des défis dans un contexte social où des photos sont partout exigées. La Cour suprême du Canada a récemment traité d’une telle situation dans le contexte d’une plainte pour atteinte à la liberté de religion présentée par la Hutterian Brethren of Wilson Colony.
Avant 2003, l’Alberta avait adoptés des mesures d’adaptation qui consistait à délivrer aux personnes qui refusaient de se faire photographier pour des raisons religieuses un permis assorti de la condition G. Les membres des colonies huttérites, qui croient que le deuxième commandement leur interdit de se faire photographier volontairement, pouvaient obtenir ces permis et étaient donc autorisés à conduire. Cependant en 2003, la province a adopté de nouveaux règlements qui obligeaient tous les détenteurs d’un permis à se faire photographier, sans exception. Les photos seraient versées dans une banque provinciale de données de reconnaissance faciale dans le but de réduire le risque que les permis de conduire soient utilisés dans le vol d’identité, un problème croissant.
La Cour suprême a reconnu que l’obligation universelle de se faire photographier constituait une atteinte à la liberté de religion[128]. Cependant, la majorité des juges a conclu que cette exigence était justifiée aux termes de l’art. 1 de la Charte. Premièrement, l’objectif d’établir un système qui réduit le vol d’identité lié aux permis de conduire est un objectif important et pressant. Deuxièmement, la majorité a jugé que l’obligation universelle de se faire photographier était logiquement reliée à l’objectif du gouvernement et qu’elle limitait de manière minime le droit reconnu par la Charte. Sans les photos de tous les titulaires d’un permis de conduire dans la banque de données, le risque de fraude serait plus grand, ce qui compromettrait considérablement l’objectif du gouvernement. Troisièmement, l’effet négatif sur la liberté de religion pour les membres de la colonie qui veulent détenir un permis de conduire ne l’emporte pas sur les avantages découlant de l’exigence relative à la photo : « Le dossier dont nous disposons ne nous permet pas de conclure que les membres de la colonie ont été privés de la possibilité de faire un véritable choix entre observer ou non les préceptes de leur religion. La mesure législative ne les contraint pas à se faire photographier. Elle prévoit simplement qu’une personne qui désire obtenir un permis de conduire doit se laisser photographier pour alimenter la banque de données servant à la photo‑identification. Pouvoir conduire une automobile sur les voies publiques ne constitue pas un droit, mais un privilège. » Même si les membres de la colonie devront prendre d’autres moyens de transport routier et que cela pourra entraîner des coûts et une perte d’autonomie, on ne peut dire que leur droit d’observer leur religion est gravement atteint.
L’arrêt adopté à la majorité a rejeté la contestation fondée sur l’art. 15 en affirmant que, même si l’on pouvait démontrer que le règlement établit une distinction fondée sur le motif énuméré de la religion, « celle‑ci découle non pas d’un stéréotype méprisant, mais d’un choix politique neutre et justifiable sur le plan rationnel ».
Au contraire de l’arrêt relatif à la colonie huttérite, dans l’affaire 407 ETR Concession[129], un arbitre en matière de travail a conclu que le refus des employés pentecôtistes de se prêter au balayage biométrique de la main dans le cadre des mesures de sécurité de l’entreprise aurait pu faire l’objet d’une mesure d’adaptation sans préjudice injustifié. La compagnie a manqué à son devoir d’adaptation sur le plan de la procédure car elle n’a pas fait d’efforts suffisants pour explorer ce qu’elle pourrait faire pour répondre aux besoins des auteurs du grief. Pour ce qui est de son obligation sur le fond, l’arbitre a rejeté l’argument de la compagnie selon lequel il lui faudrait complètement abandonner le balayage biométrique si les auteurs du grief en étaient dispensés pour des motifs religieux :
La compagnie craint que, si certains sont dispensés du balayage obligatoire, l’intégrité des données qu’elle souhaite recueillir sera compromise de sorte qu’il ne sera plus rentable d’investir dans un système qui ne fonctionne que partiellement. Cette préoccupation dépend du nombre de personnes qui doivent obtenir une mesure d’adaptation à l’extérieur du système. À mon avis, faire une exception pour les trois auteurs du grief en dehors du système, alors que les autres employés y participent, n’aura pas une incidence importante sur le nouveau système. Je reconnais cependant que si la compagnie devait prendre des mesures d’adaptation pour un plus grand nombre d’employés qui s’y opposeraient pour des motifs religieux, la viabilité du système de balayage biométrique pourrait être menacée. Cependant, il serait purement hypothétique et hors de mon ressort en l’espèce de hasarder des chiffres, puisque les parties ne savent pas combien d’employés s’opposeront au balayage biométrique, combien d’entre eux sont sincères dans leurs croyances, combien d’entre eux pourraient accepter une mesure d’adaptation à l’intérieur du système (p. ex., en utilisant la main gauche, en portant un gant, ou une carte intelligente) et combien pourraient bénéficier d’une mesure d’adaptation à l’extérieur du système[130]. [notre traduction]
Cela montre bien que chaque affaire de cette nature se décide sur les faits qui lui sont propres. La mesure dans laquelle les dispenses accordées pour des motifs religieux menacent l’intégrité d’un système qui utilise des techniques photographiques ou biométriques pour identifier des personnes déterminera s’il y a lieu d’accorder de telles dispenses.
iv. Autres formes d’adaptation
Un employeur a été déclaré en contravention du code des droits de la personne de Terre‑Neuve lorsqu’il a suspendu un employé qui a refusé des vendre des billets pour une activité sociale à laquelle serait vendu de l’alcool, pour des motifs religieux; Warford v. Carbonear General Hospital[131]. M. Warford était un membre actif de l’Église pentecôtiste et a affirmé qu’un précepte de la foi pentecôtiste veut que ses membres s’abstiennent de consommer de l’alcool et ne doivent d’aucune façon en encourager l’utilisation. Lorsque l’employeur a pris connaissance de ses objections religieuses, plutôt que de suspendre l’employé, il aurait dû fournir une mesure d’adaptation en demandant à quelqu’un d’autre de vendre les billets.
De la même façon, dans l’affaire Jones v. C.H.E. Pharmacy Inc.[132], un employé qui est témoin de Jéhovah a affirmé que mettre des décorations de Noël était contraire à sa foi. Sachant cela, l’employeur lui a demandé d’installer un étalage de poinsettias dans le magasin. Lorsqu’il a refusé, l’employeur lui a dit que s’il voulait garder son emploi, il lui fallait obéir. Il n’y avait aucune preuve indiquant que l’employeur ne pouvait pas prendre une mesure d’adaptation pouvant répondre aux besoins de l’employé; en fait, il l’avait fait par le passé. Cependant, plutôt que d’adopter une solution tenant compte des croyances religieuses de l’employé, l’employeur l’a effectivement forcé à choisir entre sa foi et son emploi, ce qui est discriminatoire. Le tribunal a ordonné à l’intimé de payer à l’employé des dommages-intérêts pour la perte de salaires et d’avantages sociaux ainsi que pour l’atteinte à sa dignité et à sa fierté.
Un conseil d’arbitrage en matière de travail a examiné le grief déposé par une infirmière de l’Ontario qui, après être devenue témoin de Jéhovah, ne pouvait plus exécuter certaines étapes d’une transfusion sanguine et qui, pour cette raison, avait été congédiée par son employeur[133]. L’infirmière travaillait au service des soins aigus au Peterborough Civic Hospital et, après un programme intensif d’étude de la Bible, elle avait conclu qu’elle ne pouvait plus « suspendre le sang » pour les transfusions sanguines[134]. Elle a pris ses propres arrangements avec d’autres infirmières qui l’aidaient à exécuter cette étape du processus de transfusion sanguine et n’en a averti son employeur que lorsqu’elle a eu du mal à trouver des infirmières pour l’aider à cet égard. Après avoir appris qu’elle ne suspendrait pas le sac de sang, l’employeur l’a congédiée, soutenant que c’était là une fonction essentielle des tâches d’une infirmière.
La majorité du conseil a conclu que l’employeur aurait dû trouver une mesure d’adaptation, plutôt que de congédier l’infirmière. Il n’était pas nécessaire que chaque infirmière de l’hôpital puisse suspendre le sang (en fait environ 15 pour 100 ne sont pas qualifiées pour le faire). Comme les règles exigeaient qu’il y ait toujours deux infirmières présentes auprès d’un patient qui nécessitait une transfusion (en raison de la norme très stricte voulant que deux personnes vérifient l’unité de sang contre divers registres), il y avait toujours une autre personne qui pouvait suspendre le sang. Cependant, le conseil a également reconnu que l’employeur n’était pas tenu de permettre à l’infirmière de conserver son poste au service des soins aigus (ou de travailler à l’urgence) puisque, pour assurer le bon fonctionnement de ces services, il est raisonnable d’exiger que tout le personnel infirmier y travaillant soit en mesure de suspendre le sang. Toutefois, on aurait dû offrir à l’infirmière un poste dans un autre service de l’hôpital[135].
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une affaire portant sur l’ampleur du devoir d’adaptation à l’égard des oppositions religieuses d’un employé à l’avortement, dans l’affaire C. v. A.[136] (dont nous avons déjà parlé), le tribunal a reconnu qu’une clinique de médecine familiale avait tenu compte des croyances pro-vie d’une employée chrétienne en n’exigeant pas qu’elle renvoit des patientes à des services d’avortement. Ces renvois étaient effectués par d’autres employés de la clinique sans compromettre les soins aux patientes.
Un employeur n’était pas tenu de prendre des mesures pour tenir compte de la croyance sincère d’un employé qu’il devrait « prêcher, enseigner, baptiser et rallier des disciples » dans son lieu de travail. Dans l’affaire Friesen v. Fisher Bay Seafood[137], un employé, qui était superviseur, a éventuellement été congédié parce qu’il ne cessait de prêcher ses collègues sur les lieux de travail. L’employeur avait reçu de multiples plaintes des collègues de cet employé et avait dû assigner des employés à d’autres quarts de travail pour leur éviter de travailler avec M. Friesen. Le congédiement était discriminatoire à première vue parce que les intimés ont admis que la seule raison pour laquelle M. Friesen avait perdu son emploi était qu’il refusait d’arrêter de prêcher au travail. Néanmoins, le tribunal a conclu que l’exigence qu’il s’abstienne de prêcher était de bonne foi. Les autres employés avaient le droit de travailler dans un milieu où ils n’étaient pas sujets aux prêches religieux de leur supérieur. L’employeur avait pris toutes les mesures possibles pour respecter les doits de M. Friesen, notamment en lui expliquant qu’il devait respecter les droits des autres et en lui permettant de prêcher pendant son heure de déjeuner si ses collègues de travail étaient d’accord. Lorsqu’il a constaté que M. Friesen n’arrêtait pas de prêcher, l’employeur avait atteint le point de préjudice injustifié, et avait une juste raison de le congédier.
Conciliation du droit de croyance et d'autres droits
De nombreux arrêts et décisions ont traité des droits liés à la croyance d’une personne ou d’un groupe qui entraient en contradiction avec d’autres droits de la personne ou droits fondamentaux reconnus dans la Charte, y compris le droit à une réponse et une défense entières dans un procès de doit pénal ainsi que les droits à l’égalité, y compris le droit d’être à l’abri de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, la race et le sexe. Les droits religieux ont également été considérés en rapport avec les droits des enfants, dans des situations particulières où des parents avaient refusé des transfusions sanguines qui pouvaient leur sauver la vie, en raison de leurs croyances religieuses.
Lorsqu’elle a abordé des causes portant sur des droits contradictoires, la Cour suprême du Canada a confirmé qu’il n’y avait pas de hiérarchie dans les droits énoncés dans la Charte. Tous ont un statut égal et aucun droit n’est plus important que les autres[138]. Par ailleurs, aucun droit conféré par la Charte n’est absolu. Tous les droits sont en soi limités par les droits et libertés d’autrui[139]. Par conséquent, si des droits s’opposent, les principes de la Charte commandent un équilibre qui respecte pleinement l’importance des deux catégories de droits de sorte que chacun ait pleine force et effet dans le contexte pertinent, dans toute la mesure du possible[140].
Il est également très important de noter que la conciliation de droits contradictoires ne peut être abordée dans l’abstrait. Les droits énoncés dans la Charte n’existent pas dans le vide et leur sens et leur contenu se définissent dans un contexte. Les droits reconnus par la Charte doivent être examinés de façon contextuelle pour régler les contradictions qui les opposent. Le contexte détermine là où se situent les limites des droits dans un cas particulier[141].
Lorsqu’ils traitent de droits qui pourraient s’opposer, les tribunaux doivent d’abord déterminer quels sont les droits qui sont revendiqués et qui sont réellement en jeu dans la situation sociale et factuelle qui leur est présentée. Dans bien des affaires, la mise en cause du droit est manifeste. Mais dans d’autres affaires, il peut être moins évident qu’un droit entre en jeu. Dans de telles circonstances, il peut être nécessaire de mener une enquête plus approfondie et d’entendre des preuves pouvant établir que la requête se situe dans les limites du droit revendiqué, tel que défini par les tribunaux[142].
Dans le contexte des droits religieux, bien des contradictions apparentes entre des droits se sont résolues par le simple fait de demander si la requête se situe dans les limites de ce droit dans un contexte particulier. Autrement dit, l’établissement de l’étendue et des limites de chaque droit peut révéler qu’il n’existe pas d’empiètement réel d’un droit sur un autre.
C’est la conclusion à laquelle la Cour suprême du Canada est parvenue dans deux arrêts importants portant sur les rapports entre les droits religieux et les droits à l’égalité liés à l’orientation sexuelle. Dans l’affaire Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, on demandait à la Cour de considérer la constitutionalité du projet de loi qui accorderait à deux personnes de même sexe le droit de se marier. Selon l’un des arguments présentés, le fait de permettre l’accès au mariage aux couples de même sexe aurait pour effet de porter atteinte aux droits à l’égalité ou aux droits religieux des personnes qui ont des croyances religieuses s’opposant au mariage entre personnes de même sexe. La Cour a rejeté l’argument voulant qu’il s’agisse d’un conflit des droits en déclarant que la reconnaissance des droits des gais et lesbiennes de se marier ne pouvait, en soi, porter atteinte aux droits d’autres groupes.
En ce qui concerne les situations possibles de conflits des droits qui pourraient découler de la légalisation du mariage entre personnes de même sexe, la Cour a refusé de porter un jugement au sujet de scénarios hypothétiques. La Cour a confirmé la nécessité de présenter des faits réels pour appliquer correctement l’approche contextuelle qui doit être utilisée dans la conciliation de droits contradictoires. La Cour a souligné que les arrêts passés démontraient que de nombreux conflits de droits, sinon tous, peuvent être résolus conformément à la Charte, si l’on délimite clairement les droits en cause et qu’on établit un équilibre interne entre ces droits.
Dans l’affaire Trinity Western, la Cour suprême du Canada a examiné la question de savoir si des diplômés d’une université privée d’allégeance chrétienne, qui exigeait que ses étudiants respectent certaines « normes propres à la communauté », notamment l’interdiction de toute « activité homosexuelle », devraient avoir droit à un permis d’exercice du British Columbia College of Teachers pour enseigner dans le système d’écoles publiques. L’ordre des enseignants soutenait que les programmes d’enseignement doivent être offerts dans un environnement qui représente les valeurs de la reconnaissance des droits de la personne et que les établissements qui entendent former des enseignants à travailler dans le système d’écoles publiques doivent démontrer qu’ils fournissent un cadre qui prépare bien les futurs enseignants à composer avec la diversité des élèves qui fréquentent les écoles publiques. Autrement dit, l’ordre des enseignants disait avoir des raisons de craindre que les diplômés du programme de Trinity Western ne fassent de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
La Cour suprême a conclu que cette affaire pouvait être résolue « en délimitant correctement les droits et valeurs en cause ». Une délimitation de la portée des droits évitait un conflit réel. La Cour a conclu qu’une ligne de démarcation appropriée se situait entre la liberté d’adhérer à des croyances et celle de se conduire conformément à ces croyances. Il n’y avait aucune preuve concrète indiquant que, du seul fait qu’ils ont certaines croyances au sujet de « l’homosexualité », les diplômés de Trinity Western agiraient de manière discriminatoire.
Lorsque la délimitation de la portée des droits ne permet pas de résoudre un conflit des droits, il faut déterminer dans quelle mesure l’exercice d’un droit entrave l’exercice d’autres droits. Si une telle entrave est minime ou peu importante, il est peu probable que le droit soit protégé contre cette entrave. Un conflit entre des droits n’existe que si l’entrave, le fardeau ou l’empiètement relatif à un droit, y compris un droit religieux, a une importance suffisante[143]. Dans l’affaire Bruker c. Marcovitz, la Cour suprême du Canada a considéré une allégation par un mari selon laquelle les tribunaux ne pouvaient pas le forcer à honorer une entente qu’il avait signée acceptant d’accorder à sa femme une divorce religieux, accord appelé un « get », car une telle intervention porterait atteinte à ses droits religieux. La majorité de la Cour a observé que, même si les tribunaux seraient réticents à s’ingérer dans toute question de nature « strictement spirituelle ou purement doctrinale » relative à une religion, ils étaient tenus d’intervenir lorsque des droits civils ou des droits de propriété étaient en cause. La Cour a poursuivi en mettant en doute la prétention à des droits religieux présentée par le mari en disant qu’elle « voyait difficilement » en quoi le fait de l’obliger à respecter son engagement d’accorder le get pouvait aller à l’encontre d’une croyance religieuse sincère et avoir des conséquences non négligeables pour lui. Cependant, même s’il arrivait à établir cela, la revendication de ses droits religieux devait être appréciée en tenant compte des valeurs opposées et des préjudices pouvant en découler, et à cet égard le mari avait « bien peu à mettre dans la balance ». Il avait consenti librement à une entente qu’il prétendait maintenant contraire à ses droits, et lui permettre de s’y soustraire irait à l’encontre de l’intérêt public qui comprend la protection des droits à l’égalité, la dignité des femmes juives dans leur habilité indépendante à divorcer et à se remarier, ainsi que l’avantage pour l’intérêt public de forcer les parties à respecter leurs obligations contractuelles valides et exécutoires.
Dans l’affaire Young c. Young[144], la Cour suprême s’est penchée sur une autre rupture de mariage qui touchait les droits religieux. Après une séparation difficile, les tribunaux avaient accordé à la mère la garde des trois enfants du couple alors que le père avait un droit de visite. Cependant, s’inquiétant des effets que ses activités religieuses pourraient avoir sur ses enfants, un juge avait ordonné au père de ne pas discuter de sa religion en tant que témoin de Jéhovah avec ses enfants, de ne pas assister avec eux au moindre service ou rassemblement religieux et de ne pas les exposer à des discussions religieuses avec des tiers sans le consentement de la mère. On demandait à la Cour suprême de déterminer si les dispositions de la Loi sur le divorce qui obligeaient les juges à « tenir compte de l'intérêt de l'enfant » lorsqu’ils décident des droits de garde et de visite portent atteinte aux libertés de religion et d'expression et au droit à l’égalité du père. Bien que la restriction ait été annulée par la Cour, surtout pour le motif que rien ne prouvait en l’espèce qu’elle était dans l’intérêt des enfants, la majorité de la Cour a conclu que la liberté de religion ne garantissait pas l’exercice d’activités religieuses qui n’étaient pas dans l’intérêt véritable des enfants. En effet, si des pratiques religieuses étaient préjudiciables à un enfant, l’intérêt véritable de l’enfant a préséance sur le droit du parent.
Si l’atteinte aux droits en cause est importante, un tribunal doit alors adopter les processus de la conciliation des droits. Dans une affaire relative aux droits reconnus dans la Charte, ce processus se fait aux termes de l’article 1. Dans une affaire qui ne porte pas sur une contestation aux termes de la Charte, cette conciliation peut également se faire au moyen de la méthode et des principes généraux énoncés à l’article 1. Dans l’affaire Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau‑Brunswick[145], la Cour suprême du Canada a examiné l’allégation de Malcolm Ross selon laquelle une décision d’une commission d’enquête en matière de droits de la personne avait porté atteinte à ses droits religieux en concluant que les propos antisémitiques que M. Ross avait tenus à l’extérieur du travail compromettaient sa capacité de remplir ses fonctions en tant qu’enseignant. M. Ross avait soutenu que ses opinions religieuses s’exprimaient par ses écrits, ses déclarations et ses publications, et que sa liberté de religion avait également été violée. La Cour a souligné que, même si la liberté de religion garantit que chacun est libre d'embrasser et de professer ses croyances sans ingérence de l'État, cette liberté :
n'est toutefois pas absolue, étant restreinte par le droit des autres personnes d'embrasser et de professer leurs propres croyances et opinions, et de ne pas être lésées par l'exercice de la liberté de religion d'autrui. La liberté de religion est soumise aux restrictions nécessaires pour protéger la sécurité, l'ordre, la santé ou la moralité publics, ainsi que les libertés et droits fondamentaux d'autrui[146].
Néanmoins, la Cour a souligné que plutôt que de formuler des limites internes à la garantie de la liberté de religion, il vaut mieux privilégier une interprétation large du droit en cause, les droits opposés devant être conciliés dans le cadre de l'analyse fondée sur l'article premier qui a été conçue dans l'arrêt R. c. Oakes[147]. En mesurant les droits des élèves à un milieu d’éducation libre de toute discrimination contre les droits de M. Ross à la liberté de religion et à la liberté d’expression, la Cour suprême a conclu que les limites imposées par la décision de la commission d’enquête à la capacité de M. Ross d’exprimer ses opinions antisémitiques étaient justifiées dans une société libre et démocratique. En arrivant à cette conclusion, la Cour a affirmé ce qui suit au sujet des droits religieux de M. Ross :
Quant à la liberté de religion, toute croyance religieuse qui dénigre et attaque les croyances religieuses d'autrui mine le fondement même de la garantie de l'al. 2a), un fondement qui garantit à chaque personne la liberté d'embrasser et de manifester les croyances que lui dicte sa conscience. L'intimé se sert de ses opinions religieuses pour nier aux Juifs le respect de la dignité et de l'égalité qui, dit-on, comptent parmi les valeurs fondamentales devant guider les tribunaux qui procèdent à une analyse fondée sur l'article premier. Lorsque les manifestations d'un droit ou d'une liberté d'une personne sont incompatibles avec les valeurs mêmes que l'on cherche à maintenir en procédant à une analyse fondée sur l'article premier, il convient de permettre un degré atténué de justification au sens de l'article premier[148].
Dans l’affaire B. (R.) c. Children’s Aid Society[149], une majorité des juges de la Cour suprême du Canada a conclu que la décision des parents de refuser une transfusion de sang était protégée par la liberté de religion. Au moyen d’un processus autorisé en vertu de la Child Welfare Act, l’enfant était devenu à titre temporaire pupille de la société d’aide à l’enfance qui avait consenti à la transfusion sanguine. Cependant, malgré l’atteinte grave portée aux droits des parents aux termes de l’alinéa 2 (a), cette atteinte était justifiée aux termes de l’art. 1 de la Charte. L’intérêt de l’État à protéger les enfants à risque a été évalué contre les droits des parents, et la Cour a jugé qu’en l’espèce cet intérêt avait préséance[150].
Les tribunaux ont affirmé qu’une approche contextuelle à la juste conciliation des intérêts aux termes de l’article 1 exige que l’on considère la mesure dans laquelle « l’essence » ou l’aspect fondamental du droit est touché. Lorsqu’une conduite se situe à la périphérie d’un droit, il est plus probable qu’elle doive céder à un droit dont les valeurs fondamentales sont en cause[151].
Dans une récente décision, la cour d’appel de la Saskatchewan a entendu une cause où il s’agissait de concilier les droits religieux des commissaires aux mariages civils et les droits à l’égalité reconnus par l’article premier de la Charte; Marriage Commissioners Appointed Under the Marriage Act (Re)[152]. Dans deux décisions distinctes, les cinq juges du tribunal ont conclu que les modifications proposées à la loi de cette province sur le mariage, The Marriage Act, 1995, qui auraient permis aux commissaires aux mariage, individuellement, de refuser de mener une cérémonie de mariage si elle était contraire à leurs croyances religieuses, portaient atteinte au droit à l’égalité reconnu aux termes de l’article 15 de la Charte. Les deux décisions ont ensuite concilié le droit d’être à l’abri de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et les droits religieux des commissaires aux mariages aux termes de l’art. 1 de la Charte et ont conclu, pour des motifs légèrement différents, que l’atteinte portée aux droits à l’égalité ne pouvait se justifier malgré l’objectif de tenir compte des oppositions fondées sur la religion que pourraient avoir certains commissaires aux mariages.
Les deux décisions ont admis que, dans une certaine mesure, les droits religieux des commissaires aux mariages seraient enfreints si on exigeait qu’ils célèbrent une cérémonie de mariage contraire à leurs croyances religieuses. Cependant, il existe une grande différence entre les mariages religieux célébrés par un prêtre en conformité avec les croyances, rites et sacrements de leur foi religieuse et les mariages civils qui sont censés n’avoir aucun lien religieux. Lorsque des prêtres ou ministres du culte célèbrent un mariage religieux, ils s’adonnent à un rite ou à une pratique religieuse qui touche l’essence même de leur droit à la liberté de religion. Au contraire, les commissaires aux mariages civils n’agissent pas en tant que particuliers lorsqu’ils exécutent leurs fonctions officielles mais ils célèbrent un mariage non religieux au nom du gouvernement. Permettre à des commissaires aux mariages civils de refuser de célébrer certaines cérémonies de mariage irait à l’encontre du principe fondamental voulant que les services gouvernementaux doivent être dispensés également à tous les citoyens de façon impartiale et non discriminatoire.
Dans l’affaire Smith v. Knights of Columbus[153], le tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a examiné une allégation de discrimination découlant du refus d’un organisme d’hommes catholiques de louer leur salle à un couple de lesbiennes qui voulait y tenir leur réception de noces. La salle de réception appartenait à l’Église catholique et était gérée par les Chevaliers de Colomb. La salle était louée au public pour toutes sortes d’activités comme des anniversaires de naissance et de mariage, des réunions des AA et pour un programme d’activités pour les mères et leurs tout-petits.
Les Chevaliers ont soutenu qu’ils avaient une justification raisonnable et de bonne foi pour annuler le contrat conclu avec le coupe et, qu’ils pouvaient également se prévaloir du moyen de défense prévu à l’article 41 du code des droits de la personne de la Colombie-Britannique. Bien que le tribunal ait rejeté la requête portant sur le moyen de défense prévu à l’art. 41 du code (voir la section Moyens de défense prévus par la loi dans laquelle est approfondi cet aspect de la décision), il a accepté le fait que la salle ne pouvait pas être utilisé pour une activité qui était contraire aux croyances catholiques fondamentales. Le tribunal a décrit cette méthode comme une analyse du spectre, ce qui signifie qu’il lui fallait décider à quel point du spectre se situait l’équilibre entre les droits religieux des Chevaliers et les droits à l’égalité de couple de lesbiennes. Le tribunal a confirmé que plus un acte est éloigné des croyances religieuses fondamentales de la personne refusant un service, moins il est susceptible d’être considéré comme justifié.
La formation de juges a déterminé que, selon les faits en l’espèce, les Chevaliers ne pouvaient pas être forcés d’agir de manière contraire à l’essence même de leurs croyances religieuses. Même si on ne leur demandait pas de prendre part à la célébration du mariage entre personnes de même sexe, le fait de louer leur salle à cette fin les aurait obligés à appuyer indirectement un acte qui est contraire à leurs croyances religieuses fondamentales. Cependant, l’analyse du tribunal ne s’est pas terminée là. Il a conclu que les arrangements déjà pris pour louer la salle aux requérantes entraînaient l’obligation d’adaptation pour tenir compte des besoins des requérantes. Les Chevaliers auraient dû chercher une solution acceptable qui aurait réduit l’effet négatif sur les droits des requérantes. En particulier, avant de communiquer avec les requérantes pour annuler le contrat, ils auraient dû prendre des mesures additionnelles pour reconnaître la dignité inhérente des requérantes, par exemple en les rencontrant pour expliquer la situation, en s’excusant officiellement, en offrant immédiatement de rembourser aux requérantes toute les dépenses découlant de l’annulation du contrat et en offrant peut-être de les aider à trouver une autre solution. Essentiellement, le tribunal cherchait une position de compromis qui permettait de préserver les droits religieux des Chevaliers tout en reconnaissant les effets que pouvait avoir sur la dignité des requérantes le fait d’être informées soudainement qu’elles ne pouvaient pas louer la salle, après avoir signé un contrat et envoyé les invitations au mariage.
L’affaire Brockie v. Brillinger portait sur une plainte pour atteinte aux droits de la personne déposée par un homme gai qui s’était adressé à l’entreprise de M. Brockie pour faire imprimer des papiers à en-tête et des cartes de visite pour le compte des Gay and Lesbian Archives. M. Brockie a refusé de fournir ce service en invoquant le fait que cela irait à l’encontre de ses croyances religieuses. Une commission d’enquête en matière de droits de la personne a conclu que M. Brockie avait fait preuve de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle à l’égard de M. Brillinger et des Archives. La commission a ordonné à M. Brockie de fournir les services d’impression aux gais et lesbiennes et aux organismes de gais et lesbiennes et à payer 5 000 $ en dommages-intérêts.
M. Brockie a interjeté appel devant la Cour divisionnaire. Il a demandé à la Cour d’annuler la décision antérieure en se fondant sur son droit constitutionnel à la liberté de religion. Les parties à l’appel ont admis que l’ordonnance de la commission portait en effet atteinte à la liberté de religion de M. Brockie en le forçant à agir de façon contraire à ses croyances religieuses.
Pour décider si l’ordonnance de la commission avait limité de manière indue ces droits ou si cette restriction pouvait être justifiée comme une limite raisonnable aux termes de l’art. 1 de la Charte, la Cour a souligné que plus une activité est éloignée des éléments qui constituent « l’essence » de la liberté de religion, plus elle est susceptible de toucher d’autres personnes et moins elle est susceptible de donner droit à la protection de la loi. La Cour a jugé que les services d’impression commerciaux de M. Brockie se trouvaient à la périphérie des activités protégées en vertu de la liberté de religion. Les restrictions imposées à l’exercice de son droit étaient donc justifiées pour empêcher la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Cependant, la Cour a ajouté que dans un contexte différent, les conclusions pourraient être différentes, par exemple si le contenu du matériel à imprimer entrait plus directement en conflit avec des éléments fondamentaux des croyances de M. Brockie[154].
Dans une autre affaire portant sur les droits religieux et l’orientation sexuelle dans le contexte de l’éducation publique laïque, la Cour suprême du Canada a considéré la décision d’un conseil scolaire de ne pas approuver trois livres montrant des familles comportant des parents de même sexe comme ressources complémentaires pour l’enseignement du programme d’éducation à la vie familiale; Chamberlain c. Surrey School District No. 36[155]. La décision du conseil était fondée sur les oppositions de certains parents pour des motifs religieux. La majorité de la Cour a observé que la School Act de Colombie-Britannique exigeait la laïcité et la non‑discrimination, et a conclu que la décision du conseil était déraisonnable dans les circonstances. La Cour a souligné dans l’arrêt que, même si l’on pouvait tenir compte des préoccupations religieuses de certains parents, ces préoccupations ne pouvaient servir à nier une égale reconnaissance et un égal respect aux autres membres de la collectivité. L’arrêt représentant l’avis de la majorité mettait l’accent sur le droit d’adhérer à des opinions religieuses, y compris l’opinion sur le caractère indésirable des pratiques d’autres personnes. Cependant, pour que les écoles fonctionnent dans une atmosphère de tolérance et de respect, ces opinions ne devraient pas constituer le fondement sur lequel sont adoptées les politiques scolaires. L’arrêt soulignait que le conseil n’avait pas tenu compte des besoins des enfants de familles homoparentales ni de la pertinence du matériel à l’égard des objectifs du programme d’études.
Cependant, deux juges de la Cour suprême auraient considéré que la décision du conseil était raisonnable. Expliquant leur dissension, ces juges ont mis l’accent sur le droit des parents d’élever leurs enfants en conformité avec leurs croyances religieuses ou autres.
S’il existe une atteinte importante aux droits en question, un droit doit finalement céder la priorité à l’autre, ou il faut peut-être adopter un compromis touchant les deux droits. Néanmoins, les décisionnaires ont dit que des mesures devraient être adoptées pour atténuer les effets sur les droits. Lorsque des droits demeurent en conflit, il n’est peut-être pas nécessaire qu’un droit soit complètement abandonné en faveur de l’autre. Il faut plutôt privilégier la recherche de « compromis constructifs » qui permettent aux deux groupes intéressés de profiter de leurs droits respectifs dans la plus grande mesure possible dans les circonstances[156].
Par exemple, dans l’affaire N.S., la Cour d’appel de l’Ontario a souligné que des mesures pourraient être disponibles pour réduire le préjudice possible tant au droit de N.S. d’observer ses croyances religieuses qu’au droit des accusés de se défendre de manière pleine et entière. La Cour a donné plusieurs exemples, notamment que le personnel du tribunal soit composé exclusivement de femmes et que l’affaire soit entendue par une juge, et qu’on ne permettre à aucun homme autre que les accusés et leur avocat d’être dans la salle d’audience si on exigeait que N.S. enlève son niqab. Cette affaire est en appel devant la Cour suprême du Canada.
Enfin, dans l’affaire Dallaire c. Les Chevaliers de Colomb[157], le TDPO a conclu qu’une femme qui s’opposait aux croyances de l’Église catholique au sujet de l’avortement ne pouvait pas invoquer le Code pour contester une inscription sur un monument situé sur le terrain d’une église. En interprétant le sens de « service » ou « installation » aux termes du Code, le tribunal a tenu compte du droit de l’église d’exprimer sa liberté de religion. Le tribunal a conclu que l’expression d’une croyance religieuse dans une inscription affichée sur un bien appartenant à l’église n’est ni un « service » ni une « installation » au sens de l’article 1 du Code.
La Commission a élaboré un examen de la jurisprudence portant sur la façon dont les tribunaux judiciaires et administratifs ont traité de diverses questions de droits contradictoires, pas seulement ceux qui portaient sur la croyance (disponible en ligne à www.ohrc.on.ca). En janvier 2012, elle a approuvé une Politique sur les droits de la personne contradictoires, laquelle aidera les organismes et les particuliers à aborder les situations difficiles mettant en jeu des droits contradictoires.
Moyens de défense prévus par la loi
Le Code comprend divers moyens de défense relatifs à des actes qui, en l’absence de ces moyens de défense, contreviendraient au Code. Certains d’entre eux visent à protéger des groupes associés à une croyance, en particulier, contre des allégations de discrimination (art. 18.1 et 19 du Code), alors que d’autres peuvent être invoqués par divers organismes, y compris des organismes religieux, pour soutenir qu’ils n’ont pas enfreint le Code.
L’article 18.1 a été inclus dans le Code en 2005, vraisemblablement en réponse à la discussion concernant le droit des autorités religieuses de refuser de célébrer des mariages de personnes de même sexe dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe. Il se lit ainsi :
Célébration du mariage par les autorités religieuses
18.1 (1) Ne constitue pas une atteinte aux droits, reconnus dans la partie I, à un traitement égal en matière de services et d’installations le fait pour une personne inscrite en vertu de l’article 20 de la Loi sur le mariage de refuser de célébrer un mariage, de permettre qu’un lieu sacré soit utilisé pour la célébration d’un mariage ou pour la tenue d’un événement lié à la célébration d’un mariage, ou de collaborer d’autre façon à la célébration d’un mariage, si le fait de célébrer le mariage, de permettre l’utilisation du lieu sacré ou de collaborer d’autre façon est contraire,
a) soit à ses croyances religieuses;
b) soit aux doctrines, rites ou coutumes de la confession religieuse à laquelle elle appartient.
Idem
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter l’application de l’article 18.
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article,
« lieu sacré » S’entend notamment d’un lieu de culte et de toutes installations auxiliaires ou accessoires.
Jusqu’à présent, aucun arrêt ou décision n’a interprété cette disposition (mais voir la décision rendue par le tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique dans l’affaire Knights of Columbus, discutée dans la section Conciliation du droit de croyance et d'autres droits).
Cet article ne protège que les autorités religieuses et ne s’applique qu’à des lieux sacrés. Par conséquent, les fonctionnaires responsables des mariages civils ne pourraient pas se prévaloir de ce moyen de défense (voir aussi l’affaire Marriage Commissioners Appointed Under the Marriage Act (Re) également discutée dans la section Conciliation du droit de croyance et d'autres droits).
Un autre moyen de défense prévu dans le Code qui traite expressément des droits religieux reconnaît les droits et privilèges des écoles séparées aux termes de la Loi constitutionnelle et de la Loi sur l’éducation :
Maintien des droits des écoles séparées
19. (1) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à un droit ou à un privilège dont jouissent les conseils d’écoles séparées ou leurs contribuables en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 et de la Loi sur l’éducation relativement aux écoles séparées. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 19 (1).
Fonctions des enseignants
(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur l’éducation en ce qui concerne les fonctions des enseignants. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 19 (2).
Bien qu’il ne semble y avoir aucune décision d’un tribunal de droits de la personne interprétant cette disposition particulière, plusieurs tribunaux ont traité de certains aspects des droits des écoles séparées.
Un arrêt important portant sur le financement des écoles catholiques en Ontario porte sur l’affaire Adler c. Ontario[158]. La Cour suprême du Canada a rejeté la revendication présentée par des groupes de parents dont les enfants fréquentaient des écoles confessionnelles privées non financées par le gouvernement que le financement préférentiel des écoles catholiques portait atteinte à leurs droits religieux et à leur droits à l’égalité aux termes de l’alinéa 2 (a) et de l’article 15 de la Charte. La Cour a confirmé qu’en raison de l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867, l’Ontario était tenu de financer les écoles séparées catholiques. Ce statut spécial est le fruit d’un compromis historique décisif quant à la Confédération[159].
Les tribunaux ont jugé que les droits accordés aux écoles confessionnelles à l’établissement de la confédération comprennent leur droit de privilégier l’embauche d’enseignants catholiques[160].
Dans une autre décision, un conseil scolaire catholique n’a pas pu invoquer l’alinéa 2 (a) de la Charte ni l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 pour appuyer sa décision de ne pas permettre à Marc Hall, un adolescent gai, de se faire accompagner de son partenaire de même sexe au bal des finissants de son école. M. Hall a eu gain de cause lorsqu’il a demandé une injonction à un tribunal de l’Ontario interdisant au conseil scolaire de l’empêcher d’assister au bal des finissants avec son copain[161].
En appliquant les critères permettant de décider d’accorder l’injonction, le tribunal a reconnu les protections accordées aux écoles catholiques à l’art. 93 de la Loi constitutionnelle. Cependant, le tribunal a également affirmé que ces protections ne signifient pas que les écoles séparées sont dispensées de respecter la Charte. Pour déterminer si l’art. 93 de la Loi constitutionnelle[162] pouvait être invoqué pour justifier l’atteinte portée aux droits à l’égalité de M. Hall, le tribunal a souligné que l’art. 93 ne signifie pas que la Charte ne s’applique pas aux écoles séparées. Les tribunaux doivent établir un équilibre au cas par cas entre une conduite essentielle au bon fonctionnement d’une école catholique et une conduite qui porte atteinte aux droits reconnus par la Charte, comme le droit à l’égalité aux termes de l’art. 15. Dans cette affaire, il s’agissait de déterminer si le fait de permettre à un élève gai d’assister au bal des finissants en compagnie de son copain entravait les droits conférés aux écoles confessionnelles aux termes de l’art. 93 de la Loi constitutionnelle.
La Cour à répondu « non » à cette question. Premièrement, la preuve indiquait une telle diversité d’opinions dans la communauté catholique qu’il était difficile de déterminer quelle ligne de conduite serait nécessaire pour veiller à ce que les droits des écoles confessionnelles ne soient pas entravés. Deuxièmement, le droit en cause (de contrôler qui pouvait assister aux danses organisées par l’école) n’était pas visé en 1867. Enfin, en examinant objectivement la situation, on ne pouvait dire que la conduite en cause touchait de manière essentielle la nature confessionnelle de l’école.
En fin de compte, le tribunal a conclu que les droits à l’égalité de M. Hall seraient plus gravement atteints s’il était privé de la possibilité d’assister à son bal de finissants. Par ailleurs, une injonction ne pourrait obliger ou interdire des enseignements à l’intérieur de l’école ni toucher les croyances catholiques. Puisqu’une injonction interdit une conduite et non des croyances, elle ne porte pas atteinte à la liberté de religion du défendeur. Bien que l’injonction ait été accordée et que M. Hall ait été autorisé à assister au bal des finissants avec son partenaire de même sexe, l’affaire a été abandonnée et il n’y a pas eu de procès menant à une décision finale[163].
Les articles 18 et 24 du Code permettent également aux organismes religieux et autres qui satisfont aux critères de ces articles d’accorder la préférence à certaines personnes en matière d’adhésion et d’emploi dans certaines circonstances. Bien que ces dispositions constituent des moyens de défense pour des actes qui autrement contreviendraient au Code, elles reconnaissent également les droits des groupes religieux d’accorder la préférence, dans certaines circonstances, à des personnes qui partagent les mêmes croyances et pratiques religieuses. Comme l’a souligné la Cour suprême du Canada, ces types de dispositions devraient être considérées non seulement comme des dispositions ayant pour effet de limiter des droits, ce qui repose sur une interprétation étroite, mais elles devraient également être perçues comme des dispositions qui confèrent et protègent des droits; notamment le droit de s’associer selon des fondements religieux, dans un ensemble défini de circonstances[164].
Les articles 18 et 24 se lisent ainsi :
Groupement sélectif
18. Ne constitue pas une atteinte aux droits, reconnus dans la partie I, à un traitement égal en matière de services et d’installations, avec ou sans adaptation, le fait qu’un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les intérêts de personnes identifiées par un motif illicite de discrimination, n’accepte que des personnes ainsi identifiées comme membres ou participants.
Emploi particulier
24. (1) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi le fait,
a) qu’un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les intérêts de personnes identifiées par la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la croyance, le sexe, l’âge, l’état matrimonial ou un handicap n’emploie que des personnes ainsi identifiées ou leur accorde la préférence si cette qualité requise est exigée de façon raisonnable et de bonne foi compte tenu de la nature de l’emploi;
Dans l’affaire Caldwell c. Stewart[165] la Cour suprême du Canada a conclu qu’une école catholique pouvait congédier une enseignante catholique qui avait épousé un homme divorcé dans un mariage civil, ce qui est contraire aux règles de l’Église catholique. La Cour a admis que l’intimé avait le « droit » de préserver les fondements religieux de l’école en employant des enseignants qui acceptent et observent les enseignements de l’Église. Par conséquent, l’exigence que les enseignants catholiques observent la religion a été considérée comme une exigence professionnelle légitime et imposée de bonne foi. De plus, l’école pouvait invoquer l’art. 22 du code des droits de la personne de la Colombie‑Britannique, lequel est semblable à l’art. 18 du Code de l’Ontario, pour accorder la préférence à des enseignants catholiques qui acceptent et observent les enseignements de l’Église.
Le tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a considéré qu’une disposition semblable à l’art. 18 du Code ontarien, permettait à un organisme religieux (un temple) de choisir ses membres en se fondant sur la communauté de race, de religion, d’ascendance et de lieu d’orgine; Sahota and Shergill v. Shri Guru Ravidass Sabha Temple[166]. Deux requérants ont allégué qu’ils n’étaient pas autorisés à devenir membres de Sabha parce qu’ils n’appartenaient pas aux Ravidassi (ou à la caste Chamar) mais qu’ils étaient d’une caste supérieure, la caste Jat. Selon la preuve présentée au tribunal, la caste Chamar ou Ravidassi était considérée comme la plus basse des castes de la société indienne et elle subissait la discrimination, surtout dans les temples sikhs, de la caste Jat qui jouissait d’un statut social plus élevé. L’intimé a soutenu que le Sabha avait été créé pour promouvoir les intérêts propres à la communauté ravidassia et que pour promouvoir les intérêts de cette communauté distincte il fallait restreindre l’adhésion au Sabha aux membres de cette communauté. En particulier, il serait inapproprié que le temple soit tenu d’admettre des membres de castes supérieures qui, historiquement, ont agi de manière discriminatoire à l’endroit des ancêtres de la communauté ravidassia. Par ailleurs, les requérants soutenaient que même si le temple pouvait limiter l’adhésion aux personnes ayant les mêmes convictions religieuses, il ne devrait pas pouvoir le faire en se fondant sur la caste, la race ou la situation économique. Le tribunal a déterminé que le Sabha n’offrait pas un service habituellement offert au public, aux termes du code de la C.-B. Cependant, même si tel avait été le cas, le temple est un organisme religieux et culturel à but non lucratif dont l’objet premier est de promouvoir les intérêts des personnes de la communauté ravidassia, laquelle est un groupe qui se caractérise par une communauté de race, de religion, d’ascendance et de lieu d’origine. Ainsi, selon le moyen de défense prévu par la loi, le Sabha pouvait accorder la préférence aux Ravidassi ou aux membres de la caste Chamar sans enfreindre le code de la C.-B.
La défense relative à l’emploi particulier prévu à l’al. 24 (1) (a) du Code de l’Ontario a été considérée dans l’affaire Ontario Human Rights Commission v. Christian Horizons[167]. Dans cette affaire, Christian Horizons, un organisme de l’Église évangélique chrétienne qui administre des foyers résidentiels et des camps destinés aux personnes ayant une déficience intellectuelle a soutenu que l’al. 24 (1) (a) constituait une défense à l’égard d’une plainte de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle déposée par l’une de ses employés.
Connie Heintz, une employée de soutien d’une résidence communautaire gérée par Christian Horizons, avait signé une déclaration de style de vie et de bonnes mœurs comme l’exigeait Christian Horizons. La déclaration qualifiait les « relations homosexuelles », entre autres, de comportement répréhensible rejeté par Christian Horizons. Plusieurs années après le début de son emploi, Mme Heintz a pris conscience de son orientation sexuelle et s’est engagée dans une relation avec une personne de même sexe. Lorsque son employeur l’a appris, on lui a offert du counseling pour l’aider à se conformer à sa déclaration de style de vie et de bonnes mœurs interdisant « l’homosexualité ». Mme Heintz a allégué que par la suite elle avait fait l’objet de mesures disciplinaires injustes au sujet de son attitude et de son rendement et qu’elle avait été exposée à un milieu de travail empoisonné.
Christian Horizons a reconnu qu’il agissait de façon discriminatoire à l’endroit de Mme Heintz sauf s’il invoquait le moyen de défense prévu à l’al. 24 (1) (a). Pour pouvoir se prévaloir de ce moyen de défense, Christian Horizons devait démontrer : 1) qu’il était un « organisme religieux »; 2) dont le principal objectif est de servir les intérêts de personnes identifiées par la croyance et n’emploie que des personnes ainsi identifiées; 3) que l’adhésion religieuse est exigée de façon raisonnable et de bonne foi compte tenu de la nature de l’emploi.
Le premier critère a été facilement démontré. Pour ce qui est du deuxième, le TDPO a conclu que Christian Horizons n’avait pas pour objectif de servir des personnes identifiées par la croyance puisque sa principale mission était de fournir des soins et du soutien à des personnes ayant une déficience intellectuelle, sans égard à leur croyance. Cependant la Cour divisionnaire a renversé cette conclusion, Elle a plutôt suivi l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Caldwell selon lequel l’al. 24 (1) (a) ne devait pas être interprété de manière étroite, parce que même s’il limite certains droits, il confère également le droit de s’associer à certains groupes afin qu’ils puissent s’unir pour exprimer leurs opinions et mener leurs activités conjointes. Lorsque les tribunaux interprètent cet article, il leur faut accorder de l’importance à la garantie de liberté de religion pour les membres des organismes religieux : « une approche à l’interprétation de l’al. 24 (1) (a) qui tient compte, dans la détermination de l’activité première de l’organisme religieux, de la perspective et de l’objet de l’organisme est compatible avec la garantie de liberté de religion[168]. » [notre traduction]
La Cour divisionnaire en est venue à conclure que l’œuvre de bienfaisance de Christian Horizons était une activité religieuse par laquelle les membres concrétisaient leur foi chrétienne et accomplissaient leur mission chrétienne. Par conséquent, l’organisme avait pour principal objectif de servir les intérêts de ses membres et les personnes ayant une déficience intellectuelle bénéficiaient des avantages qui en découlaient.
Cependant, pour ce qui est du troisième critère de l’al. 24 (1) (a), la composante portant sur l’exigence professionnelle raisonnable et de bonne foi, la Cour divisionnaire a accepté les conclusions du TDPO selon lesquelles Christian Horizons n’avaient pas prouvé que la conformité à la déclaration de style de vie et de bonnes mœurs, y compris l’interdiction des relations entre personnes de même sexe, était une exigence nécessaire à l’exécution des tâches essentielles d’une employée de soutien. Les employés de soutien ne sont pas engagés activement dans la promotion d’un mode de vie évangélique chrétien. En réalité, rien n’exigeait que les résidents appartiennent à l’Église évangélique chrétienne. De plus, l’interdiction relatives aux relations entre personnes de même sexe n’était pas requise pour l’exécution efficace des tâches normales des employés de soutien qui comprennent des activités comme cuisiner, nettoyer et aider les résidents à manger. Par conséquent, au contraire de l’affaire Caldwell, dans laquelle le rôle de l’enseignant était d’inculquer des croyances catholiques aux élèves tant par l’enseignement que par l’exemple, la nature de l’emploi dans ce cas ne nécessitait aucunement l’exigence que les employés de soutien s’abstiennent de s’engager dans une relation avec une personne de même sexe. Par conséquent, Christian Horizons n’a pas réussi à démontrer qu’il satisfaisait au troisième critère qui lui aurait permis d’invoquer le moyen de défense prévu à l’al. 24 (1) (a) et le tribunal a conclu qu’il avait fait preuve de discrimination[169].
De façon semblable, dans l’affaire Knights of Columbus discutée en détails dans la section CONCILIATION DU DROIT DE CROYANCE ET D’AUTRES DROITS, le tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a rejeté l’argument des Chevaliers de Colomb selon lequel l’art. 41 du code de la C.-B, article qui a servi de moyen de défense à l’école catholique dans l’affaire Caldwell et à l’organisme de femmes dans l’affaire Nixon, leur permettait de privilégier les membres de leur propre groupe religieux lorsqu’ils louaient leur salle de réception. Le tribunal a conclu, en se fondant sur la preuve, que la salle était à la disposition du public et non seulement des membres de la communauté catholique. Il n’y avait pas de traitement préférentiel pour les catholiques. On refusait de louer la salle aux requérantes parce qu’elles voulaient y célébrer un mariage entre personnes de même sexe, et non parce que les Chevaliers accordaient la préférence à un autre groupe adhérant aux mêmes croyances religieuses.
Si l’on considère les arrêts et décisions ci-dessus, il est évident que les moyens de défense prévus dans le Code jouent un rôle important dans la reconnaissance de certains droits liés à la croyance. Pour cette raison, ils ne doivent pas être interprétés de manière trop étroite. Néanmoins, les critères permettant d’invoquer ces moyens de défense doivent s’appliquer aux circonstances de l’affaire. En particulier, l’organisme religieux désirant s’en prévaloir doit être en mesure de démontrer, par des preuves objectives, que les actes qui ont un effet discriminatoire sur autrui sont nécessaires à l’exercice de ses droits religieux.
Conclusion
Le droit relatif à la liberté de religion et au droit d’être à l’abri de toute discrimination fondée sur la croyance ne cesse d’évoluer. La Cour suprême du Canada est sur le point de rendre plusieurs arrêts qui pourraient avoir des conséquences considérables pour ceux et celles qui œuvrent dans le domaine des droits de la personne. Un examen des requêtes portant sur la discrimination fondée sur la croyance déposées auprès du TDPO indique qu’il traite de revendications uniques et complexes qui soulèvent de nouvelles questions juridiques. Sans aucun doute, les décisionnaires seront appelés à considérer les limites extrêmes de la définition de la croyance et la nature de ce qui est protégé aux termes des dispositions relatives à la religion et à la croyance, et qu’ils devront trancher sur diverses questions relatives aux mesures d’adaptation soulevées dans le contexte des droits de croyance. Des perspectives divergentes sur ce qu’il convient de faire lorsque des droits liés à la croyance entrent en conflit avec d’autres droits continueront d’éclairer le débat public sur cette problématique des plus complexes.
Le présent examen de la jurisprudence dresse un tableau général pouvant éclairer un dialogue constant sur la façon dont le droit influe sur l’interprétation des droits liés à la croyance aux termes du Code. Ce débat mènera finalement à une mise à jour de la politique sur la croyance qui sera fondée sur la jurisprudence. La Commission continuera à parfaire son analyse juridique en s’appuyant sur les faits qui surviennent sur le plan juridique ainsi que sur les recherches et les discussions qui se poursuivent. À cette fin, la Commission accueillera avec le plus grand intérêt toute observation sur le présent document, et sur son analyse des affaires et des questions soulevées. Veuillez faire parvenir vos observations à :
Commission ontarienne des droits de la personne
Projet sur la croyance
180, rue Dundas Ouest, 8e étage
Toronto (Ontario) M7A 2R9
Courriel : info@ohrc.on.ca
[1] La Commission, souvent appelé la Commission Bouchard-Taylor, a publié son rapport le 21 mai 2008, intitulé Fonder l'avenir : le temps de la conciliation.
[2] Ainsi que la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.
[3] Voir par exemple H. Kislowicz, « Freedom of Religion and Canada’s Commitments to Multiculturalism », (2009), en ligne à http://www.irmgard-coninx-stiftung.de/fileadmin/user_upload/pdf/Cultura…. D’autres ont décrit les droits religieux comme le « canari dans la mine de charbon » puisque les menaces faites aux droits religieux indiquent que d’autres droits et libertés pourraient aussi être menacés. Brian J. Grim et Roger Finke, The Price of Freedom Denied (New York: Cambridge University Press, 2011).
[4] Refuser d’embaucher une personne en raison de sa croyance.
[5] Un code vestimentaire qui est contraire aux règles d’une religion.
[6] D’autres textes législatifs en matière de droits de la personne utilisent les termes « religion », « croyances religieuses » ou « convictions religieuses ». De nombreux textes indiquent à la fois la « religion » et la « croyance » comme motifs illicites de discrimination.
[7] Cela est dû au fait que les règles de l’interprétation des lois comprend l’hypothèse que chaque mot d’une loi est censé avoir un rôle spécifique à jouer (une présomption contre la tautologie, c.-à-d. la redondance); R. Sullivan, Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4e éd. (Toronto: Butterworths Canada Ltd., 2002). Le Code place la croyance/creed dans la liste des motifs illicites de discrimination mais parle ensuite de « croyances religieuses/religious beliefs » à l’article 18.1 (un moyen de défense traitant de la célébration du mariage par les autorités religieuses). La version française indique « la croyance », un terme qui peut se traduire par « belief », dans les motifs illicites et utilise « croyances religieuses » à l’article 18.1. De plus, le fait que certaines lois en matière de droits de la personne utilisent à la fois « croyance » et « religion » donne également à penser que chacun de ces deux termes est censé avoir un sens distinct. Cependant, il y a eu peu de discussion jusqu’à présent sur la possibilité que les termes croyance et religion aient un sens différent dans la loi.
[8] The Concise Oxford-Hachette French Dictionary 2e éd. (Oxford, Oxford University Press, 1998).
[9] Dreidger, supra note 7.
[10] Certaines lois en matière de droits de la personne comprennent également des dispositions confirmant que toute personne a un droit à la liberté de conscience et de religion, ainsi que le droit d’être à l’abri de toute discrimination fondée sur la religion; p. ex., les lois du Yukon en matière de droits de la personne.
[11] Voir Huang v. 1233065 Ontario, 2011 HRTO 825, par. 28, dans lequel sont citées quelques décisions portant sur les liens entre le Code et la Charte, et R. v. Badesha, 2011 ONCJ 284 (CanLII).
[12] Codification administrative des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982.
[13] L.R.O. de 1990, chap. E.2.
[14] La définition adoptée par la Commission en 1996 précise également que le terme croyance ne comprend pas les convictions profanes, morales, éthiques ou politiques. Sauf la décision Jazairi (voir ci-après) qui porte sur l’opinion politique, il ne semble y avoir aucune décision qui porte expressément sur l’exclusion de convictions purement profanes ou morales du champ de la « croyance ». Cependant, Amselem, infra note 15, au par. 39, indique que lorsqu’il s’agit de liberté religieuse, seules les croyances, convictions et pratiques tirant leur source d’une religion, par opposition à celles qui soit possèdent une source séculière ou sociale, soit sont une manifestation de la conscience de l’intéressé, sont protégées aux termes des chartes du Québec ou du Canada. Par conséquent, la question de savoir si les croyances profanes, morales ou éthiques peuvent constituer une croyance donnant droit à une protection contre la discrimination aux termes du Code de l’Ontario est une question qu’il faudra approfondir dans le cadre des travaux futurs d’élaboration de politiques.
[15] [2004] 2 R.C.S. 551.
[16] Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, [1985] 2 R.C.S. 536; Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud, [1992] 2 R.C.S. 970.
[17] Par exemple, Friesen v. Fisher Bay Seafood Ltd. (2008), 65 C.H.R.R. D/400, 2009 BCHRT 1.
[18] Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. 567.
[19] Chabot c. Conseil scolaire catholique Franco-Nord, 2010 HRTO 2460, Gilbert c. 2093132 Ontario Inc., 2011 HRTO 672.
[20] Huang, supra note 11.
[21] Central Alberta Dairy Pool c. Alberta (Human Rights Commission), [1990] 2 R.C.S. 489.
[22] Koroll v. Automodular Corp., 2011 HRTO 774.
[23] Kerksen v. Myert Corps Inc., 2004 BCHRT 60.
[24] Voir Kelly v. British Columbia (Public Safety and Solicitor General) (No. 3), 2011 BCHRT 183 (CanLII).
[25] 2009 HRTO 1415, par. 39. Voir également Hayes v. Vancouver Police Board, 2010 BCHRT 324 au sujet du paganisme.
[26] Communications, Energy and Paperworkers Union of Canada Local 722-M v. Global Communications, [2010] C.L.A.D. No. 298 (QL).
[27] Heintz v. Christian Horizons, 2008 HRTO 22.
[28] Re O.P.S.E.U. and Forer (1985), 52 O.R. (2d) 705 (C.A.).
[29] Il l’a plutôt décrit comme un « mode de guérison vibrationnel » qui reposait sur le transfert d’une énergie universelle de force vitale à la personne qui la reçoit.
[30] 1999 CanLII 3744 (ON CA).
[31] Fait intéressant, dans l’une des premières décisions portant sur la croyance, le professeur Cumming, qui entendait la plainte d’un homme sikh à qui on avait refusé un emploi parce qu’il portait la barbe et le turban, a décrit la croyance comme étant dérivée du mot latin « credo » qui signifie « je crois ». Il avait également consulté les définitions des dictionnaires Webster et Oxford, lesquelles peuvent se traduire ainsi :
Dans le Oxford : sous « Creed » – « un système accepté ou professé de croyances religieuses : la foi d’un individu ou d’une collectivité, en particulier de la façon dont elle s’exprime ou est susceptible d’expression dans une formule définie. » [notre traduction]
Webster’s : sous « Creed » - « toute formule de confession d’une foi religieuse; un système de croyances religieuses, en particulier de la façon dont il est exprimé ou exprimable dans un énoncé défini; parfois, un sommaire des principes ou d’un ensemble d’opinions professés ou acceptés en sciences, en politique, ou autres domaines semblables; en tant que croyance d’espoir (hopeful creed) ». [souligné dans l’original] [notre traduction]
[32] Amselem, supra note 15, par. 39.
[33] Par exemple, est-ce que des personnes qui s’identifient comme athées (terme communément défini comme les personnes croyant qu’il n’existe aucune déité) ou agnostiques (celles qui ne savent pas avec certitude si Dieu existe. Les agnostiques croient que l’existence de Dieu n’est pas connue et dépasse vraisemblablement l’entendement humain) peuvent soutenir que leurs convictions constituent « une croyance » aux termes du Code de l’Ontario?
[34] Hendrickson Spring v. United Steelworkers of America, Local 8773 (Kaiser Grievances), [2005] O.L.A.A. No. 382, 142 L.A.C. (4th) 159.
[35] Dans Huang, supra note 11, l’intimé contestait que le Falun Gong constituait une croyance en se fondant sur cet argument.
[36] [1985] 1 R.C.S. 295, par. 94 et 95.
[37] R. v. N.S., 2010 ONCA 670 (CanLII), autorisation d’interjeter appel devant la C.S.C. accordée.
[38] Amselem, supra note15, par. 52.
[39] Ibid., par. 53.
[40] N.S., supra note 37, par. 68.
[41] S.L. c. Commission scolaire des Chênes, 2012 CSC 7.
[42] Ibid., par. 22-24.
[43] 2009 BCHRT 319, par. 115 (CanLII). Dans une affaire semblable, le TDPO a rejeté une requête relative au droit de croyance dans laquelle une étudiante universitaire a allégué avoir reçu une note injuste en raison de ses vues sur le mariage gai, qu’elle disait liées à sa croyance; Hsieh v. York University, 2009 HRTO 606 (CanLII). L’intimé a soutenu que l’étudiante voulait débattre du mariage gai, et non se concentrer sur le programme d’études, ce qui était perçu par les autres étudiants comme une attitude homophobe. L’intimé a souligné que les vues de l’étudiante sur le mariage gai n’avaient pas eu une incidence notable sur ses notes. Bien que l’affaire ne comporte pas une analyse approfondie, le TDPO n’a pas considéré que les faits présentés constituaient une preuve de discrimination fondée sur la croyance.
[44] 2005 BCCA 327 (CanLII).
[45] 2005 CanLII 1066 (ON SCDC).
[46] 2011 HRTO 1628 (CanLII).
[47] Eldary v. Songbirds Montessori School Inc., 2011 HRTO 1026 (CanLII).
[48] Hendrickson Spring v. United Steelworkers of America, Local 8773 (Kaiser Grievances), [2005] O.L.A.. no. 382, 142 L.A.C. (4th) 159. Cette affaire a plus tard été citée dans une autre décision selon laquelle le fait d’offrir des présents de nature religieuse (p. ex., des stylos portant une inscription religieuse) en milieu de travail n’est pas un droit protégé, même si la possibilité de le faire était extrêmement importante pour l’auteure du grief. Aucune preuve n’indiquait que cette activité faisait partie de sa religion en tant que chrétienne régénérée; Ontario Public Service Employees Union v. Ontario (Ministry of Community and Social Services) (Barillari Grievance), [2006] O.G.S.B.A. No. 176, 155 L.A.C. (4th) 292.
[49] Assal v. Halifax Condominium Corp. No. 4 (2007), 60 C.H.R.R. D/101 (N.S. Bd. Inq.).
[50] Whitehouse v. Yukon (2001), 48 C.H.R.R. D/497 (Y.T.Bd.Adj.).
[51] Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, supra note 18.
[52] R. v. Badesha, supra note 11. Au cas où il aurait eu tort de conclure qu’il n’y avait pas eu atteinte à l’alinéa 2 (a) de la Charte, le juge a également considéré l’article 1 de la Charte pour conclure que la loi sur le port obligatoire du casque protecteur était justifiée. Le juge a souligné, en se fondant sur la décision Hutterian Bretheren, que les analyses applicables à un code de droits de la personne portant sur le devoir d’adaptation et le préjudice excessif ne s’appliquent pas à une analyse de l’article 1 portant sur l’allégation qu’une loi contrevient à la Charte.
[53] Au contraire, voir l’affaire Multani, infra note 121, dans laquelle le tribunal a conclu que l’interdiction du kirpan entravait l’exercice de la liberté de religion pour le requérant d’une façon qui n’était pas négligeable ou insignifiante puisqu’elle le privait du droit de fréquenter une école publique.
[54] Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, [2001] 1 R.C.S. 772.
[55] R. v. Big M, supra note 36, par. 123.
[56] Amselem, supra note 15, par. 69.
[57] Il importe de souligner que les décisions publiées ne représentent que quelques-unes des allégations qui sont faites puisque de nombreuses causes relatives aux droits de la personne sont réglées entre les parties avant qu’une audience ne soit tenue.
[58] 2010 HRTO 1434 (CanLII).
[59] Aucun recours n’a été ordonné dans cette décision puisque le tribunal doit procéder à la deuxième étape de l’audience pour déterminer si les intimés avaient eu raison d’appliquer la Loi sur la santé et la sécurité au travail comme ils l’ont fait et s’ils ont tenu compte de leur obligation de prendre des mesures d’adaptation.
[60]L.R.O. 1990, chap. O.1.
[61] 2008 AHRC 3 (CanLII).
[62] 2009 HRTO 351 (CanLII).
[63] 2008 BCHRT 293; demandes de révision judiciaire rejetées Kinexus Bioinformatics Corporation v. Asad, 2010 BCSC 33 (CanLII).
[64] Voir également Dastghib v. Richmond Auto Body Ltd. (No. 2) (2007), 60 C.H.R.R. D/167, 2007 BCHRT 197. Un homme né et élevé dans la religion musulmane et dont le pays d’origine était l’Iran a été victime de discrimination fondée sur la race, la couleur et la religion. Le tribunal de la C.-B. a souligné les conséquences particulières des insultes survenues après les événements du 11 septembre : « À mon avis, les références à Bin Laden et à Hussein, dans le contexte du 11 septembre, et la manière dont ces deux personnes étaient représentées dans les médias, nous mèneraient à conclure qu’une personne était comparée à l’auteur de massacres, à un dictateur ou à un terroriste. Surtout aux lendemains du 11 septembre, de telles remarques proférées contre une personne musulmane ou venant du Moyen‑Orient sont extrêmement blessantes, elles constituent une insulte raciste et sont donc discriminatoires » (par. 212) [notre traduction].
[65] 2007 HRTO 12, par. 48 (CanLII).
[66] (1999), 37 C.H.R.R. D/252 (B.C.H.R.T.).
[67] Supra, note 11.
[68] Supra, note 19.
[69] 2011 BCHRT 183 (CanLII).
[70] 2008 BCHRT 36 (CanLII).
[71] 2010 HRTO 265 (CanLII).
[72] (2002), 43 C.H.R.R. D/395, 2992 BCHRT 23.
[73] (2005), 53 C.H.R.R. D.213 (N.S. Bd.Inq.).
[74] McGuire v. Better Image Property Maintenance Inc. (2006), CHRR Doc. 06-744, 2006 BCHRT 544.
[75] Awan v. Loblaw Co., 2009 HRTO 1046.
[76] Banwait v. Forsyth (No. 2) (2008), CHRR Doc. 08-118, 2008 BCHRT 81.
[77] En Ontario, depuis le 30 juin 2008, les personnes qui estiment avoir été victimes de discrimination ou de harcèlement peuvent déposer une requête directement auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. Le Tribunal est tenu de tenir une audience pour chaque requête déposée qui relève de sa compétence. Auparavant, les plaintes de discrimination étaient déposées auprès de la Commission et cette dernière déterminait, après une enquête, s’il y avait suffisamment de preuves pour renvoyer l’affaire à une audience du Tribunal. Par suite de ce système à « accès direct », on a vu, ces dernières années, un plus grand nombre de causes dans lesquelles la discrimination fondée sur la croyance a été alléguée mais non prouvée dans le cadre d’une audience.
[78] S.L., supra note 41, par. 17.
[79] Supra note 36.
[80] [1986] 2 R.C.S. 713.
[81] Zylberberg v. Sudbury Board of Education, 1988 CanLII 189 (ON C.A.).
[82] Ibid., pages 22-24. Suivant l’affaire Zylberberg, la Cour d’appel de l’Ontario a considéré un règlement qui visait à intégrer au programme d’études des écoles des périodes obligatoires d’éducation religieuse; Canadian Civil Liberties Assn. v. Ontario (Minister of Education) (1990), 71 O.R. (2d) 341. La Cour a soutenu que le règlement avait pour objet et pour effet de permettre l’endoctrinement religieux, ce qui est contraire à la Charte. Un tel endoctrinement n’était pas raisonnablement lié à l’objectif éducatif d’inculquer des normes morales appropriées. Cependant, la Cour a observé qu’un programme offrant un enseignement au sujet de la religion et des valeurs morales sans chercher à endoctriner les élèves dans une foi particulière ne contreviendrait pas à la Charte. Cette interprétation a été par la suite confirmée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt S.L., supra note 41.
[83] 2004 CanLII 13978 (ON S.C.).
[84] Il semble que l’une des principales oppositions soit fondée sur la perception que le matériel didactique dépeint toutes les religions comme étant également valables et qu’il enseigne aux enfants que toutes les croyances religieuses et tous les codes moraux sont d’égale valeur. Voir par exemple le site Web de Catholic Insight : http://catholicinsight.com/online/church/education/article_877.shtml et le document Evangelical Fellowship of Canada Frequently Asked Questions and Answers. à http://files.efc-canada.net/si/Education/LavalleeQA.pdf.
[85] 2009 QCCS 3875 (CanLII). Dans une affaire connexe, un autre juge de la Cour supérieure est arrivé à une autre conclusion; Loyola High School c. Courchesne, 2010 QCCS 2631 (CanLII). Une école secondaire catholique dirigée par des Jésuites a demandé l’autorisation d’enseigner le programme d’une perspective catholique. Le ministère de l’Éducation a refusé la demande. Le juge a conclu que le refus du ministère portait atteinte à la liberté de religion de l’école aux termes de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Le ministère a interjeté appel de cette décision à la Cour d’appel du Québec. Cependant, il n’est pas certain que les différences entre les contestations du programme ÉCR faisant l’objet des affaires Loyola et S.L. mèneront à une issue différente lorsque l’appel sera entendu dans l’affaire Loyola.
[86] [2002] 4 R.C.S. 710.
[87] Alors que S.L. était une contestation fondée sur la Charte concernant la liberté de religion, les questions soulevées pourraient avoir été présentées sous l’angle des droits de la personne, en particulier une demande d’adaptation pour tenir compte des droits relatifs à la croyance.
[88] Voir également Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 R.C.S. 698.
[89] Dans Lapcevic v. Pablo Neruda Non-Profit Housing Corporation, 2010 HRTO 927 (CanLII), le TDPO a conclu que, même si une superviseure avait entamé des discussions sur la religion, donné une Bible à la requérante et lui a parlé du réconfort qu’apporte la religion dans des situations difficiles, la preuve n’était pas suffisante pour établir que la superviseure aurait dû savoir que cette conduite était importune. Dans ces circonstances, il n’y avait pas de pressions religieuses importunes sur l’employée. Dans les affaires Dufour et Streeter, infra, le Tribunal a aussi clairement souligné que le seul fait de discuter de religion ne contrevient pas au Code.
[90] Voir Dufour v. J. Rogers Deschamp Comptable Agréé (1989), 10 C.H.R.R. D/6153 (Ont. Bd.Inq.) et plus récemment Streeter v. HR Technologies, 2009 HRTO 841 (CanLII).
[91] VoirStreeter, ibid., par. 38.
[92] (2002), 43 C.H.R.R. D/425, 2002 BCHRT 27.
[93] En particulier, Mme Akiyama, qui est née et a grandi au Japon et dont les grands-parents et parents étaient shintoïstes, s’opposait à l’obligation de s’incliner devant des objets inanimés parce qu’elle n’acceptait pas qu’il y ait un dieu dans un objet et qu’elle était convaincue qu’il était absurde de s’incliner devant des objets.
[94] Aux paragraphes 68 et 69.
[95] [1995] 1 CF 158.
[96] La décision précise que Anishnawbe est un organisme de services de santé situé à Toronto qui offre des services de santé principalement aux membres de la communauté autochtone de Toronto.
[97] La principale raison de cette conclusion reposait sur le caractère vague de la preuve de la requérante sur l’antipathie ressentie à l’égard des autochtones catholiques. De plus, le témoin qui corroborait cette allégation ne pouvait se rappeler aucune conversation précise ni donner de détails pour appuyer sa perception, et la crédibilité de la requérante soulevait des doutes. Il y avait aussi des preuves qui contredisaient l’allégation que le directeur général avait ressenti de l’antipathie à son endroit lorsqu’il avait appris qu’elle était catholique, car elle avait reçu par la suite une évaluation positive de son rendement.
[98] [2007] 3 R.C.S. 607.
[99] La Cour suprême a cité un arrêt antérieur : « Une fois que le tribunal se déclare compétent pour connaître d’un litige comportant des aspects religieux, a‑t‑il ajouté, il doit s’efforcer "d’arriver à la meilleure compréhension possible de la tradition et de la coutume applicable" »; Bruker c. Marcovitz, ibid., par. 45 citant Lakeside Colony of Hutterian Brethren c. Hofer, [1992] 3 R.C.S. 165, p. 191.
[100] Il est à noter que l’Ontario a adopté des mesures législatives sur les questions que soulève l’arbitrage familial fondé sur une religion. L’arbitrage familial traite habituellement de la division des biens; de la garde des enfants et des droits de visite; des aliments en faveur de la conjointe/du conjoint et des enfants après la rupture d’un mariage. À la suite des modifications apportées en 2006 à la Loi de 1991 sur l’arbitrage et à la Loi sur le droit de la famille, seul l’arbitrage mené exclusivement aux termes des lois canadiennes peut donner lieu à un règlement exécutoire. L’arbitrage familial mené en vertu de lois religieuses, bien qu’il ne soit pas interdit, n’a donc aucun effet juridique et aucun tribunal ne peut forcer l’exécution de tout règlement en découlant.
[101] Par exemple, il a allégué qu’on l’a interrogé au cours de sa formation et de sa préparation au sacerdoce au sujet de son niveau d’aisance à s’occuper d’une congrégation « entièrement blanche ».
[102] Thavarajasoorier v. Incorporated Synod of the Diocese of Toronto, 2009 HRTO 314 (CanLII). Cependant, le tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique est arrivé à une conclusion contraire au sujet des services aux termes du code de la C.-B., qui établit que les services doivent être offerts de manière courante au public. Un temple Sabha (qui mène des cérémonies religieuses et favorise la fraternité parmi ses membres et les visiteurs) a été considéré comme étant strictement une organisation privée qui pouvait limiter l’adhésion à des personnes d’une communauté ou d’une caste particulière. Le tribunal a donc considéré que la question en litige n’était pas de son ressort puisque l’adhésion en tant que membre du Sabha n’est pas un service offert de manière courante au public. Voir Sahota and Shergill v. Shri Guru Ravidass Sabha Temple, 2008 BCHRT 269 (CanLII).
[103] 2008 HRTO 162 (CanLII).
[104] (2005), 56 C.H.R.R. D/306, 2005 BCHRT 56.
[105] Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, supra note 16; Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud, supra note 16; Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin 1994 CanLII 102 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 525 (CSC).
[106] 2009 HRTO 409 (CanLII).
[107] Un employeur qui a avisé un employé qu’il n’autoriserait aucun congé pour des fêtes religieuses et qui l’a congédié pour une absence non autorisée en pareil jour a été trouvé coupable d’avoir enfreint le code de la C.-B.; Derksen v. Myert Corps. Inc. (No. 2) (2004), 50 C.H.R.R. D/109. Aucune preuve n’indiquait que l’employeur avait fait le moindre effort pour offrir une mesure d’adaptation à l’employé.
[108] 2010 HRTO 205 (CanLII).
[109] L’employé avait donné un préavis d’environ 72 heures et l’employeur avait ordinairement autorisé le congé lorsqu’il avait reçu un avis suffisant. Malheureusement, le tribunal n’a pas examiné pourquoi l’employeur n’aurait pu trouver de remplacement ni comment l’employeur traitait habituellement les absences imprévues.
[110] Ultérieurement, la Cour suprême a considéré la situation d’un employé, membre de l’Église universelle de Dieu, à qui on a refusé de prendre un congé sans solde pour raison religieuse le lundi de Pâques. L’employeur a soutenu que le lundi était un jour particulièrement occupé à l’usine. La Cour a conclu qu’il n’y avait pas d’obstacle important empêchant de fournir une adaptation à l’égard des besoins religieux de l’employé en lui permettant de s’absenter un seul lundi; Central Alberta Dairy Pool, supra note 21.
[111] Roosma v. Ford Motor Co Ltd., 2001 CanLII 26211 (ON HRT), confirmation de la décision Ontario (Human Rights Commission) v. Roosma, 2002 CanLII 15946 (ON SCDC).
[112] 2000 CanLII 16854 (ON CA).
[113] 2008 HRTO 64 (CanLII).
[114] Supra note 22.
[115] York Region District School Board v. Ontario Secondary School Teachers’ Federation, District 16 (Faith Day Grievance), [2008] O.L.A.A. No. 442, 176 L.A.C. (4th) 97.
[116] Shapiro v. Peel (Regional Municipality)(No. 2) (1997), 30 C.H.R.R. D/172 (Ont. Bd. Inq.). Le fait que l’employeur insiste pour que Mme Shapiro utilise des jours de vacances, des congés compensatoires ou qu’elle prenne un congé sans solde pour des fêtes juives était discriminatoire. La proposition de Mme Shapiro de travailler des heures supplémentaires pour compenser était raisonnable et aurait pu être acceptée sans entraîner de préjudice injustifié. Le fait que le temps supplémentaire n’était pas offert à tous les employés n’est pas pertinent puisque les mesures d’adaptations sont fondées sur une évaluation individualisée et qu’il n’est pas nécessaire d’offrir la même mesure d’adaptation à tous les employés.
[117] [1985] 2 R.C.S. 561.
[118] (1999), 35 C.H.R.R. D/293 (B.C.H.R.T.).
[119] Le tribunal a décrit ainsi les responsabilités d’un opérateur à la caustification : « La zone de caustification est bruyante, sent mauvais et est très chaude. Elle peut également être dangereuse. C’est là que les gaz toxiques venant de toute l’usine sont acheminés par tuyaux pour y être brûlés dans des fours de caustification chauffés à 2 000 degrés. M. Pannu est responsable de cette zone. Son travail comporte le risque qu’il soit appelé à arrêter toutes les machines de la zone de caustification s’il advenait une fuite de gaz toxique, demeurant dans la zone alors que les autres évacuent les lieux. » [notre traduction]
[120] (1991), 14 C.H.R.R. D/403.
[121] [2006] 1 R.C.S. 256.
[122] (1999), 36 C.H.R.R. D/76 (Can. Trib.). Nota :cette affaire a été tranchée avant que des règles de sécurité encore plus strictes n’entrent en vigueur à la suite des événements du 11 septembre.
[123] [1985] 3 W.W.R. 256 (Man. Q.B.), confirmé [1986] 3 W.W.R. 671 (Man. C.A.).
[124] 2009 HRTO 1627.
[125] Supra note 37.
[126] Ibid., par. 68.
[127] Tahmourpour v. Royal Canadian Mounted Police (2008), 64 C.H.R.R. D/448, 2008 CHRT 10. La majorité des allégations portaient sur des actes de discrimination plus graves et systémiques contre les candidats appartenant à une minorité.
[128] Le procureur général de l’Alberta a admis que les membres de la colonie avaient des croyances religieuses sincères qui étaient en conflit avec l’obligation de se faire photographier. Cependant, il n’a pas admis que l’obligation de se faire photographier entravait les droits religieux d’une manière qui était plus que négligeable ou insignifiante. L’arrêt représentant l’avis de la majorité soulignait que pour faire une telle détermination, il faudrait des preuves montrant que « des croyances ou un comportement d’ordre religieux pourraient être raisonnablement ou véritablement menacés » par l’obligation de se faire photographier. La preuve portant sur le coût ou le fardeau imposé par l’État ne suffit pas; il faudrait une preuve établissant que ce fardeau est « susceptible de porter atteinte à une croyance ou pratique religieuse ». Toutefois, les juridictions inférieures semblent avoir considéré que cette condition était remplie. Devant ce postulat, la majorité ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si, à son avis, la condition avait été satisfaite, mais a plutôt mis l’accent sur l’analyse relative à l’art. 1. Comme nous l’avons déjà dit dans le présent document, ceci semble indiquer que la définition de ce qui constitue une atteinte qui n‘est pas négligeable et insignifiante reste ouverte à interprétation.
[129] 407 ETR Concession Company v. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada, CAW-Canada, 2007 CanLII 1857 (ON LA).
[130] Par. 177.
[131] (1988), 9 C.H.R.R. D/4947 (Nfld. Comm. Inq.).
[132] (2001), 39 C.H.R.R. D/93, 2001 BCHRT 1.
[133] Re Peterborough Civic Hospital and Ontario Nurses’ Association, [1981] O.L.A.A. No. 97, 3 L.A.C. (3d) 21 [QL].
[134] L’infirmière acceptait d’exécuter de nombreuses autres étapes de la procédure : consigner les signes vitaux du patient, insérer l’aiguille de transfusion, faire couler la solution saline dans la veine, commander le sang du laboratoire et l’apporter à la chambre du patient, entrer les données au registre et effectuer les vérifications requises. Elle n’était pas disposée à « suspendre le sang », ce qui consiste à ouvrir le sac contenant le sang, à y insérer le tube de transfusion, à fermer la valve de solution saline, à ouvrir la valve de sang et à accrocher le sac au support de transfusion. Suspendre le sang prend moins de 30 secondes.
[135] La Cour suprême du Canada a également traité de l’opposition des témoins de Jéhovah, pour des motifs religieux, à des transfusions sanguines pouvant sauver la vie dans une cause traitant du refus par les parents d’une transfusion sanguine pour leur très jeune enfant et une autre cause visant à déterminer à quel âge un enfant a la maturité voulue pour refuser une transfusion sanguine. Ces décisions sont abordées dans la section CONCILIATION DU DROIT DE CROYANCE ET D’AUTRES DROITS.
[136] Supra note 72.
[137] Supra note 17.
[138] Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, supra note 88; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, p. 877; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668, par. 61.
[139] Mills, ibid.; Trinity Western, supra note 54, par. 29; S.L., supra note 41.
[140] Mills, ibid.; Dagenais, supra note 139.
[141] Mills, ibid., par. 17, 21 et 61; Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, supra note 88, par. 50 et 52; l’honorable juge Franck Iacobucci, « Reconciling Rights: the Supreme Court of Canada’s Approach to Competing Charter Rights » (2003) 20 S.C.L.R. (2d) 137, pages 140, 141 et 159; R. v. N.S., supra note 37, par. 48.
[142] Dans Bothwell v. Ontario (Minister of Transportation), supra note 45, le tribunal a conclu que le requérant n’avait pas réussi à démontrer que son opposition à la prise d’une photo numérique pour son permis de conduire était liée à ses croyances religieuses. La preuve indiquait que le requérant avait soulevé un certain nombre d’inquiétudes portant davantage sur la protection de la vie privé que sur des questions religieuses et que ses actions n’étaient pas compatibles avec les croyances religieuses qu’il professait.
[143] Syndicat Northcrest c. Amselem, supra note 15, par. 84; Bruker c. Marcovitz, supra note 99.
[144] [1993], 4 R.C.S. 3. Dans une affaire jugée au même moment, la Cour a maintenu l’interdiction pour le parent ayant un droit de visite de continuellement endoctriner son enfant dans la religion des témoins de Jéhovah car la majorité des juges avait accepté l’opinion du juge de première instance que cette interdiction était nécessaire pour protéger l’intérêt véritable de l’enfant; P.(D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S.141.
[145] Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau‑Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825.
[146] Ibid., par. 72.
[147] [1986] 1 R.C.S. 103.
[148] Ross, supra note 148, par. 94.
[149] [1995] 1 R.C.S. 315.
[150] Dans un arrêt récent, A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l'enfant et à la famille), [2009] 2 R.C.S. 181, la Cour suprême a considéré le droit d’une adolescente de 14 ans qui est témoin de Jéhovah, de refuser une transfusion sanguine pouvant lui sauver la vie. Les dispositions de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille du Manitoba, sur lesquelles s’était fondé le directeur des services à l’enfant et à la famille pour appréhender l’adolescente à titre d’enfant ayant besoin de protection et de demander une ordonnance pour autoriser les transfusions sanguines, étaient constitutionnelles. Le critère de « l’intérêt » de l’enfant devrait être interprété d’une façon qui accorde une importance croissante aux volontés religieuses de l’enfant en fonction de son niveau de maturité. Cette approche est une réponse proportionnée visant à concilier de manière équilibrée les droits religieux de l’enfant et les objectifs de protection de l’enfance de l’État.
[151] Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau‑Brunswick, supra note 148; Brockie v. Brillinger (No. 2) (2002), 43 C.H.R.R. D/90 (Ont. Sup.Ct.), par. 51-56.
[152] 2011 SKCA 3 (CanLII).
[153] (2005), 55 C.H.R.R. D/10, 2005 BCHRT 544.
[154] La Cour a modifié l’ordonnance de la commission pour tenir compte de cette possibilité en ajoutant à l’ordonnance de la commission exigeant que M. Brockie fournisse des services d’impression aux gais et lesbiennes et aux organismes de gais et lesbiennes : « pourvu que celà n’oblige pas M. Brockie ou Imaging Excellence à imprimer du matériel dont la nature pourrait raisonnablement être considérée comme étant en conflit direct avec les éléments fondamentaux de ses croyances religieuses ou de sa croyance. » [notre traduction]
[155] Supra note 86.
[156] R. v. N.S., supra note 37, par. 84.
[157] 2011 HRTO 639 (CanLII).
[158] [1996], 3 R.C.S. 609.
[159] Un examen détaillé de la jurisprudence portant sur les droits des écoles séparées dépasse la portée du présent document.
[160] Daly, et al v. Attorney General of Ontario, 1999 CanLII 3715 (ON CA).
[161] Hall (Litigation guardian of) v. Powers, 2002 CanLII 49475 (ON SC).
[162] L’article 93 avait pour objet de préserver et de protéger les écoles confessionnelles et était un élément fondamental du compromis ayant permis l’établissement de la Confédération.
[163] Hall v. Durham Catholic District School Board, 2005 CanLII 23121 (ON SC).
[164] Caldwell et autres c. Stuart et autres, [1984] 2 R.C.S. 603.
[165] [1984] 2 R.C.S. 603.
[166] Supra, note 102.
[167] 2010 ONSC 2105 (CanLII).
[168] Ibid., par. 71.
[169] Voir cependant Schroen v. Steinbach Bible College (1999), 35 C.H.R.R. D/1, affaire dans laquelle le Manitoba Board of Adjudication a rejeté la plainte d’une femme congédiée de son travail pour des motifs religieux. Une femme qui avait été embauchée comme préposée à la comptabilité au Mennonite College a été congédiée deux jours plus tard lorsque des dirigeants du collège ont appris qu’elle appartenait à l’Église mormone et non à l’Église mennonite. Le conseil d’arbitrage a conclu que le collège fonctionne comme une communauté aux liens très étroits, au sein de laquelle les membres du personnel sont appelés à interagir avec les étudiants, à assister aux assemblées de prière et aux activités du collège, à inviter les étudiants chez eux pour des séances d’étude de la Bible et à être en mesure de discuter de questions de foi avec les élèves, et que l’exigence qu’ils acceptent et observent les préceptes de la foi mennonite était une exigence professionnelle raisonnable et de bonne foi.