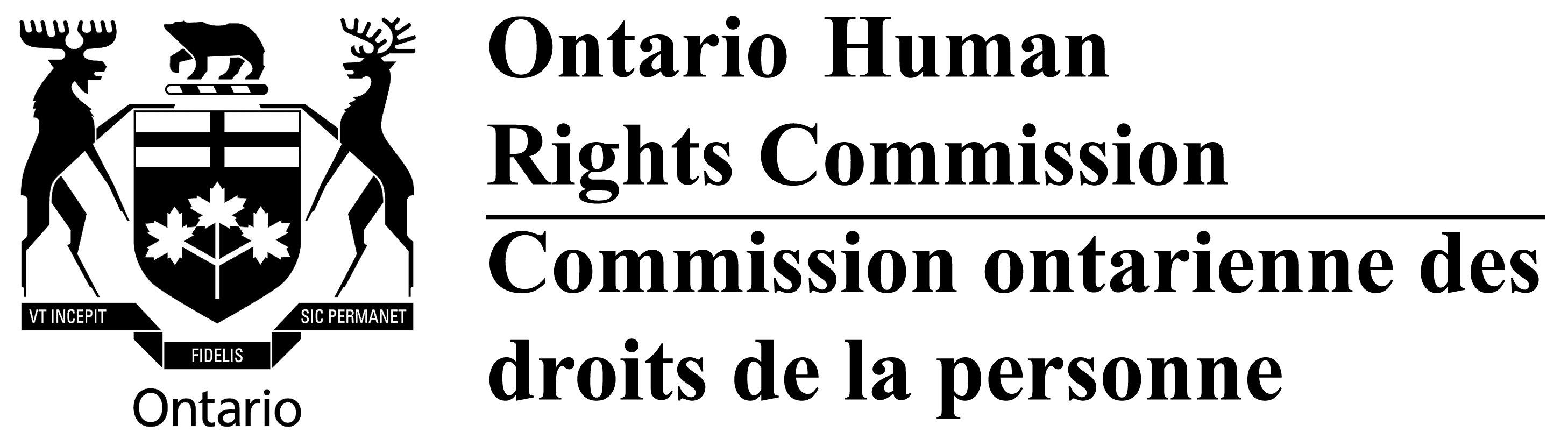BATES C. ZURICH
Jusqu’ici, l’une des décisions les plus influentes jamais rendues à propos de la qualité des assurances et du code a été la décision majoritaire de la Cour suprême du Canada dans Bates c. Zurich[3] relativement au test du motif « justifié de façon raisonnable et de bonne foi » aux termes de l’article 22 du Code (article 21 au moment du dépôt de la plainte). Cette décision est exécutoire par l’ensemble des cours et tribunaux d’instance inférieure, et les commissions d’enquête ont également eu recours au test de l’article 22 dans les causes liées à l’emploi, conformément à l’article 25 du code[4].
La défense prévue dans l’article 22 du Code permet aux compagnies d’assurance de faire des distinctions dans les polices d’assurance individuelles et les polices d’assurance-groupe non liées à l’emploi, en fonction de l’âge, du sexe, de l’état matrimonial, de l’état familial ou d’un handicap, mais uniquement si ces distinctions sont établies pour des motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi.
La cour devait décider si Zurich Insurance avait rendu Michael Bates victime de discrimination en lui demandant de payer des primes plus élevées pour son assurance-automobile en raison de son âge, de son sexe et de son état matrimonial.
La décision majoritaire
La Cour a établi qu’une pratique était de bonne foi si elle était adoptée de façon honnête, dans les intérêts de pratiques commerciales solidement fondées et reconnues, et non dans le but de porter atteinte aux droits protégés par le Code. Il ne faisait aucun doute que Zurich avait agi de bonne foi au moment d’établir ses primes d’assurance.
Le jugement portait sur l’application du test des « motifs justifiés de façon raisonnable » aux faits en cause. La Cour était d’avis qu’une pratique discriminatoire était « raisonnable » si:
- elle suivait une pratique d’assurance solidement fondée et reconnue;
- il n’existait aucune autre solution praticable.
En ce qui concerne le premier volet du test, une pratique d’assurance solidement fondée et reconnue était définie comme étant adoptée « pour atteindre l’objectif commercial légitime d'imposer des primes proportionnelles au risque ».
La majorité des juges ont décidé que la décision de Zurich lors de l’établissement des primes était étayée sur les preuves actuarielles crédibles dont elle disposait au moment de la plainte. Il s’agissait d’une corrélation statistique entre l’âge, le sexe et l’état matrimonial d’une part, et les pertes d’assurance d’autre part, d’où il se dégageait que les jeunes conducteurs de sexe masculin avaient plus d’accidents que les autres conducteurs.
La Cour s’est alors demandée s’il existait une autre solution pouvant être mise en œuvre au moment de la plainte. Or, elle a décidé qu’en 1983, Zurich n’avait d’autre choix que de fixer les primes en fonction de l’âge, du sexe et de l’état matrimonial. La Cour estimait qu’il ne serait pas raisonnable d’exiger que Zurich établisse les primes au jugé au lieu de se fier à des données statistiques valides, mais discriminatoires.
La Cour a toutefois bien montré que l’industrie des assurances ne devait pas continuer indéfiniment à s’appuyer sur des critères discriminatoires pour déterminer ses taux. Elle a décidé, en fonction de la preuve présentée, que trois années seraient nécessaires pour recueillir des statistiques valables. La Cour a également déclaré que l’industrie « doit chercher à éviter de fixer des primes fondées sur des motifs interdits ».
Opinions dissidentes
Deux juges auraient voulu trancher en faveur de la Commission, et elles ont présenté plusieurs arguments compatibles avec une interprétation large, libérale et délibérée des lois sur les droits de la personne :
- Les parties intimées ne doivent pas avoir le droit de justifier de pratiques discriminatoires en invoquant la tradition. Cinquante années de tarification discriminatoire n’excusent rien.
- Une corrélation statistique ne suffit pas à justifier le caractère discriminatoire d’une pratique. Il doit y avoir une corrélation causale.
- Il existait une solution de rechange raisonnable. Les primes des conducteurs de plus de 25 ans étaient calculées en fonction de la distance parcourue et des antécédents d’accidents. Pourquoi ne pas utiliser ces critères pour les conducteurs de moins de 25 ans?
- L’absence de statistiques sur un autre genre de barème ne signifie pas qu’il n’existe aucune solution de rechange.
Répercussions
L’application par la Cour du test des motifs justifiés de façon raisonnable met en lumière le respect de la tradition établie dans l’industrie des assurances par la majorité des juges. Les compagnies d’assurance intimées n’auront aucun mal à se prévaloir de l’argument que leurs pratiques commerciales sont solidement fondées et reconnues dans l’industrie. Or, l’argument de la tradition n’est pas une défense acceptée dans d’autres types de plaintes relatives aux droits de la personne. On peut également dire que les attitudes et comportements discriminatoires ne changeraient jamais s’il suffisait que les parties intimées invoquent la tradition pour se justifier de leurs actes.
Cela dit, la Commission devra considérer la preuve statistique dont dispose l’industrie des assurances au moment d’une plainte. Comme l’ont fait remarquer néanmoins les juges dissidentes, ce n’est pas parce qu’une compagnie d’assurance ne dispose pas de ses propres statistiques qu’elle peut affirmer qu’il est impossible de trouver des statistiques à jour et non discriminatoires.
Les observations de la Cour relativement à une autre solution pratique et raisonnable signifient que l’industrie des assurances aurait pu élaborer pour l’assurance-automobile un nouveau système fondé sur des critères non discriminatoires. À ce jour, l’industrie n’a pas encore mis au point de nouveau système pour l’assurance-automobile. Une plainte similaire dans ce domaine connaîtrait peut-être maintenant un sort tout à fait différent. La Cour suprême a clairement affirmé que l’industrie des assurances devait œuvrer à l’élaboration de critères non discriminatoires pour évaluer le risque. Le système existant de classification discriminatoire n’est peut-être plus conforme au test d’une pratique solidement fondée et reconnue dans le domaine des assurances.
ASSURANCE-AUTOMOBILE
Le moyen de défense prévu par l’article 22 du Code comprend l’assurance-automobile, où il est possible de faire des distinctions fondées sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap, mais ces distinctions doivent être fondées sur des motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi.
À l’heure actuelle en Ontario, l’évaluation du risque dans le domaine de l’assurance-automobile se fait partiellement en fonction de l’état familial, de l’état matrimonial, de l’âge et du sexe, et les plaintes touchant une discrimination fondée sur ces motifs risquent fort de se poursuivre.
Plusieurs scénarios tenant compte de l’état matrimonial ou de l’état familial peuvent sembler produire un traitement discriminatoire. À titre d’exemple, les enfants du conducteur principal d’une famille peuvent être cotés comme des conducteurs occasionnels. À un moment donné, les filles des titulaires de police étaient incluses sans frais, alors que ce n’était pas le cas des fils. À l’heure actuelle, les enfants de sexe féminin ne bénéficient plus de la gratuité. On perçoit des frais supplémentaires pour les conducteurs occasionnels, quel que soit leur sexe, mais le taux imposé aux hommes est parfois plus élevé que celui payé par les femmes.
Si le permis d’un membre d'un ménage a été suspendu, le partenaire ou la partenaire se verra sans doute imposer une prime plus élevée. En effet, la compagnie d’assurance peut décider qu’il existe un risque que le conducteur suspendu se mette tout de même au volant, et elle augmentera alors la prime de son partenaire en fonction de l’évaluation qu’elle fait du risque.
En vertu de la Loi sur les assurances, la CSFO passe en revue toutes les demandes et le surintendant les approuve si elles satisfont aux normes statutaires concernant la classification du risque et des taux. Les assureurs ont le droit de demander une audience si l’approbation n’est pas accordée, et le surintendant en ordonne une si cela relève de l’intérêt public.
L’audience de la CAO (la CSFO)
En 1997, l’ancienne Commission des assurances de l’Ontario (CAO) a reçu la demande d’un assureur qui proposait un nouveau système de classification du risque et un barème des taux fondé sur des critères qui n’étaient pas directement liés au dossier de conduite. Un document d’information préparé par le personnel de la CAO affirmait que plusieurs éléments du système de classification proposé n’étaient ni justes, ni raisonnables, et qu’ils ne faisaient pas clairement la distinction entre les risques en raison de leurs répercussions sur la politique sociale. Cette position ne reflète pas nécessairement la position passée ou présente de la CAO (remplacée depuis lors par la CSFO). La CAO a rejeté la demande, et selon l’exigence de la Loi sur les assurances, elle a organisé une audience à ce sujet.
L’assureur a fini par retirer sa demande avant même le début de l’audience. Toutefois, la Commission ontarienne des droits de la personne a soumis des observations à la CAO (voir annexe). La Commission y déclare que certains facteurs de classification du risque d’après le système proposé par l’assureur, soit la possession d’une carte de crédit, les faillites éventuelles, la situation professionnelle, la stabilité de l’emploi, de même que la situation et la stabilité résidentielles, risquent d’enfreindre la partie I du code, en raison de l’exigence liée à l’état matrimonial. Par ailleurs, la Commission craignait que de tels critères aient un effet négatif sur les femmes, les jeunes et des immigrés récents.
La Commission affirme également qu’il n’est pas sûr qu’une commission d’enquête ou un tribunal trouverait que le système de classification du risque proposé par l’assureur « est conforme à une pratique commerciale solidement fondée et reconnue dans le domaine des assurances », telle qu’elle est définie dans l’arrêt Zurich. Il est également douteux qu’on décide qu’il « n’existe aucune autre solution pratique » à la proposition de l’assureur.
D’autre part, la Commission déclare que d’après elle, l’arrêt Zurich signifie que l’industrie des assurances peut passer outre à certains motifs aux termes de la partie I du Code si elle est capable de montrer, conformément à l’article 22, qu’une telle pratique est adoptée aux fins de remplir « l’objectif commercial légitime d'imposer des primes proportionnelles au risque ». La Cour a toutefois clairement déclaré que l’industrie des assurances ne devait pas indéfiniment continuer à avoir recours à des critères discriminatoires pour établir ses barèmes de taux, puisqu’elle « doit chercher à éviter de fixer des primes fondées sur des motifs interdits ». Lorsqu’on rapproche ces deux volets de l’arrêt Zurich, on peut en tirer l’argument que tout nouveau système de classification proposé, même s’il s’agit en fin de compte d’un meilleur test d’évaluation du risque, doit au moins éviter d’enfreindre la partie I du Code davantage qu’aucun système de classification actuel. D’ailleurs, le nouveau système proposé devrait tâcher d’éviter de déterminer le risque en fonction des motifs interdits.
Sans tenir compte de la décision majoritaire dans Zurich et de l’exception prévue à l’article 22 conformément au Code, la CAO semble avancer une interprétation différente de ce qu’on peut appeler des tests de classification du risque fondés sur « des motifis justifiés de façon raisonnable » et « de bonne foi ». Le document d’information de la CAO contenait une opinion similaire à celle émise par les deux juges dissidentes dans Zurich. Ces juges ont décidé qu’une corrélation statistique ne suffisait pas à justifier le caractère raisonnable d’une pratique discriminatoire. Il doit en outre exister un lien de causalité.
Dans son Rapport final en réponse à la demande de l’assureur, la CAO a déclaré que toute nouvelle variable de classification du risque devait remplir l’ensemble des critères stipulés par la Loi sur les assurances (l’article 412.1 en particulier; voir annexe). Elle affirme également qu’en-dehors de la corrélation statistique, les critères de classification du risque doivent également faire une distinction équitable. Par ailleurs :
Un indicateur du caractère raisonnable d’un système de classification du risque est sa causalité, c.-à-d. que l’assuré devrait être capable de déduire de façon logique comment le taux qu’on lui impose a été calculé et de comprendre l’effet de ses antécédents de conduite sur celui-ci (Rapport final de la CAO, p.7).
La décision majoritaire dans Zurich ne repose pas sur un « lien de causalité », mais seulement sur une corrélation statistique qui est considérée comme suffisante pour justifier le caractère raisonnable d’une pratique commerciale discriminatoire. La position articulée dans le document de la CAO, soit qu’un automobiliste assuré devrait être capable de comprendre les répercussions de son dossier de conduite sur le taux de l’assurance, semble donc être un test plus strict du caractère raisonnable que celui qui se dégage de l’interprétation de l’article 22 du code dans l’arrêt Zurich.
Une plainte touchant l’assurance-automobile qui serait présentée de nos jours aurait peut-être une issue différente de celle de Zurich, car une commission d’enquête ou un tribunal ne considérerait pas seulement les solutions de rechange que l’industrie aurait à proposer aux critères discriminatoires traditionnels de la classification du risque, mais également la position articulée dans le document d’information de la CAO, à l’effet qu’il devrait exister un lien de causalité entre la classification du risque et le dossier de conduite.
Juridictions américaines
Il semble que dans certaines juridictions américaines, on n’utilise ni l’âge, ni le sexe, ni l’état matrimonial pour établir les taux de l’assurance-automobile. Le Massachusetts, par exemple, a recours à un régime d’assurance pour bons conducteurs, qui dépend du dossier de conduite et d’un système de points, et non de l’âge, du sexe ou de l’état matrimonial, sauf que les personnes de plus de 65 ans bénéficient d’une réduction.
INVALIDITÉ ET ASSURANCE
Le rapport de Baer intitulé Study Paper on the Legal Aspects of Long-Term Disability Insurance (supra) permet de jeter la lumière sur certaines notions et définitions dans le domaine de l’assurance-invalidité. Baer déclare qu’en Ontario, l’assurance-invalidité désigne un avenant souscrit dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, alors que l’assurance-accident et l’assurance-maladie constituent des termes plus génériques utilisés dans les contrats autres que ceux d’assurance-vie. De même, l’assurance-invalidité tombe sous le coup de deux parties différentes de la Loi sur les assurances. Baer est d’avis que cet état de choses ne sert plus à rien, et il recommande donc que toute l’assurance-invalidité, souscrite ou non dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, soit régie par un ensemble de règles statutaires.
D’autre part, Baer utilise le terme d’« assurance-invalidité » pour désigner toute assurance conçue pour remplacer le revenu ou pour compenser les pertes d’exploitation, en la distinguant de l’assurance conçue pour couvrir les frais médicaux.
Baer fait remarquer que la Loi sur les assurances ne fait pas aucune distinction entre les invalidités de courte et de longue durée, contrairement à l’industrie et aux tribunaux canadiens. Les prestations de courte durée font souvent partie du régime de congés de maladie de l’employeur et ne sont pas comprises dans l’invalidité de longue durée. Toutefois, les polices d’assurance-invalidité de groupe combinent souvent des garanties professionnelles de courte durée et de longue durée. « Ainsi, pour recevoir les prestations de courte durée, les bénéficiaires doivent être atteints d’une invalidité qui les empêche de s’acquitter de leurs fonctions habituelles, mais pour recevoir des prestations de longue durée, c’est n’importe quel travail qu’ils doivent être dans l’incapacité d’effectuer. »
Baer affirme également que la Loi sur les assurances fait une distinction entre les contrats d’assurance-invalidité individuels et de groupe, et que les conditions statutaires ne s’appliquent pas aux polices d’assurance-invalidité de groupe. Et pourtant, l’assurance-invalidité relève le plus souvent de polices de groupe souscrites par des employeurs ou des organismes.
Il affirme également que dans la plupart des cas, « l’assurance-invalidité (surtout les polices de groupe) est vendue à un taux minime voire nul. Cela veut dire que tous les membres d’un organisme peuvent être acceptés dans un régime de groupe, le fait d’appartenir au groupe servant d'indice général de bonne santé. Une fenêtre limitée d’adhésion au régime sert aux assureurs à se préserver contre le risque de sélection adverse. Ce risque est aussi réduit par différentes exclusions figurant dans la police (en particulier, l'exclusion concernant une condition médicale préalable). »
Moyens de défense conformément à l’article 25(3)
L’article 25(3) prévoit deux moyens de défense pour les compagnies d’assurance et les employeurs qui refusent d’assurer un employé en raison d’un handicap préexistant :
- L’article 25(3)(a) permet à d’autres régimes d’assurance-vie ou d’assurance-invalidité des employés de faire des distinctions entre invalidités, pourvu qu’elles soient justifiées de façon raisonnable et de bonne foi, qu’elles soient liées à un handicap préexistant et que le handicap augmente considérablement le risque.
- Dans les polices d’assurance-groupe souscrites en vertu de article 25(3)(b) pour les entreprises comptant moins de 25 employés et dans les régimes entièrement financés par les employés, il est possible de faire des distinctions fondées sur l’invalidité, pourvu que ce soit de façon raisonnable et de bonne foi et que la distinction vise un handicap préexistant.
Pour monter une bonne défense conformément à l’article 25(3)(a), la partie intimée doit réussir à démontrer que :
- la distinction vise un handicap préexistant;
- le handicap exclu aurait entraîné une augmentation considérable du risque;
- la distinction est fondée sur des motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi.
L’article 25(3)(b) est plus facile à respecter, car la partie intimée n’est pas tenue de montrer que le handicap accroît considérablement le risque.
Lorsque l’employeur ou l’assureur fait, dans un contrat d’assurance-groupe pour des employés, des distinctions fondées sur un handicap qui ne figure pas dans l’article 25(3), il renonce au droit d’invoquer une exception conformément au Code.
Handicap préexistant
L’industrie des assurances a recours à des clauses d’exclusion dans les contrats d’invalidité de longue durée afin d’empêcher les gens de présenter des demandes pour des conditions qui existaient avant la date d’entrée en vigueur de la garantie. Ces clauses d’exclusion semblent être conçues pour protéger l’assureur contre les personnes qui se font embaucher par un employeur dans le seul et unique but d’obtenir une protection pour un problème de santé anticipé par l’employé mais ignoré de l’assureur et de l’employeur. L’industrie des assurances appelle cela une « sélection adverse ».
Les limites relatives aux conditions préexistantes peuvent varier, mais il s’agit toujours de restreindre la garantie pendant une certaine période de temps à l’égard n’importe quelle condition qui a été diagnostiquée ou traitée durant une période donnée avant la date d’entrée en vigueur de la garantie. La limite prévue dans une clause d’exclusion est généralement temporaire. L’employé bénéficiera sans doute d’une protection pour les autres conditions dès la date d’entrée en vigueur, ainsi que d’une garantie différée sur les conditions préexistantes.
Dans Thornton c. North American Life Insurance Company et al.[5], le plaignant alléguait une discrimination fondée sur un handicap en raison d’une clause d’exclusion dans un régime d’invalidité de longue durée offert par son employeur. Cette clause interdisait les prestations d’invalidité de longue durée si l’employé se faisait soigner ou traiter par un médecin dans la période de 90 jours précédant la date d’entrée en vigueur de l’assurance. Au cours des 90 premiers jours de son emploi, le plaignant avait consulté son médecin à deux reprises au sujet de problèmes liés au VIH. Onze mois après avoir été embauché, M. Thornton a demandé des prestation d’invalidité de longue durée en raison d’une maladie causée par le VIH.
La commission d’enquête rejeta la plainte. En effet, à son avis « il est raisonnable d’inclure des clauses d’exclusions dans les contrats d’assurance lorsque le groupe d’assurés ne comprend que 100 employés ou moins. Lorsque le nombre d’employés est plus élevé, de telles clauses ne sont pas nécessaires, car le risque est étalé sur un plus grand nombre de personnes » (voir annexe, sommaires des causes). Le tribunal a également décidé qu’il n’existait aucune autre solution pratique.
Il y a problème lorsqu’une personne consulte son médecin pendant la période d’exclusion avant la date d’entrée en vigueur de la garantie pour un malaise mineur qui n’a pas encore été diagnostiqué comme un handicap préexistant. Ainsi, la maladie qui commence à se manifester avant la date d’entrée en vigueur n’est considérée comme un symptôme de conditions préexistantes qu’après cette date. Si l’intention des clauses d’exclusion des handicaps préexistants est de protéger l’assureur contre la sélection adverse, le refus des prestations ne se justifie que si la condition était connue ou diagnostiquée pendant la période d’exclusion.
Autre problème connexe : l’assuré est tenu de divulguer les faits importants tels que les conditions préexistantes. Baer explique que les contrats d’assurance sont considérés comme des contrats de bonne foi absolue, obligeant l’assuré à divulguer à l’assureur tous les faits importants le concernant, c’est-à-dire « n’importe quel fait apte à inciter l’assureur raisonnable à rejeter le risque ou à imposer une prime plus élevée ». Toutefois, Baer fait remarquer que « l’obligation en common law de faire preuve de bonne foi absolue est presque unanimement reconnue comme trop lourde et injuste ».
Baer estime que la Loi sur les assurances a adopté des modifications à l’exigence de la bonne foi absolue, même si la deuxième notion s’y trouve intégrée par inférence :
- Lorsqu'un contrat a été en vigueur pendant deux années de la vie de la personne sur la tête de qui repose l'assurance, l'omission de divulguer un fait ou une déclaration inexacte portant sur ce fait ne rend pas, sauf en cas de fraude, le contrat annulable.
- L’obligation de divulguer est limitée à l’information exigée dans le formulaire de demande ou à l’occasion d’un examen médical requis.
Baer recommande également que la Loi sur les assurances limite explicitement l’obligation de divulgation au fait de répondre à toutes les questions du mieux de ses capacités et de son information.
Augmentation considérable du risque
L’article 25(3)(a) présente une norme plus élevée à respecter par les employeurs et les assureurs, car un handicap préexistant doit augmenter considérablement le risque. La commission d’enquête dans Thornton a défini le risque de manière à inclure les chances qu’une demande soit déposée à l’égard de la prestation d’assurance visée par l’exclusion.
Dans une assurance-invalidité de groupe, l’assureur n’essaye pas d’évaluer le degré de risque lié aux employés individuels. Il accepte que certains membres du groupe risquent de déposer une demande.
Pour atteindre une répartition normale du risque dans un groupe, celui-ci doit être assez grand pour permettre l’élaboration de statistiques fiables. Les groupes d’employés très nombreux ont de fortes chances de présenter une répartition normale du risque. D’après l’industrie des assurances, les groupes de moins de 100 employés ne présentent généralement pas une répartition normale du risque.
Une compagnie d’assurance ne se demandera pas toujours si une condition augmente considérablement le risque de demandes d’indemnité. Toutefois, pour respecter les dispositions de l’article 25(3)(a), une compagnie d’assurance devrait veiller à n’appliquer une distinction en fonction du handicap préexistant qu’aux handicaps présentant un degré de risque élevé. Respecter cette obligation du Code, pourtant, pose des problèmes.
L’exclusion de personnes qui ont un « handicap préexistant qui augmente considérablement le risque » produit un traitement inégal dans l’emploi en raison d’un handicap. Le refus d’accorder une protection contre l’invalidité de longue durée constitue un obstacle pour les personnes ayant un handicap qui n’ont encore jamais détenu un emploi, et pour les personnes qui ont un emploi qu’elles ne peuvent quitter sous peine de perdre la protection dont elles jouissent auprès de leur employeur actuel.
Les personnes séropositives ou atteintes du sida sont particulièrement vulnérables à l’heure actuelle. Les représentants des compagnies d’assurance utilisent une image (« il est impossible d’assurer une maison qui brûle ») pour montrer à quel point il est difficile d’assurer une personne séropositive ou atteinte du sida. Certains organismes de lutte contre le sida n’ont pas pu obtenir de régimes d’assurance-groupe pour leurs employés car l’industrie des assurances estime que le groupe tout entier des employés présente un risque trop élevé.
Le cabinet d’experts-conseil en ressources humaines Foster Higgins a publié les résultats d’une enquête visant à prévoir les coûts liés au VIH dans les régimes d’assurance-groupe[6]. D’après ces experts, les coûts liés aux demandeurs d’invalidité de longue durée qui sont atteints du sida ou de troubles connexes n’étaient pas aussi élevés qu’on l’avait cru au départ. L’article mentionne plusieurs explications à ce phénomène. L’une, c’est que la majorité des demandes d’invalidité de longue durée sont réduites du montant des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. D’autre part, les séjours à l’hôpital sont de courte durée et pas toujours facturés au régime de la compagnie, et il existe des programmes de subventions pour les coûts des médicaments administrés hors de l’hôpital. En conclusion, les auteurs de l’article affirment qu’« une demande type peut coûter au régime d’avantages sociaux un total de 100 000 $, sans compter les prestations de décès; or, bien des demandes de prestations d’invalidité de longue durée coûtent plus cher à l’assureur ». Pour terminer, l’article suggère que les employeurs réfléchissent à différentes mesures permettant de contrôler les coûts des programmes d’assurance-vie et d’invalidité de longue durée.
Par conséquent, pour déterminer si un handicap préexistant augmente considérablement le risque, un assureur devra peut-être utiliser un modèle analytique tel que la comparaison des coûts mentionnée ci-dessus, avant de se prévaloir d’une exception en vertu de l’article 25(3)(a) du Code.
De façon raisonnable et de bonne foi
L’exclusion, la distinction ou la préférence établie dans une police d’assurance doit être fondée « de façon raisonnable et de bonne foi ». Ce test, proposé par la majorité des juges de la Cour suprême dans Bates c. Zurich Insurance, peut également s’appliquer à l’article 25(3). Comme dans les arrêts Zurich et Thornton, on ne mettra probablement jamais en question la bonne foi des parties intimées.
En ce qui concerne le motif justifié « de façon raisonnable », une commission d’enquête doit se demander si l’exclusion, la distinction ou la préférence :
- est conforme à une pratique d’assurance solidement fondée et reconnue;
- ne peut être remplacée par une autre solution pratique.
Autrement dit, une commission d’enquête doit évaluer s’il existe suffisamment de preuves statistiques et actuarielles pour soutenir la pratique consistant à refuser des prestations d’assurance à certains employés. Dans Thornton, à titre d’exemple, la compagnie intimée affirmait que l’objectif de la clause d’exclusion était d’empêcher la sélection adverse. Or, la commission d’enquête a décidé que l’intimée n’avait pas présenté un argument statistique suffisant pour justifier la nécessité d’une telle clause. Néanmoins, la commission a décidé que la clause d’exclusion était justifiée pour d’autres motifs.
Non seulement une exclusion, distinction ou préférence doit s’avérer statistiquement défendable, mais il ne doit également exister aucune autre solution pratique. Dans Thornton, la commission n’a pas accepté les solutions de rechange proposées par le plaignant. L’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes estime qu’il existe des solutions de rechange pour les régimes d’assurance-groupe lorsque le bassin de risque est réduit : par exemple, prévoir une période d’attente pour tous les membres du régime et toutes les conditions ou limiter les critères permettant de souscrire l’assurance-groupe.
Défense en vertu de l’article 22
Le moyen de défense prévu par l’article 22 du Code comprend l’assurance individuelle ou l’assurance-groupe contre les accidents, la maladie ou l’invalidité qui ne s’insère pas dans le cadre d’un emploi si des distinctions sont fondées sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap, mais ces distinctions doivent être fondées sur des motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi.
Critères de souscription
Dans Study Paper on Disability Insurance (supra), Baer explique que :
La souscription n’est pas une science exacte. Les souscripteurs et souscriptrices ont recours aussi bien à la preuve actuarielle qu’à l’expérience. Ils fondent la probabilité de perte sur le risque physique autant que moral. Dans le domaine de l’assurance-vie et de l’assurance médicale, le risque physique comprend tous les facteurs médicaux et professionnels dont le souscripteur ou la souscriptrice décide qu’ils influencent le risque. Le risque moral comprend les facteurs liés à la personnalité de l’assuré, et dont le souscripteur ou la souscriptrice décide qu’ils influencent peut-être ou certainement le risque.
Il suggère que les opinions fondées sur une expérience de la souscription professionnelle ou spécialisée « sont difficiles à différencier des partis pris de la société, qui sont basés sur des stéréotypes et des préjugés. » Il fait également remarquer qu’il arrive rarement qu’un tribunal canadien se demande si « les critères de souscription sont déraisonnables parce qu’ils sont incompatibles avec les notions modernes de droits de la personne. »
Baer fait remarquer que la Loi sur les assurances de l’Ontario ne prévoit aucune mesure de contrôle sur les critères de souscription pouvant être utilisés dans l’assurance-invalidité.
Comme il a été mentionné plus haut dans la discussion sur l’assurance-automobile, la Loi contient une interdiction générale à l’endroit des « pratiques injustes », conformément à la Partie XVIII. L’article 438 de la Loi sur les assurances établit que l’expression « pratiques injustes » s’entend « de toute discrimination injuste dans l'application d'un taux ou d'un tableau des taux entre des risques objectifs essentiellement identiques en Ontario dans la même classification territoriale ». Baer affirme également ceci :
À ce jour, le surintendant (des assurances) a exercé son autorité de façon modérée. Cette modération s’insère dans le cadre d’une longue tradition au Canada, celle qui consiste à traiter l’établissement des taux comme une question relevant surtout du domaine privé, et ne pouvant être assujettie au regard du public. Cette tradition est contraire à celle de la majorité des juridictions américaines, où l’on estime que la détermination des taux met en jeu des questions importantes sur le plan public, comme celles de la justice distributive et de l’équité entre les assurés.
Cette absence de contrôle public s’étend aux lois sur les droits de la personne dans la plupart des provinces…
En ce qui concerne l’Ontario, ce dernier point signifie que le Code des droits de la personne prévoit des exceptions ou moyens de défense des pratiques discriminatoires dans l’industrie des assurances, mécanismes dont on peut affirmer qu’ils n’ont pas été interprétés de façon aussi étroite que ne l’exigerait la jurisprudence des droits de la personne.
Même si Baer estime qu’on peut continuer à autoriser une souscription individuelle de personnes assurées par des régimes collectifs d’invalidité, il se demande s’il devrait y avoir un contrôle public sur les critères de souscription utilisés :
- Les critères obligent-ils les assureurs à se rendre coupables d’intrusion?
- Les critères s’appuient-ils sur des données scientifiques ou actuarielles?
- Les critères renforcent-ils un désavantage systémique dans la société?
- Est-il approprié d’utiliser des critères qui échappent au contrôle des gens?
- À l’égard des régimes d’assurance-groupe sous le contrôle des employeurs, les critères sont-ils contraires aux objectifs de l’équité en matière d’emploi?
Baer estime que plusieurs facteurs justifient l’intervention publique dans l’établissement des critères:
- La coopération, nécessaire à l’établissement efficace des taux d’assurance, risque de décourager l’introduction de critères innovateurs.
- La connaissance scientifique est si peu avancée que les assureurs doivent se débrouiller seuls avec des indices ou des traits de caractère qui inspirent des inquiétudes quant à la fiabilité et au respect de la vie privée. Mentionnons comme exemple la tentative d’identifier les groupes qui risquent le plus de contracter le sida.
- La pression compétitive dans l’industrie des assurances risque de renforcer le désavantage systémique.
Baer estime qu’on n’a que très peu utilisé les deux mécanismes existants pour remettre en question les critères de souscription : les lois sur les droits de la personne et la Charte d’une part, et l’autorité du surintendant des assurances à interdire les taux discriminatoires, d’autre part.
Pour Baer, c’est surtout au commissaire ou au surintendant des assurances (maintenant surintendant des services financiers) qu’il incombe d’empêcher les critères de souscription de produire une discrimination, en raison des compétences associées à ces fonctions. Il recommande ceci :
- Que l’autorité du surintendant ou du commissaire d’interdire les critères discriminatoires soit renforcée grâce à l’établissement des facteurs devant être utilisés ou écartés et en permettant au public de se faire entendre.
- Qu’un nombre accru de représentants du public soient nommés pour aider le commissaire à prendre sa décision
Enfin, pour éviter tout effet négatif du dépistage médical sur l’emploi, Baer émet la recommandation suivante :
- Le dépistage médical aux fins de la souscription d’assurance-invalidité collective doit lui aussi être assujetti aux normes des droits de la personne visant l’accès aux renseignements médicaux à l’égard des restrictions de travail causées par une invalidité, sauf s’il existe une raison sérieuse de vouloir en savoir plus.
Incapacité mentale
Lorsque l’industrie des assurances a signalé que le stress au travail était l’un des plus grands risques qui existent, les compagnies ont commencé à limiter les prestations d’invalidité de longue durée, souvent à seulement 24 mois, sauf hospitalisation de l’employé, dans les cas d’invalidités causées par des conditions nerveuses et mentales. Les employeurs et les compagnies d’assurance n’invoquent aucune défense spéciale pour justifier cette pratique.
Il est possible d’affirmer que la différence de traitement produit une discrimination fondée sur un handicap mental. Cela signifie que les personnes ayant des troubles mentaux sont traitées de manière différente des personnes qui ont une invalidité physique. En réponse, les compagnies d’assurance font souvent une interprétation étroite des observations des juges dans Andrews[7]. Les compagnies d’assurance intimées avancent l’argument que le concept du droit à l’égalité nécessite une approche comparative. Or, l’approche correcte consisterait à comparer le traitement des personnes invalides à celui réservé aux personnes non invalides. Étant donné que les employés non invalides n’ont pas droit aux prestations d’invalidité, il n’existe aucun traitement discriminatoire de la part de l’employeur dans ses prestations d’invalidité.
Cet argument a également été invoqué par un employeur intimé dans l’arrêt Gibbs devant la Cour d’appel de la Saskatchewan[8]. Dans cette affaire, une employée atteinte d’une maladie mentale a vu ses prestations prendre fin après 24 mois. Si elle avait été internée, elle aurait eu droit aux prestations. Les personnes atteintes d’invalidité physique avaient droit au versement de prestations jusqu’à l’âge de 65 ans ou jusqu’au départ à la retraite avec pension.
Le raisonnement invoqué par les intimées dans de telles circonstances est erroné parce qu’il n’est pas compatible avec l’approche d’égalité substantive développée dans l’arrêt Andrews. Après avoir reconnu que les droits à l’égalité nécessitent la comparaison avec la situation d’autrui, la Cour suprême dans l’arrêt Andrews a fait remarquer que « le principal facteur à considérer doit être l’effet de la loi sur le particulier ou le groupe concerné ».
Dans l’arrêt Gibbs, la Cour d’appel de la Saskatchewan a rejeté l’argument de l’intimée selon lequel il est approprié de comparer les personnes atteintes d’invalidité aux personnes non invalides. La Cour a émis l’avis que pour déterminer la comparaison appropriée, on doit commencer l’analyse par la personne qui allègue la discrimination et définir le groupe dont elle fait partie.
Enfin, la Cour suprême a rejeté un pourvoi en appel de la cause Gibbs[9] et a décidé qu’« il n’est pas erroné de conclure à l’existence de discrimination fondée sur un motif illicite quand les personnes qui présentent la caractéristique pertinente n’ont pas toutes été victimes de discrimination. La discrimination envers une partie du groupe donné, en l’occurrence les personnes atteintes d’une incapacité mentale, peut être considérée comme de la discrimination envers le groupe en général ».
L’Association canadienne des assurances de personnes (ACAP) affirme que les distinctions entre les conditions physiques et mentales, ou entre certaines conditions mentales et d’autres, « sont liées à la difficulté extrême qu’on éprouve à évaluer le degré d’invalidité produit par certaines conditions, même avec les conseils les plus hautement professionnels, et donc, à la difficulté à déterminer si l’invalidité existe dans la mesure anticipée par la définition figurant au contrat, et à quel moment ce degré d’invalidité cesse d’exister. »
L’ACAP poursuit en disant que le recours à de telles distinctions entre les conditions physiques et mentales s’est amoindri au fil des ans. Toutefois, l’ACAP a tempéré son opinion sur ce progrès en émettant le commentaire suivant : « ces progrès sont quelque peu contrebalancés par une augmentation notable des conditions liées au stress, et pour certains groupes il est considéré nécessaire d’avoir recours à une telle distinction pour que le risque global reste confiné à des limites acceptables, permettant d’offrir une protection pour d’autres conditions ».
Il se dégage clairement de ces observations que l’industrie des assurances préfère assurer une personne atteinte d’une condition physique qu’une personne souffrant d’un trouble mental. Il est intéressant de noter que les intimées n’ont pas invoqué le fait que le risque associé aux conditions mentales était trop élevé. Il serait possible d’affirmer que ce traitement différent repose sur des préjugés et des stéréotypes entourant la maladie mentale. La décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Gibbs démontre qu’un tel traitement différent ne sera pas toléré.
VIH / SIDA
Dans la Politique concernant la discrimination liée au VIH et au SIDA, la Commission déclare que les personnes qui, même si elles ne présentent aucun symptôme de maladie, ont le sida ou qui sont présumées l'avoir et les personnes atteintes, présentement ou par le passé, d'une affection liée au VIH, ou qui sont présumées l'être ou l'avoir été, ont droit à la protection du Code.
Au début des années 1990, la Commission a reçu deux plaintes émanant de la même personne à l’endroit de deux intimées différentes à propos de questions liées à la discrimination d’assurance fondée sur le VIH et le sida. Les plaintes n’ont pas été renvoyées à une commission d’enquête, mais une discussion des deux cas peut aider à faire la lumière sur les questions de discrimination en raison d’un handicap « perçu » ou éventuel.
L’une des plaintes touchait le refus d’une assurance-vie individuelle, et l’autre, celui d’une assurance hypothécaire collective. Dans les deux cas, le plaignant s’est vu refuser l’assurance parce qu’on l’a classé dans un groupe à risque élevé impossible à assurer du fait qu’il est marié à une femme séropositive.
L’ACAP explique l’assurance hypothécaire collective dans les termes suivants. Étant donné que ce type de police met en jeu des montants importants et qu’elle est normalement facultative, contrairement à l’assurance-groupe liée à l’emploi, il est important d’évaluer le risque présenté par chaque demandeur. Les procédures pour l’assurance hypothécaire de groupe ressemblent donc à celles mises en œuvre pour l’assurance individuelle. Le système administratif rationalisé ne peut tenir compte de risques non standard et fortement supérieurs à la norme, contrairement à l’assurance individuelle.
Si nous présumons que la description ci-dessus est correcte, l’analyse de la plainte devrait alors porter sur l’évaluation du risque attribué au plaignant en fonction du fait qu’il est marié à une femme séropositive. Les intimées, deux compagnies d’assurance ontariennes, estiment qu’une personne dont le conjoint est séropositif présente un risque trop important. Les deux cas mettent en jeu l’analyse des motifs justifiés « de façon raisonnable et de bonne foi » de cette évaluation du risque.
Il n’existe aucune raison de nier que les intimées agissaient de bonne foi. Cela signifie qu’ils ont adopté cette pratique de manière honnête, afin de mettre en œuvre une pratique solidement fondée et reconnue, et non dans le but de porter atteinte aux droits protégés conformément au Code. Il s’agit surtout de savoir si les intimées dans les deux cas satisfont au test du caractère raisonnable. Autrement dit, l’évaluation obéit-elle à une pratique solidement fondée et reconnue dans le domaine des assurances? Y avait-il une autre solution pratique?
Si les plaintes avaient été référées à une commission d’enquête, la Commission aurait été tenue de présenter une preuve médicale experte pour prouver que l’évaluation de risque par les intimées n’était pas conforme à des données actuarielles crédibles. Les intimées présument que deux personnes qui vivent ensemble comme mari et femme auront des rapports sexuels. Ils suggèrent qu’il existe des raisons de croire que le plaignant risque d’être infecté à présent ou avant l’expiration du contrat d’assurance.
À l’instar de la majorité des évaluations de risque dans l’industrie des assurances, cette estimation repose sur de vagues généralisations et non sur les circonstances particulières de chaque cas. Les intimées ont placé le plaignant dans un groupe à risque élevé pour la simple raison qu’il vit avec sa femme.
Dans les deux cas, les analyses décrivent en détail les problèmes posés par l’évaluation du risque effectuée par les intimées à l’endroit du plaignant. L’enquête menée par l’agent a mis au jour la preuve que les chances que le plaignant soit infecté par sa femme sont « pratiquement nulles ». Cette conclusion repose sur deux grandes raisons : premièrement, le taux de transmission d’une femme à un homme est très faible; deuxièmement, le plaignant et sa femme n’ont plus de rapports sexuels depuis janvier 1991. Pour résumer, l’agent déclare : « Le fait d’être marié avec une femme séropositive et d’avoir avec elle une relation conjugale ne peut être pris comme indicateur d’un risque élevé. Il faut faire la part entre un "comportement à risque" et une "relation à risque". »
On pourrait affirmer, à juste titre mais à condition de détenir la preuve experte nécessaire, que l’évaluation du risque par les intimées n’était pas fondée sur une pratique solidement fondée et reconnue, adoptée afin de satisfaire à l’objectif commercial légitime d’imposer des primes proportionnelles au risque.
En ce qui concerne le deuxième volet du test de motifs justifiés « de façon raisonnable », l’agent a suggéré qu’il existait une autre solution pratique au moment du refus de l’assurance. Il admet qu’il n’existe aucun système de classification perfectionné pour les risques liés au VIH, contrairement à ce qui se passe dans l’industrie de l’assurance-automobile mise en question à l’occasion de Bates c. Zurich. Mais l’autre solution consistait à évaluer le risque du plaignant en fonction de son comportement, et non de son appartenance à un groupe.
Diabète
Deux autres plaintes présentées à la Commission faisaient intervenir un couple marié qui avait demandé une assurance hypothécaire de groupe. La femme a été refusée parce qu’elle avait le diabète. La demande de son mari a été acceptée, mais l’assurance-groupe refusée. La femme allègue une discrimination fondée sur un handicap. Le mari estime qu’on lui a refusé la prestation d’un service en raison de son lien avec sa femme.
La question à poser ici encore, c’est de savoir si les données utilisées pour évaluer le risque étaient exactes. Autrement dit, la pratique de classer les diabétiques dans un groupe à risque élevé est-elle solidement fondée et reconnue, adoptée afin de satisfaire à l’objectif commercial légitime d’imposer des primes proportionnelles au risque? Une preuve médicale devra être présentée pour évaluer si tous les diabétiques présentent un risque élevé, ou si les antécédents et le comportement individuels constituent des facteurs importants dans l’évaluation du risque.
La Cour d’appel de Nouvelle-Écosse a rejeté un pourvoi en appel interjeté par la Commission des droits de la personne de cette province et par M. Scott Slipp, car le diabète dont ce dernier est atteint serait un facteur entièrement pertinent à l’évaluation du risque qu’il présente, et parce que l’assurance hypothécaire collective fournie par la banque n’est pas normalement disponible au public[10]. Même si les intimées se fondent sur cette décision, elle n’est pas d’une grande utilité en ce qui concerne le Code des droits de la personne de l’Ontario, car dans les lois de la Nouvelle-Écosse, la notion de service est limitée aux services « couramment offerts au public » et il n’existe aucune exception pour des motifs justifiés « de façon raisonnable et de bonne foi ».
ÉVALUATION DU RISQUE
Les compagnies d’assurance utilisent l’analyse des données actuarielles pour établir les primes et refuser de protéger les personnes considérées comme présentant un risque excessif. Même si une personne est couverte, elle n’a pas forcément droit aux prestations. L’auteur d’un article intitulé « The Industry of the Living Dead » a étudié les causes judiciaires mettant en jeu l’assurance-invalidité. D’après lui, ces affaires « font penser que l’industrie cherche résolument à rejeter des demandes qui finiront par être confirmées par les tribunaux[11]».
Bien entendu, les personnes qui présentent un risque plus élevé sont celles-là mêmes qui nécessitent une couverture d’assurance. Il n’existe aucune obligation légale qui soit directement liée à l’évaluation du risque. Comme il a été noté plus haut, la disposition relative aux « pratiques injustes » dans la PARTIE XVIII de la Loi sur les assurances (voir annexe) constitue la seule mesure de dissuasion, et le surintendant des assurances n’invoque que rarement cette disposition.
Les compagnies d’assurance tendent à utiliser des renseignements médicaux de nature générale pour une condition particulière, sans tenir compte des circonstances de la personne. L’Association canadienne des assurances des personnes (ACAP) a déclaré que la recherche médicale était le principal aspect des procédures d’évaluation du risque.
Les assureurs négligent souvent aussi bien les comportements individuels que les programmes sociaux qui offrent un soutien financier et autre aux personnes atteintes d’invalidité. On peut dire que si les assureurs considéraient ces facteurs, leur évaluation du risque ne serait sans doute pas aussi élevée. Cette idée trouve sa confirmation dans l’étude de Foster Higgins[12].
On peut également affirmer que l’approche de l’industrie à l’égard de l’évaluation du risque ne satisfait pas au test établi par la Cour suprême pour une pratique d’assurance solidement fondée et reconnue. Cela signifie que la pratique des grandes généralisations pour évaluer le degré de risque d’une personne ne répond pas à l’objectif commercial légitime d’imposer des primes qui sont proportionnelles au risque.
Tests génétiques
Les tests génétiques risquent de devenir une méthode de dépistage des maladies héréditaires chez les candidats à l’assurance. À titre d’exemple, les scientifiques canadiens viennent de découvrir deux gènes qui produisent une tendance au diabète de type [13]. Des tests de dépistage génétique du cancer du sein sont également en cours de développement. James Watson, lauréat du prix Nobel de chimie, a suggéré d’interdire aux compagnies d’assurance d’appliquer des tests génétiques aux futurs titulaires de polices. Il fait observer qu’il n’existe actuellement aucune loi interdisant le recours à de tels tests par les compagnies d’assurance[14].
Les ramifications des tests génétiques risquent d’être énormes pour les personnes qui sont prédisposées à la maladie. L’ACAP affirme qu’il est très peu probable que l’industrie des assurances utilise des tests génétiques pour le dépistage. Toutefois, si un demandeur avait subi de tels examens, il serait tenu de le divulguer. Les assureurs pourraient alors considérer que les résultats du test font partie de leur évaluation du risque. Ils pourraient décider de ne pas assumer le risque dans de tels cas, surtout si l’on tient compte du risque accru de sélection adverse.
L’ACAP estime que d’une façon ou d’une autre, l’industrie des assurances utilise d’ores et déjà une sorte de « test génétique », puisqu’elle consigne aux dossiers des demandeurs leurs antécédents familiaux. À titre d’exemple, une personne ayant des antécédents de maladie de Huntington pourra se voir refuser la couverture. Elle pourrait alors se faire inviter à être testée pour voir si elle est porteuse du gène.
COUPLES DU MÊME SEXE
Comme il a été indiqué ci-dessus, l’article 25(2) du Code permet de faire des distinctions fondées sur l’état matrimonial dans les régimes d’assurance-groupe, pourvu que ces régimes soient conformes à la Loi sur les normes d’emploi. Les règlements pris en application de la Loi sur les normes d’emploi permettent également aux employeurs et aux compagnies d’assurance de faire une discrimination fondée sur l’état matrimonial dans les régimes de retraite et les contrats d’assurance-groupe.
En combinant cette défense et la définition de l’état matrimonial dans le Code, on obtient un traitement différent à l’égard des avantages sociaux pour les employés gais et lesbiennes. Les partenaires de ces employés n’ont pas droit aux mêmes prestations que les conjoints de sexe opposé.
Dans Leshner c. Ontario[15], le gouvernement de l’Ontario avait refusé l’accès à un régimede retraite à des conjoints du même sexe en invoquant la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. La commission d’enquête dans Leshner a ordonné au gouvernement de donner une lecture plus large de la définition de état matrimonial dans le Code afin de se débarrasser de la restriction aux personnes de sexe opposé. Le conseil a également affirmé que l’article 25(2) n’avait aucune validité ni aucun effet, dans la mesure où il contredit les dispositions de la Charte. Le conseil a ordonné au gouvernement provincial d’offrir immédiatement des prestations de survivant équivalentes à ses employés gais et lesbiennes par l’intermédiaire d’une convention de retraite.
D’autre part, la commission d’enquête a donné trois ans au gouvernement ontarien pour présenter des pétitions au gouvernement fédéral afin de le persuader de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de permettre l’enregistrement de régimes de retraite offrant des prestations aux conjoints du même sexe. Elle a également ordonné à la Commission de surveiller les démarches entreprises par la province. En mars 1997, le commissaire principal a envoyé une lettre au ministre du Revenu national pour lui demander d’éliminer l’obstacle créé par la Loi de l’impôt sur le revenu.
Depuis lors, la Cour d’appel de l’Ontario vient d’entendre l’affaire Rosenberg et SCFP c. Revenu Canada, où l’on affirme que la définition du conjoint dans la Loi de l’impôt sur le revenu (une personne de sexe opposé) est contraire aux garanties de traitement égal présentées dans la Charte[16]. La Cour a autorisé l’appel et exigé que les mots « et de même sexe » soient intégrés à l’interprétation de la Loi.
Dans une affaire qui a eu un grand retentissement en 1995, la Cour suprême du Canada a accueilli le pourvoi en appel de Egan c. Canada[17]. sur la définition de la notion de conjoint. Dans ce cas, on avait refusé une prestation conjugale au conjoint de même sexe d’un retraité parce qu’il ne correspondait pas à la définition du mot « conjoint » dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse. La Cour a décidé que cette façon différente de traiter les personnes de même sexe vivant ensemble par rapport aux personnes de sexe opposé constituait une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
En septembre 1996, la commission d’enquête de l’Ontario a publié une décision d’importance capitale au sujet de deux plaintes portant sur l’orientation sexuelle. Dans Dwyer et Simms c. Municipalité métropolitaine de Toronto et Procureur général de l’Ontario, les deux plaignants, un gai et une lesbienne, ont contesté leur exclusion des dispositions relatives aux prestations du conjoint dans leur régimes respectifs de retraite, de santé assuré et d'avantages sociaux non assurés[18]. Les questions juridiques soulevées à cette occasion étaient fondées sur la décision émise par la Cour suprême du Canada dans Egan c. Canada, et sur une contestation de la nature constitutionnelle de certaines dispositions du Code.
Dans Dwyer et Simms, la commission d’enquête a constaté que les intimées avaient fait preuve de discrimination à l’endroit des plaignants en raison de leur orientation sexuelle. Le conseil a également décidé que le Code devait être lu comme un tout, et qu’il fallait tenir compte des définitions de « conjoint » et d' « état matrimonial » qui mentionnent des personnes de sexe opposé. Le conseil a appliqué une analyse de la Charte à ces définitions, en concluant qu’elles étaient contraires aux droits égaux garantis par l’article 15 de la Charte et qu’elles ne constituaient pas des limites raisonnables ou démocratiques d’après l’article 1 de celle-ci. La décision du conseil impose aux municipalités l’obligation d’offrir les prestations de santé assurées et non assurées aux conjoints du même sexe des employés.
Il faut noter qu’un appel a été interjeté dans Dwyer et Simms. D’autre part, dans Bell et Cooper[19], la Cour suprême du Canada a récemment statué que des organismes tels que la Commission canadienne des droits de la personne, de même que les tribunaux constitués sous l’autorité de celle-ci, ne sont pas habilités à décider qu’une disposition de leur loi constitutive est inconstitutionnelle.
Dans une affaire plus récente sur la question des prestations de conjoint et de la discrimination contre les couples du même sexe, la Division générale de la Cour de l’Ontario, dans Kane c. Assurance Axa, a décidé en octobre 1997 (voir annexe) que le refus de la compagnie de verser une prestation de conjoint après le décès accidentel de la partenaire lesbienne de Kane constituait une atteinte à ses droits conformément à la Charte[20]. La Cour a décidé que la Loi sur les assurances de l’Ontario était discriminatoire et a ordonné sa modification de manière à inclure les membres de couples du même sexe dans la définition de « conjoint ». Un appel a été interjeté.
Dans une autre affaire, la Division générale de la Cour de l’Ontario, dans sa décision de décembre 1998 dans Caisse de retraite du SEEFPO c. Ontario, a ordonné au gouvernement de l’Ontario de modifier la définition de « conjoint » dans la Loi sur les prestations de retraite afin d’inclure les couples du même sexe[21].La Cour a statué que la définition actuellement contenue dans la loi (un rapport entre un homme et une femme) était inconstitutionnelle. La loi en cause établit les normes minimales à respecter par tous les régimes de retraite de la province.
Plus récemment encore, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans Procureur général de l’Ontario c. M. et. H., où elle déclare que la définition de « conjoint » comme étant une personne de sexe opposé dans la partie III de la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario est inconstitutionnelle[22]. Bien que cette affaire n’ait rien à voir avec les prestations d’emploi et les assurances, elle constitue tout de même une autre confirmation, de la part de cours d’instance supérieure, que les définitions de « conjoint » et d’ « état matrimonial » qui interdisent aux couples du même sexe de bénéficier des mêmes droits et obligations que les autres couples sont discriminatoires.
Enfin, en juin 1997 et en juillet 1999, le commissaire en chef a écrit au procureur général de l’Ontario pour lui exprimer son inquiétude relative aux définitions exclusionnistes de « conjoint » et d’« état matrimonial » dans les lois de l’Ontario et pour déplorer leur effet discriminatoire sur les couples du même sexe.
GROSSESSE
La Politique concernant la discrimination liée à la grossesse de la Commission établit que, si les conditions de bonne foi sont respectées, le refus ou la limitation de congés de maladie à une femme en congé de maternité peut constituer une atteinte au Code.
L’article 25(2) offre aux employeurs et aux compagnies d’assurance intimés un moyen de défense contre une accusation de discrimination en fonction du sexe, de l’état matrimonial, de l’âge ou de l’état familial. Les distinctions dans les régimes de retraite ou les régimes d’assurance-groupe des employés en fonction de l’âge, du sexe, de l’état matrimonial ou de l’état familial n’enfreignent pas le Code si elles sont conformes au règlement pris en application de la Loi sur les normes d’emploi.
L’article 33(2) de la Loi sur les normes d’emploi interdit aux employeurs de constituer des régimes d’avantages sociaux qui contiennent une distinction, une préférence ou une exclusion fondée sur l’âge, le sexe ou l’état matrimonial des employés sauf disposition contraire dans les règlements. Le Règlement 321 permet de faire une distinction entre les employés en fonction de l’âge, du sexe et de l’état matrimonial dans les prestations de retraite, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité et d’assurance-maladie (voir annexe).
L’alinéa 8(c) du Règlement 321 permet l’exclusion des femmes à l’égard des prestations de courte ou de longue durée pendant la période d’absence qu’elle a le droit de prendre d’après la Partie XI de la Loi sur les normes d’emploi. La Partie XI de la Loi accorde aux femmes le droit de prendre un congé de maternité, et aux hommes et aux femmes le droit de prendre un congé parental. Le résultat de l’alinéa 8(c), c’est que les femmes peuvent être exclues des prestations découlant d’un régime d’invalidité pendant un congé parental, mais les hommes, non.
Le Règlement 321(8)(c) est encore en vigueur, même s’il risque d’être éventuellement décrété inconstitutionnel au regard de la décision de la Cour suprême du Canada dans Brooks c. Canada Safeway[23]. La Cour a décidé que la grossesse constituait une raison de santé parfaitement légitime de ne pas travailler, et que les femmes devaient donc avoir droit au versement de prestations de maladie ou d’invalidité pendant la partie du congé de maternité où elles ne sont pas capables de travailler pour des raisons de santé valables.
Dans l’arrêt Alberta Hospital Association c. Parcels, une cour de l’Alberta a repris le principe émis dans Brooks selon lequel l’absence d’une employée enceinte justifiée par une raison de santé ne doit pas être traitée de façon différente de toute autre absence pour raison de santé[24]. Cela s’applique généralement lorsqu’une femme est enceinte et que la condition médicale nécessitant un congé est liée à la grossesse.
Plus récemment, en mars 1998, la Cour divisionnaire de l’Ontario a tranché un appel interjeté contre une décision d’une commission d’enquête dans Crook c. Ontario Cancer Treatment and Research Foundation et Ottawa Regional Cancer Centre[25]. Crook alléguait que la partie intimée lui avait refusé des prestations de congé de maladie pendant la période suivant la naissance de son enfant.
L’appel de l’employeur reposait sur deux arguments : d’abord, il n’existe aucune discrimination dans l’article 5 du Code qui empêche les femmes en congé sans solde de recevoir les prestations du régime de congés de maladie après l’accouchement; ensuite, pris ensemble, l’article 25(2) du Code, la Loi sur les normes d’emploi et les règlements concernant les régimes d’avantages sociaux ont pour effet d’interdire toute discrimination.
La Cour a décidé que la partie intimée ne pouvait se prévaloir du moyen de défense prévu à l’article 25(2) du Code, parce que les congés pour vacances ne sont pas une forme de congé compatible avec la Loi sur les normes d’emploi si les femmes sont exclues du versement de prestations en vertu d’un régime d’invalidité. D’autre part, le régime de prestations de maladie était auto-financé et ne constituait pas un contrat d’assurance-groupe comme le stipule l’article 25(2) du code. La Cour s’est inspirée de la décision Brooks pour juger que la commission d’enquête dans Crook avait raison de dire que l’application par l’employeur de la politique sur les congés de maladie constituait une discrimination directe fondée sur la grossesse et le sexe, car elle refusait des prestations à la plaignante et à d’autres femmes dans son cas qui demandaient des prestations pour une période de convalescence après l’accouchement.
En Ontario, les décisions prises dans Brooks et Parcels n’ont pas été entièrement intégrées aux protections légales qui sont offertes aux femmes absentes pour des raisons de santé liées à la grossesse.
En pratique, cela signifie que le droit à recevoir des prestations en vertu d’un régime d’invalidité s’éteint lorsqu’une femme décide de prendre un congé conformément à la Partie XI de la Loi sur les normes d’emploi (congé de maternité ou congé parental). Mais si un employeur offre des prestations d’invalidité à d’autres employés qui s’absentent pour des congés de formation ou des congés sabbatiques, par exemple, la Loi sur les normes d’emploi prévoit que les prestations devraient également être versées aux femmes en congé de maternité et parental.
Enfin, une femme peut souffrir de problèmes de santé liés à la grossesse qui l’obligent à s’absenter du travail avant ou après le congé de maternité ou le congé parental. Elle peut alors avoir droit aux prestations d’un régime d’assurance-maladie ou d’assurance-invalidité de son employeur.
Que le régime de congés de maladie soit ou non régi par un contrat d’assurance-groupe, les femmes en congé de maternité continuent à avoir droit à d’autres prestations offertes par des régimes d’avantages sociaux, y compris celles des régimes de retraite, d’assurance-vie, d’assurance en cas de décès par accident, d’assurance-maladie complémentaire et d’assurance-soins dentaires[26]. Les employeurs sont également tenus de continuer à contribuer à de tels régimes[27].
[3] Zurich Insurance Co. c. Ontario (Comm. des droits de la personne) (1992), 16 C.H.R.R. D/255 (S.C.C.)
[4] À titre d’exemple, Thornton c. North American Life Insurance Company et al.
[5] Supra, note 2.
[6] Foster Higgins Bulletin, "The Impact of AIDS on Benefit Programs" (Toronto: Foster Higgins, 1994)
[7] Andrews v. Law Society of British Columbia (1989), 10 C.H.R.R. D/5719 (S.C.C.)
[8] Battlefords and District Co-operative Ltd. v. Gibbs and Saskatchewan Human Rights Commission (unreported decision, June 14, 1994, Saskatchewan Court of Appeal).
[9] Gibbs v. Battlefords and Dist. Co-operative Ltd. (1996), 27 C.H.R.R. D/87 (S.C.C.)
[10] Nova Scotia (Human Rights Comm.) v. Canada Life Assurance Co. (1992), 88 D.L.R. (4th) 100 (N.S.C.A.).
[11] David Schulze, "The Industry of the Living Dead: A Critical Look at Disability Insurance" (1993) 9 Journal of Law and Social Policy 192
[12] Supra, Note 6
[13] Barbara Wickens, "On the Leading Edge: Canadians are at the Forefront of Diabetes Research" (1994) 107(4) Macleans 58.
[14] Stephen Strauss, "Bar Genetic Tests on Policyholders, Nobel Laureate Says" Nov. 4, 1994 Globe and Mail 7.
[15] Leshner v. Ontario (No. 2) (1992), 16 C.H.R.R. D/184 (Ont. Bd.Inq.)
[16] Rosenberg v. Canada (Attorney General) (1998), 38 O.R. (3d) 577 (Ont. Court of Appeal).
[17] Egan v. Canada (1995), 124 D.L.R. (4th) 609 (S.C.C.).
[18] Dwyer v Toronto (Metro) (No.3) (1996), 27 C.H.R.R. D/108.
[19] Copper v. Canada (Human Rights Comm.) (1997), 27 C.H.R.R. D/173 (S.C.C.)
[20] Kane v. Ontario (Attorney General) (1997), 152 D.L.R. (4th) 738.
[21] Ontario Public Service Employees Union Pension Plan Trust Fund (Trustees of) v. Ontario (Management Board of Cabinet) (1998) 20 C.C.P.B. 38
[22] Attorney General of Ontario v. M. and. H, Unreported decision of the Supreme Court of Canada released on May 20, 1999.
[23] Brooks v. Canada Safeway Ltd. (1989), 10 C.H.R.R. D/6183 (S.C.C.)
[24] Alberta Hospital Association v. Parcels (1992), 17 C.H.R.R. D/167 (Alta. Q.B.).
[25] Ontario Cancer Treatment & Research Foundation v. Ontario (Human Rights Commission) (1998), 34 C.C.E.L. (2d) 56, 108 O.A.C. 289 (Ont. Div. Ct.); upholding Crook v. Ontario Cancer Treatment & Research Foundation (No.3) (1996), 30 C.H.R.R. D/104 (Ont. Bd. of Inquiry).
[26] Subsections 42(1) and (2) of the Employment Standards Act.
[27] Subsection 42(3) of the Employment Standards Act.